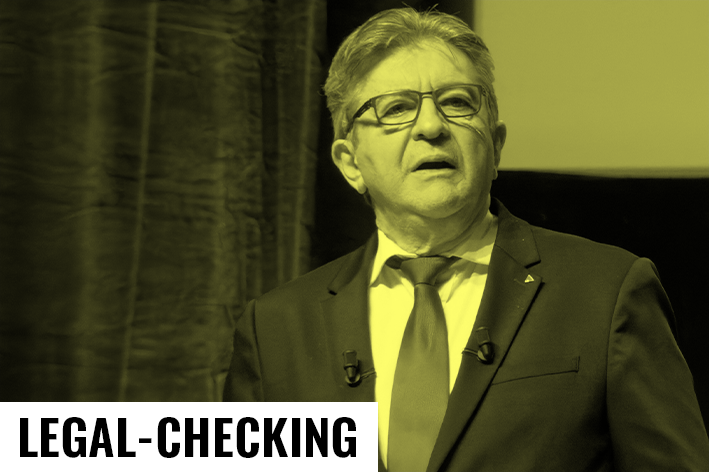Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle été condamnée et François Bayrou relaxé ?
Autrice : Sarah Auclair, doctorante en droit, chargée d’enseignement à l’UPEC
Relecteurs : Guillaume Baticle, doctorant en droit public, université de Poitiers
Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal, université de Lorraine
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Fanny Velay, étudiante en journalisme à l’École W
Source : Publication X, le 31 mars 2025
Deux affaires de détournement de fonds publics, deux verdicts opposés : Marine Le Pen condamnée, François Bayrou relaxé. Sur les réseaux sociaux, certains y voient un « deux poids, deux mesures ». Mais ces affaires sont bien différentes.
À lire les commentaires qui prolifèrent sur les réseaux sociaux comme autant de jugements improvisés depuis le 31 mars 2025, le soupçon plane d’une justice à deux vitesses. Un procès pour les uns, une clémence pour les autres. Un « deux poids, deux mesures » que certains et certaines érigent déjà en axiome d’un système judiciaire compromis.
Des responsables politiques comme Julien Aubert, vice-président des Républicains, n’ont pas hésité à dénoncer une « impartialité de la justice ».
Yann Le Baraillec, un candidat malheureux à plusieurs élections dans le Morbihan, dans une interview à Actu, voyait dans le jugement « une ombre sur l’équité de notre système judiciaire et politique » pointant une éventuelle justice à deux vitesses.
« Deux poids, deux mesures : Marine Le Pen condamnée, François Bayrou relaxé ? », s’interrogent aussi des internautes. D’un côté, la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics européens et sa peine d’inéligibilité immédiate ; de l’autre, la relaxe de François Bayrou dans l’affaire similaire des assistants parlementaires du MoDem qui ne l’a pas empêché d’accéder à la fonction de Premier ministre.
L’argument de ceux qui dénoncent un « deux poids, deux mesures » tient en quelques mots : les faits seraient identiques, mais les sanctions différentes. La critique paraît simple ; mais elle est, juridiquement, très réductrice.
S’agissant du préjudice financier
Le 31 mars, la 11ᵉ chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné Marine Le Pen à quatre ans d’emprisonnement, dont deux assortis d’un sursis probatoire, à cinq ans d’inéligibilité, ainsi qu’à 100 000 euros d’amende. Le RN, en tant que personne morale, a quant à lui écopé d’une amende de deux millions d’euros, dont un million ferme. Le préjudice causé au Parlement européen est évalué à 6,8 millions d’euros.
Un an auparavant, en février 2024, le tribunal correctionnel de Paris rendait un jugement bien différent dans l’affaire du MoDem. Là aussi, il était question d’emplois fictifs d’assistants parlementaires européens. Mais le montant des sommes détournées avait toutefois une tout autre consistance : 293 000 euros, soit près de vingt-trois fois moins. Par ailleurs, le nombre de prévenus est également inférieur dans l’affaire du MoDem : onze prévenus contre vingt-trois pour le RN.
Le tribunal a relaxé François Bayrou, faute de preuve attestant sa connaissance effective des détournements. D’autres membres du MoDem ont été condamnés à des peines avec sursis, et le parti lui-même à une amende de 350 000 euros.
S’agissant de la connaissance effective des faits
Les différences de traitement judiciaire dépendent de l’appréciation par les juridictions des éléments de preuve apportés dans chaque affaire. L’analyse juridique des deux affaires se cristallise aussi autour de la connaissance effective des faits par les personnes poursuivies. Là où la preuve de la connaissance et de la participation aux faits a été rapportée pour Marine Le Pen, elle faisait défaut pour François Bayrou.
D’après le jugement obtenu par Les Surligneurs, Marine Le Pen aurait parfaitement su comment fonctionnait ce système « organisé, centralisé, optimisé », qui permettait de financer son parti avec des fonds du Parlement européen. Les juges ont également estimé qu’elle en était à la fois la bénéficiaire et l’organisatrice.
Ces derniers soulignent que ce système frauduleux avait été mis en place « non sans un certain cynisme mais avec détermination », pourtant dans un climat eurosceptique.
Durant le procès, Marine Le Pen a persisté à contester la compétence des juridictions pénales, elle a notamment soutenu que l’activité politique de ses assistants échappait à tout contrôle judiciaire. Mais aussi que les faits reprochés relevaient du seul exercice de son mandat, au mépris des règles du Parlement européen et des décisions rendues. Le tribunal a relevé que cette stratégie procédait d’une conception partisane et « narrative » de la vérité, déconnectée des éléments du dossier.
C’est précisément en raison de cette attitude et du risque de récidive qui en découlait que le tribunal a prononcé une peine bien plus sévère d’inéligibilité assortie de l’exécution immédiate. D’ailleurs, contrairement à ce qu’affirment certains soutiens de Marine Le Pen, le tribunal n’a pas appliqué rétroactivement la loi Sapin II. La peine d’inéligibilité prononcée trouve son fondement dans les textes en vigueur au moment des faits. Le tribunal a seulement exercé la faculté qui lui était offerte par la loi antérieure (article 131-26 du Code pénal).
Dans l’affaire du MoDem, la posture de défense a été tout autre. François Bayrou, contrairement à Marine Le Pen, n’a jamais contesté l’applicabilité du droit pénal aux faits reprochés. Le débat judiciaire s’est concentré uniquement sur la question des preuves. Le tribunal a rappelé que François Bayrou, bien que président du parti, ne pouvait être déclaré complice des faits que si sa connaissance de ceux-ci était établie. Après analyse du dossier, les magistrats ont estimé que cette preuve faisait défaut ; il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que François Bayrou ait pu demander « aux députés européens de recruter des assistants parlementaires ».
De plus, l’article 40 du Code de procédure pénale impose à toute personne investie d’une autorité, tel que François Bayrou en sa qualité de président du MoDem, de signaler sans délai tout crime ou délit dont elle aurait eu connaissance et d’y faire cesser les effets. Or, aucune preuve n’a permis d’établir que François Bayrou avait eu connaissance des faits poursuivis, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir agi. Ainsi, le tribunal a relaxé François Bayrou, « au bénéfice du doute » en estimant qu’aucune preuve ne démontrait qu’il avait eu connaissance de ces faits.
Il est tentant, au regard des différences de traitement, d’y voir l’expression d’une justice à géométrie variable. Or, ce « deux poids, deux mesures » entre ces deux décisions résulte exclusivement de l’application du droit pénal français. Dans l’affaire du RN, l’implication personnelle de Marine Le Pen a été matériellement établie. Dans celle du MoDem, aucune preuve n’a permis de démontrer la participation active de François Bayrou.
Si la décision peut prêter à débat, la Cour d’appel rappelle dans un communiqué de presse, qu’elle ne saurait légitimement conduire à des attaques contre les magistrats et magistrates, dont la mission est d’appliquer la loi dans le respect de l’État de droit.






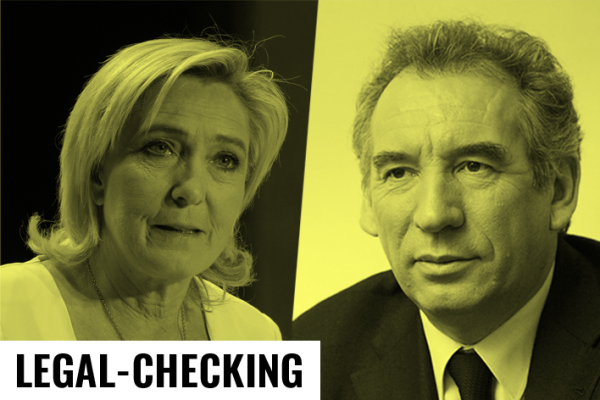








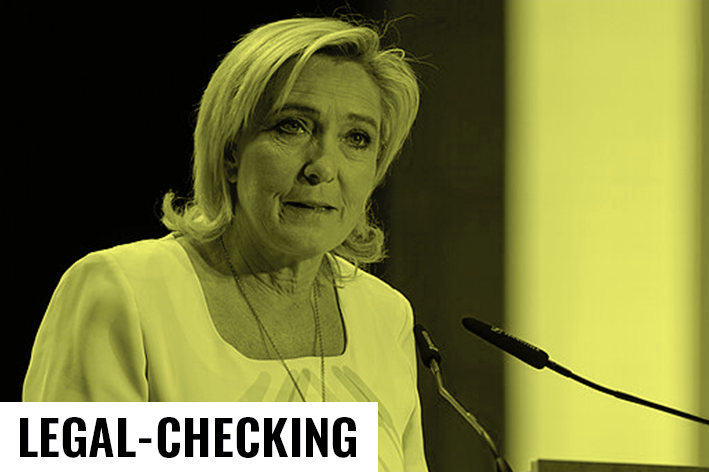

 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents