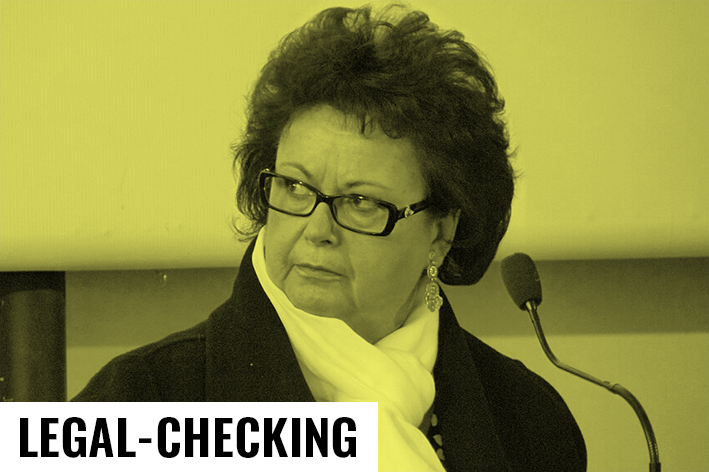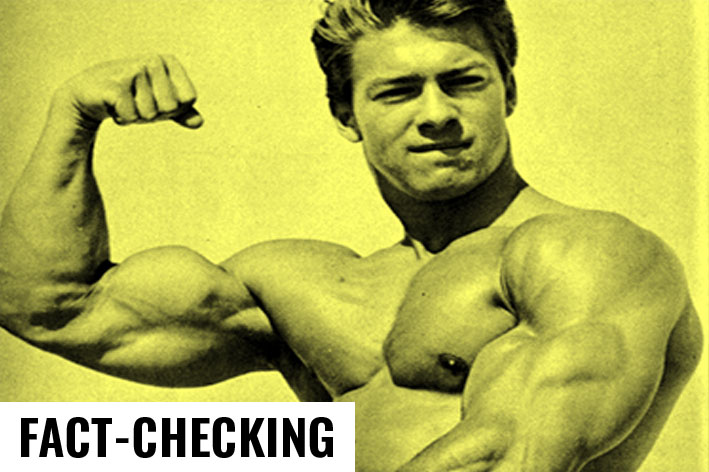Pourquoi cette comparaison des chiffres des viols en France et en Pologne n’est pas correcte
Dernière modification : 10 octobre 2025
Auteur : Etienne Merle, journaliste
Relectrice : Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clarisse Le Naour, double cursus L3 science politique et L3 droit public à l’université Lumière Lyon II
Source : Compte Facebook le 26 juillet 2025
Une comparaison entre la France et la Pologne sur le nombre de viols entre 2000 et 2024 circule sur les réseaux sociaux. Mais les chiffres avancés sont faux ou trompeurs : les méthodes de comptage sont différentes, les périodes non comparables, et la réalité des violences sexuelles bien plus complexe.
« La précipitation est mère de l’échec » : l’avertissement est attribué à l’historien grec Hérodote, témoin d’un monde où la déesse antique, Némésis, châtiait les arrogants. Un adage qu’une militante du groupe éponyme aurait peut-être dû méditer avant de dégainer trop vite sur les réseaux sociaux.
Sur son compte Facebook, une membre du groupe identitaire et xénophobe Némésis publie, le 28 juillet, des prétendues statistiques sur le nombre de viols en France : 7500 en 2000 contre 42 400 en 2024. Une hausse impressionnante qu’elle compare avec les statistiques d’un autre pays européen, la Pologne : 2399 en 2000, 1127 en 2024.
Autrement dit, la France aurait vu le nombre de viols perpétrés sur son sol multiplié par près de cinq en plus de 20 ans, tandis qu’en Pologne, il aurait été divisé par deux sur la même période. Et de conclure, faussement candide : « À votre avis, quelle est l’explication de cette différence entre la France et la Pologne ? »
Problème, les chiffres avancés ne représentent pas le nombre de viols commis. De plus, comparer les données de 2000 à celles de 2024 n’a aucun sens statistique, faute de méthodologie uniformisée. Enfin, le faible nombre de viols enregistrés en Pologne tend à montrer le contraire de ce que la militante espère démontrer… explication point par point.
Des chiffres qui ne mesurent pas le nombre de viols
Avant toute chose, il est essentiel de comprendre à quoi correspondent les statistiques sur la délinquance. Chaque année, le service statistique du ministère de l’Intérieur publie un rapport intitulé Insécurité et délinquance, qui dresse un état des lieux chiffré à partir de différentes sources.
Ce rapport repose sur deux approches : d’une part, les données dites « administratives », qui recensent l’activité des forces de l’ordre — dépôts de plainte, arrestations, enquêtes ouvertes ; d’autre part, les enquêtes de victimation, fondées sur des sondages réalisés auprès de la population, pour estimer la part de la délinquance non enregistrée (nous y reviendrons).
C’est sur la première catégorie — l’activité des forces de sécurité — que la militante de Némésis s’appuie pour affirmer qu’il y aurait eu 42 400 viols en France en 2024. Ce chiffre provient en réalité du rapport publié en 2023, et concerne l’année 2022, pas 2024. Mais surtout, il ne correspond pas au nombre réel de viols commis sur le territoire.
Les statistiques de la police et de la gendarmerie ne mesurent pas les infractions en tant que telles, mais les faits enregistrés par les institutions. D’autant que ce chiffre agrège viols et tentatives de viol, sans les distinguer clairement : on ignore donc combien de viols ont réellement été recensés.
Les évolutions du nombre de victimes enregistrées par les forces de sécurité sont à interpréter avec prudence. Elles ne rendent pas compte directement de l’évolution de la délinquance.
Ces données reflètent donc plutôt la manière dont elles sont signalées et traitées : nombre de plaintes effectivement déposées, de la capacité des forces de l’ordre à qualifier les faits, mais aussi de l’organisation locale, de la présence de brigades spécialisées ou encore des campagnes de sensibilisation.
« Les évolutions du nombre de victimes enregistrées par les forces de sécurité sont à interpréter avec prudence. Elles ne rendent pas compte directement de l’évolution de la délinquance », rappelle le ministère de l’Intérieur, auprès des Surligneurs. Résultat : ces chiffres n’indiquent pas combien de viols ont été commis, mais combien ont été signalés, traités ou enregistrés. En confondant les deux, on tord la réalité statistique.
Raisonnons par l’absurde
Imaginons que, demain, le ministre de l’Intérieur supprime la police à Toulouse. Très vite, l’activité policière dans la ville tomberait à zéro. Est-ce que cela signifierait que la délinquance a disparu ? Évidemment non. Cela signifierait seulement qu’il n’y a plus personne pour enregistrer les faits.
À l’inverse, imaginons que le ministère de l’Intérieur décide de renforcer massivement la lutte contre les violences sexuelles : embauche de centaines de policiers spécialisés, ouvre des lieux d’accueil dédiés aux victimes, lance des campagnes de sensibilisation à grande échelle pour inciter à porter plainte.
Que se passerait-il ? Le bilan annuel montrerait, très probablement, une hausse du nombre de viols enregistrés. Faut-il en conclure que le phénomène s’aggrave ? Pas nécessairement. Ce que ces chiffres traduiraient avant tout, c’est une amélioration de la prise en charge institutionnelle : plus d’affaires signalées, mieux traitées, plus souvent qualifiées. Autrement dit, une meilleure réponse publique — pas forcément une explosion de la criminalité.
Un effet #metoo
C’est d’ailleurs l’analyse qu’en tire le ministère de l’Intérieur dans plusieurs rapports (ici en 2025, là en 2018) et auprès des Surligneurs : « Un des facteurs d’augmentation du nombre de victimes de violences sexuelles enregistrées une année donnée est la part croissante de faits anciens dénoncés par les victimes. Cette part est particulièrement importante pour les victimes mineures ou les violences intrafamiliales », précise le ministère.
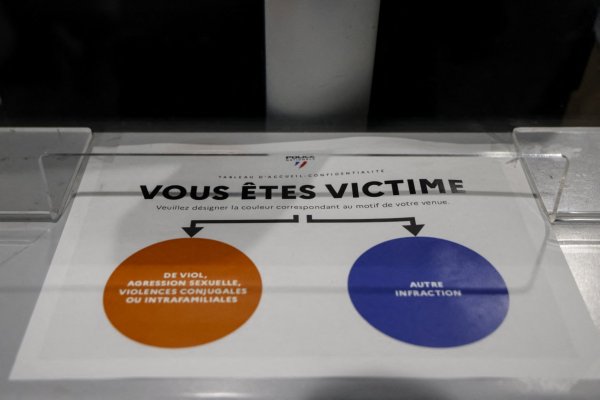
Un panneau à l’accueil d’un commissariat indiquant : « Vous êtes victime de : viol, agression sexuelle, violences conjugales ou intrafamiliales/autre infraction ». (Photo : Ludovic Marin/Pool/AFP)
« En France, la montée des chiffres s’explique aussi par une politique plus volontariste — avec une meilleure prise en charge, des plaintes déposées pour des faits très anciens, et une libération de la parole. On voit donc augmenter des statistiques pour des faits commis il y a parfois 5 ou 10 ans », confirme auprès des Surligneurs, Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité.
Confondre le niveau d’activité des forces de sécurité avec l’évolution réelle de la délinquance est une erreur fréquente. Et cette erreur ne se limite pas à la militante de Némésis. Comme Les Surligneurs l’ont déjà montré à plusieurs reprises, des journalistes, des responsables politiques ou des internautes de tous bords tombent régulièrement dans le même piège.
Pourquoi comparer avec les années 2000 est-il une erreur ?
Par ailleurs, comparer les données des années 2000 avec celles de 2024 n’a aucun sens statistique, tant la manière de centraliser, structurer et publier les données a été profondément réformée. Et pour cause : les archives du ministère de l’Intérieur ne comportaient pas, en 2000, de catégorie distincte pour les « viols » ou tentatives de viol.
Les données antérieures à 2016 n’ont pas été expertisées et ne sont pas directement comparables avec celles produites aujourd’hui.
À l’époque, la terminologie utilisée dans les rapports publics était beaucoup plus large : « Harcèlements sexuels et autres agressions sexuelles contre des mineur(e)s » ou « contre des majeurs ». Autrement dit, les viols étaient fondus dans un ensemble de crimes et délits — rendant toute comparaison avec les décennies suivantes non seulement imprécise, mais trompeuse. « Les données antérieures à 2016 n’ont pas été expertisées et ne sont pas directement comparables avec celles produites aujourd’hui », insiste le ministère.
Puisqu’une telle précision fait déjà défaut à l’échelle nationale, il est d’autant plus illusoire de vouloir comparer ces données avec celles d’un autre pays.
Des lacunes en Pologne
Concernant les statistiques polonaises diffusées sur Facebook, le chiffre de 2 399 viols pour l’année 2000 correspond effectivement aux données officielles de la police. En revanche, aucune trace des 1 127 viols prétendument commis en 2024. Le dernier chiffre disponible concerne l’année 2023, avec 1 024 faits enregistrés par les forces de sécurité.
Même entre deux pays de l’Union européenne, il est extrêmement difficile de confronter des données statistiques, tant les cadres juridiques, les pratiques policières et les politiques publiques divergent.
Pour autant, ces données sont produites selon une méthodologie différente de celle utilisée dans l’Hexagone. En effet, contrairement à la France, la Pologne publie un décompte distinct des faits de viol enregistrés par la police. « Même entre deux pays de l’Union européenne, il est extrêmement difficile de confronter des données statistiques, tant les cadres juridiques, les pratiques policières et les politiques publiques divergent », rappelle Driss Aït Youssef.

Des passants assistent à une veillée funèbre en mémoire de Liza, une réfugiée biélorusse de 25 ans, décédée après avoir été agressée, violée et violemment battue dans le centre-ville de Varsovie, le 6 mars 2024. (Photo : Wojtek Radwanski/AFP)
Des études ont d’ailleurs mis en évidence les lacunes structurelles des institutions polonaises en matière de suivi statistique des violences sexuelles. Selon une recherche conduite par un docteur polonais en droit pénal et en criminologie de l’université Marie Curie-Skłodowska de Lublin, 80 à 90 % des violences sexuelles commises dans le pays ne sont jamais signalées aux autorités — par peur de la stigmatisation ou absence de confiance dans les institutions.
En 2023, le rapport du GREVIO, organe du Conseil de l’Europe chargé de veiller à l’application de la Convention d’Istanbul, le souligne sans détour : « Les données disponibles sur les infractions de violence faites aux femmes, y compris le viol, sont limitées en Pologne. […] La Pologne ne collecte pas systématiquement de données sur le nombre de signalements, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations ou de peines prononcées ».
Ainsi, la comparaison avec la France laisse entendre que la Pologne ferait figure de modèle en matière de lutte contre les violences sexuelles. Pourtant, ces chiffres — justement très bas — témoignent probablement de carences dans la détection, la prise en charge et la remontée des faits.
Contactés, ni la militante de Némésis ni le ministère de l’Intérieur polonais ne nous avaient répondu au moment de la publication de l’article.
Quels sont les chiffres crédibles en France ?
Pour avoir une image plus fidèle de l’ampleur des violences sexuelles, il faut délaisser les seules statistiques policières et se tourner vers une autre source : l’enquête de victimation, utilisée notamment par le ministère de l’Intérieur, l’Insee et les chercheurs en sociologie de la délinquance.
Cette méthode consiste à interroger directement un échantillon représentatif de la population afin de savoir si les personnes ont été victimes de tel ou tel type de violences, indépendamment d’un dépôt de plainte. Si elle n’est pas exempte de biais (comme le souvenir déformé ou le refus de parler), elle a l’avantage majeur de prendre en compte la majorité des victimes qui ne se tournent pas vers les forces de l’ordre.
Dans son bilan publié début 2024, le ministère de l’Intérieur indique qu’en 2023, environ 270 000 personnes ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles physiques – un chiffre qui regroupe les viols, tentatives de viol, agressions sexuelles et attouchements sexuels. Le rapport ne précise toutefois pas la part exacte des viols dans cet ensemble.
Autrement dit, ni les statistiques, ni la comparaison dans le temps, ni celle entre la France et la Pologne n’ont le moindre sens. Hérodote l’aurait sans doute noté dans ses Histoires : quand on manipule les chiffres à la légère, Némésis n’est jamais bien loin.