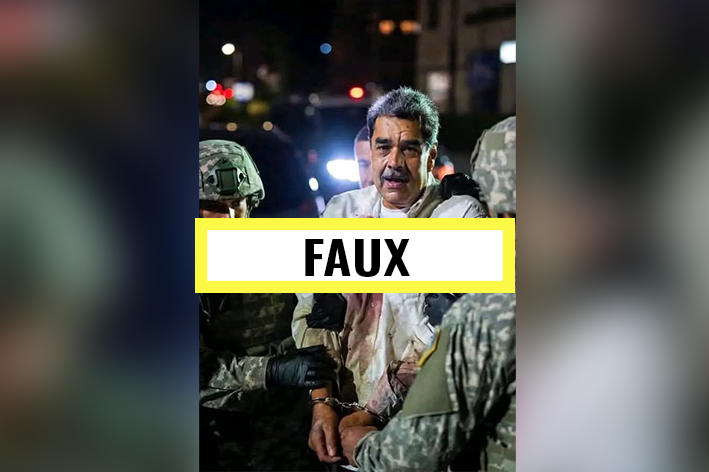Caméras-piétons : leur absence peut-elle faire tomber une procédure pour outrage ou rébellion, comme le suggère Mathieu Valet ?
Dernière modification : 6 novembre 2025
Autrice : Noémie Alfano, étudiante en master 2 droit pénal approfondi à l’Université de Lorraine
Relecteurs : Jean-Batiste Thierry, professeur de droit pénal à l’Université de Lorraine
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Compte X de Matthieu Valet, le 16 octobre 2025
Le député européen Matthieu Valet (RN) critique le refus des magistrats du ministère public de poursuivre des auteurs d’outrages et de rébellion sur des policiers s’il n’y a pas d’enregistrement par caméra-piéton. L’occasion de rappeler que la loi ne fait pas de la caméra-piéton une condition pour juger ou condamner : la preuve est libre, et le juge reste souverain.
Le 16 octobre 2025, le député européen Matthieu Valet (Rassemblement national, groupe Patriotes pour l’Europe) s’agace sur son compte X. Dans une vidéo, il dénonce ce qu’il présente comme une « dinguerie judiciaire » : selon lui, une magistrate d’Avignon aurait décidé seule, « en dehors de tout Code de procédure pénale, en dehors de toute loi votée par le Parlement », que si les policiers n’activent pas leur caméra-piéton en cas d’outrage ou de rébellion, il n’y aurait pas de suite judiciaire, même s’ils sont insultés ou violentés.
Autrement dit, selon l’interprétation du député, cette magistrate du Vaucluse aurait conditionné les poursuites pénales à l’existence d’un enregistrement : pas de vidéo, pas de procédure. Une décision que Matthieu Valet juge « sidérante » et qu’il érige en symbole d’un système judiciaire qui, selon lui, « désarme moralement » les forces de l’ordre.
Les Surligneurs ont contacté le parquet d’Avignon afin de vérifier les faits exposés par l’élu, sans obtenir de réponse. Il n’est donc pas possible, à ce stade, de confirmer la réalité de la décision évoquée par Matthieu Valet. En revanche, on peut en analyser le contenu juridique tel qu’il la présente.
Le ton du député est avant tout politique. Dans la même publication, il fustige ce qu’il appelle une « idéologie gauchiste » qui placerait « la parole du policier au même niveau que celle du voyou », affirmant au contraire que « la parole du policier sera toujours supérieure ».
Des propos qui dépassent le cas d’espèce et posent la question du rôle du juge, de la liberté d’appréciation des preuves et de la présomption d’innocence — autant de principes fondamentaux du droit pénal français.
Les caméras-piétons : un outil, pas une obligation
Depuis la loi du 3 juin 2016, policiers et gendarmes peuvent être équipés de caméras-piétons, dont le déploiement a été achevé par un décret d’avril 2022. Ces dispositifs, encadrés par le Code de la sécurité intérieure, ont plusieurs finalités : prévenir les incidents, constater les infractions, recueillir des preuves, mais aussi servir à la formation des agents.
Concrètement, les agents déclenchent l’enregistrement lorsqu’un incident survient ou est susceptible de se produire. Un signal lumineux indique que la caméra est en marche, sauf si les circonstances l’interdisent.
Mais contrairement à ce que suggère Matthieu Valet, aucune règle n’impose aux policiers d’activer leur caméra dans toutes les situations. Il s’agit d’une faculté, non d’une obligation. Ne pas enregistrer — par oubli, impossibilité ou choix circonstanciel — ne peut donc pas, à lui seul, bloquer toute poursuite judiciaire.
La preuve est libre : la caméra n’est pas la seule option
En droit pénal, les infractions d’outrage et de rébellion (articles 433-5 et 433-6 du Code pénal) peuvent être établies par tout mode de preuve. L’article 427 du Code de procédure pénale est clair : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. »
Autrement dit, un juge peut se fonder sur des témoignages, des constats matériels (photos, certificats médicaux, vidéos), ou encore sur les procès-verbaux rédigés par les forces de l’ordre. Les images des caméras-piétons sont donc un moyen parmi d’autres, certes utile et objectif, mais pas indispensable.
L’absence d’enregistrement ne suffit donc pas à justifier l’absence de poursuites. La décision de la magistrate d’Avignon — si elle a bien été prise dans ces termes — pourrait relever d’une volonté d’inciter les policiers à mieux documenter leurs interventions. Mais aucune règle générale ne prévoit qu’un outrage ou une rébellion doive être filmé pour être poursuivi.
« La parole du policier vaut plus que celle du voyou » ? Pas en droit
Sur un autre plan, Matthieu Valet défend l’idée que la parole d’un policier devrait « toujours être supérieure à celle d’un voyou ». Là encore, le droit dit autre chose. Le Code de procédure pénale ne hiérarchise pas les preuves : toutes sont égales devant le juge, qui les apprécie selon son intime conviction.
Les procès-verbaux rédigés par les policiers ont la valeur de simples renseignements (article 430 CPP), sauf en matière contraventionnelle, où ils font foi jusqu’à preuve du contraire (article 537 CPP). En matière correctionnelle — comme pour les outrages et rébellions — le juge reste libre d’en apprécier la valeur probante, et un témoignage contraire peut suffire à en contester le contenu.
Autrement dit, le juge n’est pas tenu de croire un policier sur parole : il évalue la cohérence des éléments, leur régularité et la crédibilité de chacun.
Rappel : la présomption d’innocence vaut pour tous
Enfin, lorsque le député déplore un système « fait pour les voyous avant les victimes » et conclut qu’il faut « protéger les policiers », il oublie un principe fondamental du droit pénal : la présomption d’innocence.
En affirmant que la justice favoriserait les délinquants au détriment des forces de l’ordre, le député semble présupposer la culpabilité de certains mis en cause avant tout jugement — ce qui va à l’encontre de ce principe essentiel.
Protégée par le Code de procédure pénale, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et la Convention européenne des droits de l’Homme, elle garantit que toute personne suspectée est innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
Qu’il s’agisse d’un policier, d’une victime ou d’un mis en cause, tous doivent être entendus de manière égale et impartiale. Le rôle du juge est précisément d’arbitrer, à partir des preuves disponibles — caméra ou non.
En somme, la caméra-piéton est un outil de transparence et de protection, mais pas une condition de justice. Ni son absence, ni sa présence ne décident seules d’une culpabilité. En France, la preuve est libre, le juge souverain, et la parole de chacun — policier, mis en cause ou témoin — doit être examinée avec la même exigence.
















 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents