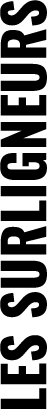Un peu de philo du droit : “vide juridique”, une notion vide de sens ?
Dernière modification : 22 juin 2022
Autrice : Maxence Christelle, maître de conférences en droit public
Dans les suites de la décision rendue par la Cour de cassation dans l’affaire Sarah Halimi, de nombreux juristes, praticiens comme universitaires, se sont émus de la référence utilisée par le ministre de la justice dans son communiqué de presse du 25 avril 2021, à savoir l’idée qu’il y aurait un “vide juridique” dans la législation française. Qu’est ce qui peut expliquer une telle réaction, tant est répandue l’idée selon laquelle le droit existant en France ne couvrirait pas l’ensemble des situations envisageables ? Pour prendre un exemple simple et caricatural, le droit français ne prévoit pas, pour le moment, de dispositions réglant les droits et devoirs d’entités biologiques extraterrestres. Il y aurait donc, de facto, un vide, une béance. Indépendamment du fond de cette affaire, suffisamment débattue par ailleurs, on aimerait s’interroger ici sur cette notion de vide juridique, afin d’en préciser la signification.
Ne pas confondre vide juridique et insatisfaction quant au droit existant
S’il y avait un vide juridique dans l’affaire qui nous intéresse, la Cour de cassation n’aurait pas pu rendre sa décision, puisqu’en principe, il est interdit aux juges “de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises”. Le juge est donc tenu de n’appliquer que le droit, et rien que le droit. Or, le droit pénal français interdit de poursuivre pénalement toute personne qui a perdu son discernement et qui ne comprend donc pas la portée de ses actes . La Cour de cassation s’est appuyée sur une règle d’interprétation héritée de l’antiquité romaine, selon laquelle « Ubi lex non distinguit, nec nos dinstinguere debemus ». Cela signifie que là où la loi ne distingue pas entre les cas, il n’y a pas le lieu pour le juge de le faire. Cela signifie que, puisque la loi ne distingue pas entre les causes de l’absence de discernement, c’est-à-dire selon qu’elles sont liées à une prise de drogue ou à un trouble mental, le juge ne peut de lui-même introduire de telles distinctions. Il n’y avait donc pas de “vide juridique” puisque le juge a bien utilisé une règle de droit existant pour trancher le litige !
Dès lors, il semble bien que le problème posé ici ne soit pas tant l’existence d’un vide juridique que le fait que les règles de droit applicables, et la solution rendue, ne satisfont pas un certain nombre de personnes. Il ne s’agit donc, en réponse à cette insatisfaction, pas de créer du droit là où il n’y en a pas, mais de modifier le droit existant afin qu’il se conforme à ce que l’on voudrait qu’il soit.
Le vide juridique existe-t-il vraiment ? Réflexions de théorie du droit
Pour apprécier la notion de “vide juridique” sur un plan théorique, il faut distinguer deux questions qui sont souvent confondues : que peut-on considérer comme étant du droit (idée de définition du droit) ? Quelles sont les situations dans lesquelles le droit s’applique, ou devrait s’appliquer ?
La première question porte sur ce que qu’on appelle en termes techniques l’ontologie du droit. Deux grandes écoles se disputent la réponse : les positivistes et les jusnaturalistes. Selon les premiers, le terme “droit” renvoie à l’ensemble des règles juridiques en vigueur et applicable dans un État à un moment donné : c’est le droit qu’on appelle “positif”, qui comprend aussi bien des normes écrites que non écrites (les normes non écrites sont souvent appelées “principes”). Selon les seconds, le droit ne se limite pas au droit dit positif, mais comprend également des éléments qui, tout en n’étant pas explicitement repris dans les textes, peuvent néanmoins produire des effets juridiques. Dans cette perspective jusnaturaliste, le droit aurait une sorte de nature, ou d’essence, qui pourrait compléter ou même contredire le droit positif. Pour simplifier, les positivistes estiment que le droit est ce qui est posé à un instant précis. Pour les jusnaturalistes, le droit comprend, en plus, ce qu’il devrait être pour être conforme à sa nature supposée. C’est donc un raisonnement qui repose sur deux niveaux, deux étages du droit.
Appliquée à la notion de “vide juridique”, cette distinction aboutit à deux visions opposées. Dans la perspective positiviste, le vide juridique n’a pas de sens : puisque n’est droit que ce qui existe comme droit, alors le droit est par définition complet. Pour les jusnaturalistes, le vide en droit positif est envisageable : il correspond au fait qu’une règle existerait dans l’étage supérieur du droit (sa nature) et non dans le droit positif.
Si on replace ce débat dans l’affaire Sarah Halimi, les politiques, juristes et citoyens qui se sont exprimés en faveur d’une réforme de la législation pénale se sont en réalité prononcé sur ce que le droit devrait être. Ils ont contesté le droit positif existant en tant qu’il exclut tout procès pénal d’une personne dont le discernement est aboli, et en tant que telle, cette question n’implique l’utilisation d’aucune ontologie du droit particulière. Il ne s’agit donc pas de combler un vide juridique mais de modifier la règle de droit. Ainsi, celui qui défendrait une conception positiviste du droit n’aurait ainsi aucune difficulté à demander, en tant que citoyen (et non en tant que juriste), une modification du droit existant. Il s’agit alors, en réalité, d’une question essentiellement politique et non directement juridique.
Sous un angle jusnaturaliste, on peut prétendre fonder juridiquement cette demande de modification du droit positif, en invoquant le fait qu’il existe une norme de droit naturel, supérieure au droit positif, selon laquelle une personne qui a contribué de façon volontaire à se mettre dans un état d’absence de discernement ne peut pas être déclarée pénalement irresponsable. En somme, le jusnaturaliste peut éventuellement trouver dans le droit naturel de quoi combler ce qu’il considère comme un vide ou une malfaçon du droit positif.
Punir la prise de drogue quand elle mène au crime ? Une proposition qui pose une sérieuse difficulté logique
Le Garde des Sceaux, dans son communiqué, a affirmé que”la France ne jugerait jamais les fous”, mais qu’il s’agirait de pouvoir “tenir compte de la prise volontaire de substances toxiques par un individu conduisant à l’abolition de son discernement”. Cette proposition se heurte à une sérieuse difficulté logique. Elle implique de distinguer deux moments dans la commission d’une infraction pénale : le premier est la prise volontaire d’une substance toxique dont résultera l’absence de discernement ; le second est le crime ou délit commis pendant la phase d’absence du discernement. Pour ce second moment, si l’on en croit les déclarations du ministre, la situation ne changera pas, et l’individu concerné ne pourra donc pas être jugé. Reste le premier temps, où se concentre la plus grande difficulté.
En effet, il s’agit de punir une personne qui prend des substances toxiques indépendamment de ce qu’elle commet par la suite. Comment, dans ce cas, relier cette prise de substance et l’acte commis ensuite, et donc tenir compte de la gravité de cet acte ? Pour le dire autrement, punira-t-on de la même façon une prise volontaire de drogues selon qu’elle aboutit à une simple dégradation de biens, ou au meutre d’une personne ? Si l’on tient compte de ce qui est commis, alors cela implique que la personne va bien être jugée au regard de ce qu’elle a accompli avec son discernement altéré, ce qui est donc contraire à l’idée selon laquelle on ne jugerait pas les fous !
Une erreur dans ce contenu ? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier ? Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode.