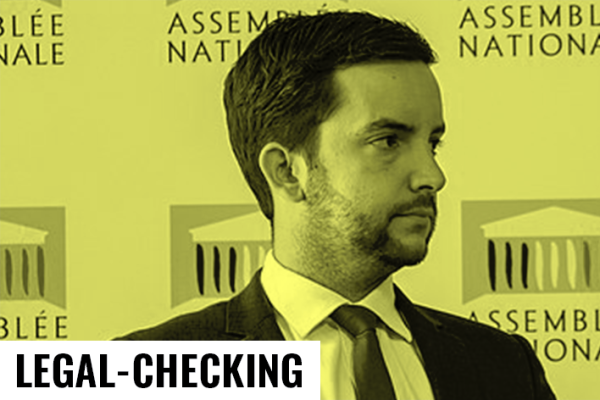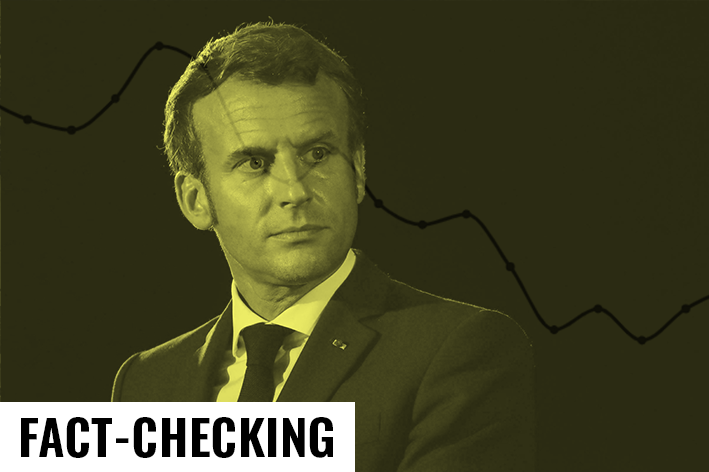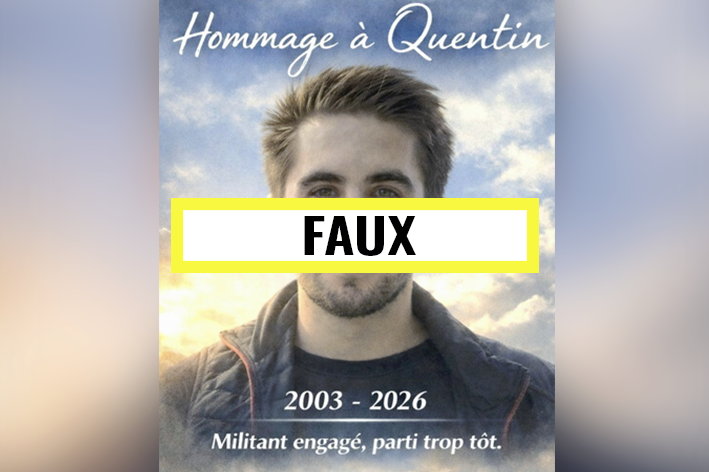Prêts au RN : un particulier peut-il prêter plusieurs fois à un parti politique sans enfreindre la loi ?
Dernière modification : 4 septembre 2025
Auteur : Etienne Merle, journaliste
Relecteur : Jean-Pierre Camby, ancien professeur associé à l’université Versailles-Saint-Quentin et commentateur du code électoral
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clarisse Le Naour, double cursus L3 science politique et L3 droit public à l’université Lumière Lyon II
Source : Interview de Jean-Philippe Tanguy, BFMTV le 10 juillet 2025
Face au député RN Jean-Philippe Tanguy sur BFMTV, Apolline de Malherbe soutient qu’un particulier prêtant à plusieurs reprises à un parti politique pourrait violer la loi. Pourtant, les textes ne tranchent pas clairement cette question.
L’agenda judiciaire du Rassemblement national (RN) continue de s’alourdir. Après la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics dans l’affaire des assistants parlementaires européens — elle a fait appel — des perquisitions ont été menées début juillet au siège du RN, dans le cadre d’une enquête sur de possibles financements illicites liés à des prêts accordés par des particuliers.
D’après Le Monde, l’affaire fait suite à plusieurs signalements de la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP). C’est ce dernier volet qui a provoqué un vif échange sur BFMTV, le 10 juillet, entre le député RN Jean-Philippe Tanguy et la journaliste Apolline de Malherbe.
La journaliste a qualifié ces prêts de « suspects » et rappelé qu’un prêt devient suspect « s’il devient habituel », en particulier « quand c’est une même personne qui prête plusieurs fois ». Ce à quoi le député a immédiatement répondu : « C’est marqué dans la loi, ça, madame de Malherbe ? […] Le caractère habituel n’est pas défini ».
Derrière cette passe d’armes, une question de droit électoral pointue et souvent mal comprise : un particulier peut-il prêter plusieurs fois à un parti politique sans tomber sous le coup de la loi ? Qui dit juste entre la journaliste et le député Rassemblement national ? Les textes sont clairs sur les principes, beaucoup moins sur les seuils.
Ce que dit la loi : une interdiction… sans définition
Depuis la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017, l’article L. 52-7-1 du code électoral prévoit qu’une personne physique peut prêter de l’argent à un candidat ou un parti, à condition que ce ne soit pas « à titre habituel ». Cette formule marque une limite, mais aucun texte n’en donne de définition précise.
Ni la loi ni le décret d’application n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 ne précisent à partir de combien de prêts, ou à quelle fréquence, une opération est considérée comme « habituelle ». Aucun seuil automatique n’est posé.
Ce que précisent les textes : des conditions strictes
En revanche, la réglementation encadre très précisément les modalités de ces prêts. La durée maximale est fixée à 18 mois pour un prêt à un candidat, et à 24 mois pour un prêt à un parti. Le taux d’intérêt doit se situer entre 0 % et le taux légal, fixé chaque année.
Le montant maximal qu’un parti peut devoir à l’ensemble des personnes physiques est plafonné à 15 000 € par personne à un instant donné. Enfin, le parti ou le candidat bénéficiaire doit déclarer chaque année à la CNCCFP l’état des remboursements en cours.
Tant que ces conditions sont respectées, le prêt est présumé régulier. La charge de la preuve d’une irrégularité incombe à celui qui l’invoque, qu’il s’agisse de l’autorité de contrôle ou de la justice.
La notion d’habitude : une appréciation au cas par cas
En l’absence de définition légale, la notion de prêt « à titre habituel » ne fait l’objet d’aucune jurisprudence connue en matière de financement politique. Il est néanmoins probable qu’elle soit interprétée de manière pragmatique par le juge, à travers ce qu’on appelle une analyse in concreto.
C’est-à-dire une appréciation au cas par cas, fondée sur plusieurs éléments : le nombre, la fréquence et la régularité des prêts consentis par une même personne physique, les montants en jeu, ainsi que le contexte dans lequel ils interviennent.
Toutefois, cette grille d’analyse repose essentiellement sur l’esprit des textes et sur une analogie avec d’autres branches du droit, notamment bancaire ou financier. Elle ne s’appuie donc pas sur de précédents jugements qui auraient pu être rendus en matière électorale.
En conséquence, un particulier qui prêterait plusieurs fois, dans le respect des plafonds et sans condition avantageuse, ne tombe pas automatiquement sous le coup de l’illégalité.
La CNCCFP peut émettre des réserves ou des signalements en cas de doute, mais elle ne peut pas requalifier seule un prêt en don déguisé. Seul le juge, saisi dans le cadre d’un contentieux, peut opérer cette requalification avec les sanctions qui peuvent en découler.
La faute à qui ?
En cas de requalification d’un prêt consenti par une personne physique à un parti politique en don déguisé, c’est avant tout le bénéficiaire – parti ou candidat – qui est sanctionné par le juge. La responsabilité peut donc peser sur la personne morale ou physique selon celui qui a effectivement profité du prêt requalifié.
En cas de manquement grave ou de fraude caractérisée, le juge peut prononcer une sanction pénale visant le candidat, notamment une peine d’inéligibilité, voire jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (article L113-1 du code électoral). Le juge tient compte de l’importance de l’avantage irrégulier et de l’impact sur l’égalité entre candidats, principe fondamental de la sincérité des élections.
Le prêteur, en tant que personne physique, peut également être sanctionné pénalement pour avoir consenti un don interdit ou frauduleux, selon la gravité des faits et l’intention éventuelle de fraude. Ce régime juridique harmonisé vise à empêcher tout contournement des règles de financement électoral. Dans certains cas, les deux parties peuvent être responsables, notamment si une volonté délibérée de contourner la loi est démontrée, ce qui aggrave la gravité des sanctions.
Nouveau front judiciaire
En d’autres termes, Apolline de Malherbe ne dit pas tout à fait vrai en assimilant le prêt « habituel » à une suspicion. De son côté, Jean-Philippe Tanguy a raison de souligner l’absence de définition précise dans la loi.
Si les zones grises de la loi laissent place à l’interprétation, elles n’offrent pas pour autant un bouclier juridique au Rassemblement national. Et pour cause : un nouveau front judiciaire s’est ouvert pour le parti d’extrême droite. Les policiers de la PJ de Marseille et de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) viennent de boucler une enquête visant des prêts obtenus par des candidats RN, rapporte Mediapart.
Pendant un an, les enquêteurs anticorruption se sont penchés sur des prêts accordés par le milliardaire Pierre-Edouard Stérin. Ils soupçonnent ce dernier d’avoir contourné la législation sur le financement politique en finançant indirectement des candidats du RN par l’intermédiaire de prêteurs tiers.