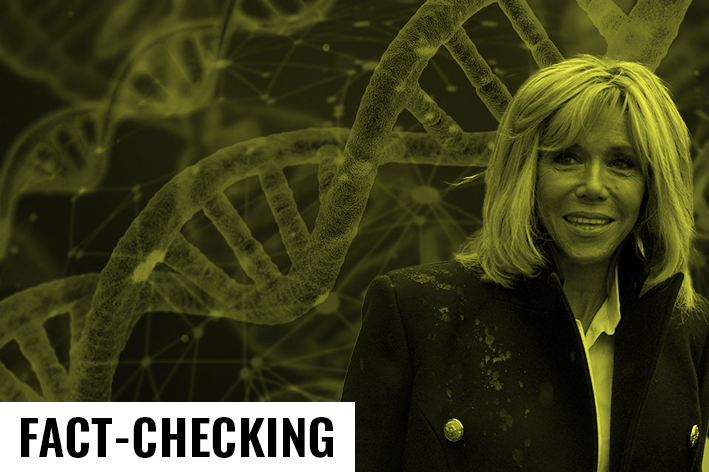Non, un premier ministre de gauche ne pourrait pas « suspendre » la loi sur la réforme des retraites « par décret »
Auteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay
Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social, université de Nantes
Relecteur : Bertrand-Léo Combrade, professeur de droit public, université de Poitiers
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Compte X de Raquel Garrido, le 8 septembre
Contrairement à ce qu’affirme Raquel Garrido, un décret ne peut ni suspendre ni abroger une loi. Qu’un Premier ministre ou un président soit issu de la gauche n’y changera rien : c’est au Parlement et à lui seul que revient le choix d’abroger la réforme des retraites.
Symbole pour une partie de la gauche d’une loi socialement injuste, la réforme des retraites, adoptée à grand fracas en 2023, continue de hanter le second quinquennat d’Emmanuel Macron. Longtemps, la promesse d’un conclave réunissant syndicats et patronat pour « remettre à plat » ce texte honni par une majorité de Français avait offert un sursis à François Bayrou. Mais la démission contrainte du fondateur du MoDem a rouvert la brèche.
La gauche parlementaire a alors de nouveau tenté — sans illusion réelle — de pousser le chef de l’État à nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire. En vain. Fidèle à sa méthode, Emmanuel Macron a préféré confier Matignon à l’un de ses lieutenants les plus loyaux.
Dans l’interstice ouvert entre la démission de François Bayrou et la nomination de Sébastien Lecornu, les fractures de la gauche sont aussitôt réapparues. Tandis que le Parti socialiste, nouveau centre de gravité d’une possible majorité parlementaire, espérait décrocher la fonction, Jean-Luc Mélenchon a rapidement balayé cette hypothèse, estimant que la France insoumise « ne soutiendrait aucun autre gouvernement » que celui de LFI.
« Quoi ? Jean-Luc Mélenchon envisage de s’opposer à un gouvernement de gauche ? Nous pourrions, dès la semaine prochaine, par décret : augmenter le Smic, suspendre la loi Borne, reconstruire le code du travail en abrogeant les décrets macronistes » s’est indignée l’ancienne députée insoumise Raquel Garrido sur X, le 8 septembre dernier.
Si, comme l’ont rappelé Les Surligneurs, l’augmentation du Smic peut effectivement être décidée par décret, l’abrogation des « décrets macronistes » relève d’une bataille autrement plus complexe (mais nous y reviendrions dans un prochain article). Surtout, aucun règlement (tel qu’un décret) ne saurait suspendre ou abroger une loi, qu’il s’agisse de la réforme des retraites ou d’un autre texte adopté par le Parlement.
Le parallélisme des compétences
Dès la première année de droit, un étudiant apprend le « parallélisme des compétences », à savoir, entre autres, que seule une loi peut abroger ou modifier une loi, seul un décret peut abroger ou modifier un décret, seul un arrêté peut abroger ou modifier un arrêté, etc.
Les exceptions à ce principe tiennent dans les doigts d’une main et ne s’appliquent pas ici, sauf à considérer que les articles 10 et 11 de la loi du 14 avril 2023, qui décalent l’âge de la retraite, sont allés si loin dans le détail qu’ils relèvent en réalité du domaine réglementaire et peuvent donc être abrogés par décret.
Il est vrai que les articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du Code de la Sécurité sociale, issus des articles 10 et 11 cités plus haut, mentionnent, année de naissance par année de naissance, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein.
Or, habituellement, la loi (pouvoir législatif) fixe les grands principes et le décret (pouvoir exécutif) met en œuvre dans le détail. C’est le partage des compétences qui résulte des articles 34 (domaine de la loi) et 37 (domaine du pouvoir réglementaire) de la Constitution.
Mais, contrairement à ce qu’affirme Raquel Garrido, une telle opération ne pourrait en aucun cas être menée « en une semaine ». En effet, seul le Conseil constitutionnel est habilité à juger qu’une disposition votée par le Parlement relève en réalité du domaine réglementaire et peut donc être modifiée par décret (article 37, alinéa 2, de la Constitution). Autrement dit, il ne suffit pas de publier un décret pour effacer ou suspendre une loi.
Un décret d’abrogation illégal
Reste alors une autre piste, parfois évoquée : agir non pas sur la loi elle-même, mais sur ses décrets d’application. Serait-il possible, par ce biais, de suspendre ou d’abroger la réforme des retraites ? La démarche paraît plus simple, mais elle se révèle tout aussi fragile juridiquement.
Il faut ici revenir aux bases du droit administratif : si un décret de septembre 2025 venait à abroger un décret de 2023 pris pour appliquer la loi de 2023 sur les retraites, cette abrogation ferait en réalité automatiquement « revivre » les décrets antérieurs, en l’occurrence ceux de 2011 qui mettaient en œuvre la loi de 2010 fixant l’âge de départ à 62 ans.
Or, la loi de 2023 a profondément modifié celle de 2010. Les décrets de 2011, pensés pour appliquer un âge de départ plus précoce, se retrouvent donc en contradiction directe avec la nouvelle loi, qui impose un âge plus tardif (64 ans). Et c’est là la règle fondamentale : un décret doit toujours rester conforme à la loi en vigueur. Si ce n’est pas le cas, il devient automatiquement illégal.
Cela signifie qu’un décret de 2025 qui abrogerait celui de 2023 aboutirait à ressusciter un texte réglementaire de 2011 incompatible avec la loi actuelle. Et parce qu’un décret illégal ne peut subsister, il serait inévitablement annulé par le Conseil d’État.
Une double copie du calendrier
Et s’il suffisait d’abroger ou de suspendre seulement un article, pour mettre à l’arrêt la réforme ? L’article 1er du décret du 3 juin 2023 prévoit en effet très précisément le relèvement de l’âge d’ouverture des droits pour les travailleurs nés du 1er septembre 1961 au 1er janvier 1968 :
– Soixante-deux ans pour les assurés nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961 inclus ;
– Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 inclus ;
– Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1962 ;
– Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1963 ;
– Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1964 ;
– Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1965 ;
– Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1966 ;
– Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1967 ;
– Soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968.
Abroger ou suspendre simplement l’article 1er du décret — et donc ce calendrier — permettrait-il de décaler cette progressivité, et donc de retarder la mise en œuvre de la réforme en attendant l’abrogation de la loi de 2023 sur les retraites par le Parlement ? Rien n’est moins sûr puisque la loi de 2023 est elle-même suffisamment précise en la matière.
D’abord, elle prévoit que l’âge d’ouverture du droit à une retraite est fixé à 64 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968. Surtout, la loi précise que cet âge est fixé pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération, c’est-à-dire par an. En gros, puisque le décret ne fait que reproduire autrement le texte de la loi, abroger le décret ne supprime pas la loi et donc n’agit pas sur l’âge de retraite.
Ainsi, même en abrogeant le décret d’application de la réforme des retraites, les caisses de retraite seraient tenues d’appliquer l’augmentation progressive de l’âge de départ à la retraite, puisqu’elle apparaitrait toujours dans la loi.
[Cet article est une republication d’un précédent surlignage de juillet 2024, mise à jour pour refléter le contexte politique et social actuel]