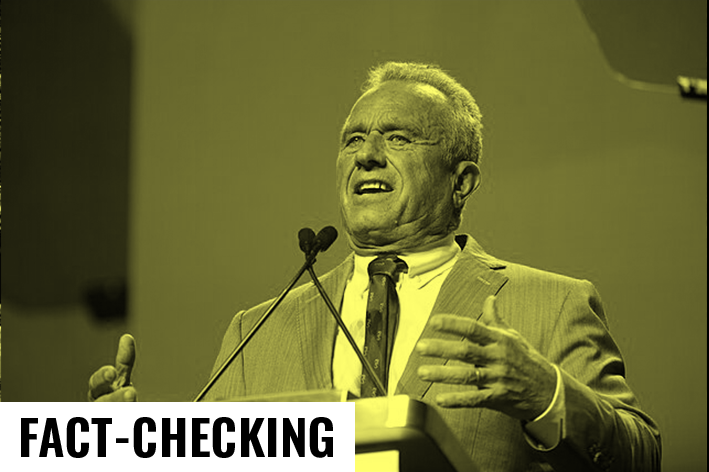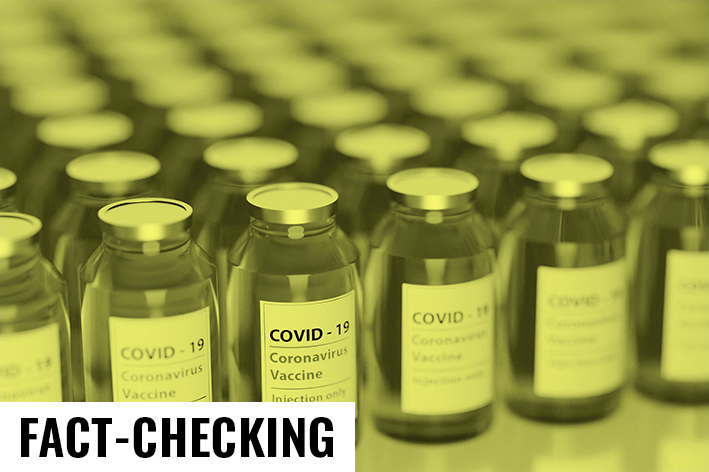La maladie de Lyme n’a pas été créée dans un laboratoire militaire
Auteur : Nicolas Kirilowits, journaliste
Relecteur : Nicolas Turcev, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste
Source : Compte Facebook, le 1er février 2025
La rumeur, alimentée par le ministre de la Santé états-unien, n’est étayée par aucune preuve solide et souffre d’incohérences temporelles, d’après les chercheurs.
Les fake news médicales ont trouvé leur nouveau porte-voix. Depuis la nomination de Robert F. Kennedy Jr. au poste de ministre de la Santé aux États-Unis, toute une série de fausses informations, dont le libertarien est très friand, connaît une nouvelle jeunesse sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles concerne la maladie de Lyme, qui aurait été fabriquée par un laboratoire militaire américain, selon certaines publications.
« RFK Jr. a raison lorsqu’il dit que la maladie de Lyme a été créée comme arme biologique dans un laboratoire de Plum Island, juste au large de la côte du Connecticut », affirme un utilisateur de Facebook.
En France, cette théorie a été relayée par le décrié professeur Christian Perronne, démis de ses fonctions au sein de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) en décembre 2020, à la suite de la publication, à l’été 2019, d’un livre sur la maladie de Lyme.
Dans une émission sur RMC, diffusée en août 2020, le médecin reprend à son compte (à partir de 12’05) cette hypothèse, et cite le livre de l’autrice scientifique Kris Newby, paru quelques semaines avant le sien, intitulé L’histoire secrète de la maladie de Lyme et des armes biologiques (non traduit, 2019).
Pas de preuves directes
Kris Newby était l’invitée, en janvier 2024, du podcast tenu par Robert F. Kennedy Jr, dans lequel elle relaye la théorie de l’invention par les États-Unis de la maladie de Lyme. Pourtant, contactée par Les Surligneurs, l’autrice affirme elle-même qu’elle n’a trouvé « aucune preuve que la bactérie de la maladie de Lyme a été utilisée comme arme biologique ».
« Mon hypothèse, exposée dans le livre, est qu’il pourrait y avoir eu un ou plusieurs organismes, très proches de la bactérie de Lyme, qui causaient des maladies dans le Connecticut à la fin des années 1960 », nous précise-t-elle, tout en accusant le gouvernement américain d’avoir « bel et bien tenté d’utiliser d’autres bactéries, comme celle de Lyme, comme armes ».
Mais d’où proviennent ces informations ? Kris Newby indique dans une interview à un magazine américain qu’« un ami documentariste » lui a envoyé « une cassette de confessions de Willy Burgdorfer [le chercheur qui a découvert le germe responsable de la maladie de Lyme, ndlr] dans laquelle il affirme que l’épidémie autour de Lyme, dans le Connecticut [un cluster s’y est formé en 1975, ndlr], était due à une arme biologique ».
Cette séquence est-elle consultable ? « Un réalisateur travaille sur un documentaire sur mon livre, il ne souhaite donc pas la rendre publique pour l’instant », nous confie Kris Newby, qui assure avoir eu accès aux archives personnelles de Willy Burgdorfer, décédé en 2014 des complications de la maladie de Parkinson.
Une vieille bactérie
La théorie de l’arme biologique tient-elle vraiment la route ? Le département de la Sécurité intérieure états-unien écrit sur son site que les scientifiques du centre de Plum Island, cité dans les publications en ligne, « ne font pas et n’ont pas fait de recherches sur la maladie de Lyme ». Mais surtout, l’hypothèse partagée par Robert F. Kennedy Jr. ne tient pas pour des raisons de calendrier, selon différents travaux.
Si la maladie transmise par des tiques a bien été « isolée pour la première fois chez une tique du genre Ixodes en 1982 », rappelle l’Institut Pasteur, et observée initialement dans la ville de Lyme, dans le Connecticut, dans les années 70, la bactérie à la base de la maladie a été découverte bien avant la création du centre de Plum Island, au milieu du XXe siècle, comme le prouvent de nombreuses études et articles (lien 1, lien 2, lien 3, lien 4, lien 5).
« La bactérie responsable de la maladie de Lyme a été trouvée dans des restes de tiques sur le corps de spécimens de souris collectés à Long Island [à quelques kilomètres de la ville de Lyme, ndlr] dans les années 1800 ; il est donc évident que la bactérie était présente bien avant que quelqu’un ne pense à fabriquer des armes biologiques ou n’en ait la capacité », décrypte le professeur Eugene Shapiro de l’école de médecine de Yale, auteur d’un article sur les nombreuses infox qui entourent la maladie.
Une arme biologique peu efficace
Aussi, la maladie de Lyme ne serait pas une arme biologique très efficace. « Elle rend certaines personnes très malades, mais beaucoup de gens atteints ne manifestent que des symptômes grippaux combattus par leur système immunitaire. Des cas non traités peuvent développer de l’arthrite et des problèmes neurologiques. Mais la maladie est rarement mortelle. Sa période d’incubation est d’une semaine : c’est trop lent pour être une arme biologique efficace », assure Sam Telford, professeur en maladies infectieuses à l’université de Tufts, dans un article paru sur The Conversation.
Même son de cloche pour François Renaud, professeur honoraire à Lyon 1, qui écrit à ce sujet, sur le blog Ouvry, que la bactérie « ne se transmet pas directement d’un homme à un autre, mais uniquement par morsure de tique dont l’efficacité de transmission est pratiquement nulle en cas d’extraction de l’acarien dans les premières heures. […] On peut donc mieux faire comme arme biologique ! »
« Il faudrait pouvoir infecter un très grand nombre de tiques, les distribuer, espérer qu’elles piqueront et infecteront les gens, et que ces derniers ne se contenteront pas d’identifier et d’enlever les tiques. [Ce serait] une arme extrêmement inefficace, si tant est qu’elle puisse être considérée comme une arme ! », ironise Eugene Shapiro.
Selon des données de Santé publique France, environ 40 000 personnes sont diagnostiquées chaque année en France de la maladie de Lyme. Environ 700 cas entraînent une hospitalisation, soit un peu moins de 2 % des malades.