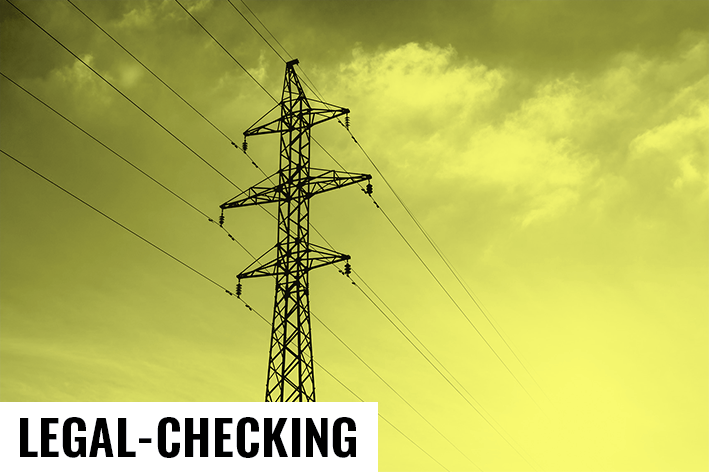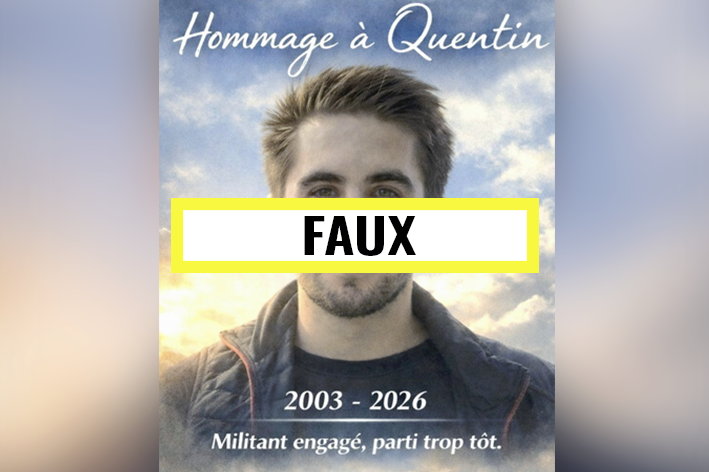Le devoir de vigilance à l’épreuve de la justice : comment la peur du contentieux façonne la politique européenne
Auteurs : Solweig Peron Redon, étudiante en Master droit européen à l’Université Paris Est Créteil
Etienne Merle, journaliste
Relecteurs : Sarah Auclair, doctorante en droit public à l’Université Paris Est Créteil
Vincent Couronne, docteur en droit européen, enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Rejeté de justesse par le Parlement européen, le compromis sur la directive « devoir de vigilance » illustre les fractures politiques ouvertes par le Green Deal. Mais derrière ce bras de fer partisan se joue un autre combat : celui du champ d’action du politique face à la montée de la justice climatique.
Tout semblait ficelé. Le 13 octobre 2025, la commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté, à la majorité du PPE, de Renew et des Socialistes et démocrates (S&D), un compromis sur la directive « devoir de vigilance » (CS3D), censé rendre les grandes entreprises plus responsables des atteintes aux droits humains et à l’environnement dans leurs chaînes de valeur.
Présenté comme un « paquet de simplification », le texte allégeait les obligations des grandes entreprises, au nom de la compétitivité et de la stabilité législative – un net recul, selon ses détracteurs, par rapport à la version de 2024, qui faisait du devoir de vigilance l’un des piliers du Green Deal, ce « pacte vert européen » qui doit conduire le continent vers la neutralité carbone d’ici 2050.
Mais à Strasbourg, le 22 octobre, tout a vacillé. À bulletin secret, neuf voix
...












 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents