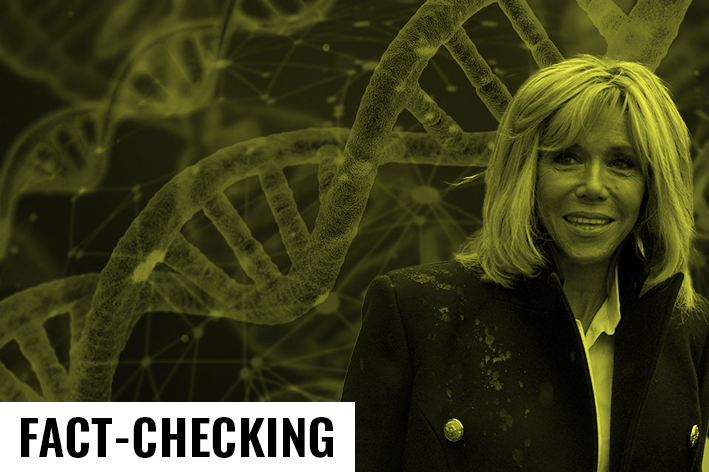La justice restaurative peut-elle concerner un terroriste comme Salah Abdeslam ?
Autrice : Kayliz Soeroastro, étudiante en M1 Métiers du Droit et action publique à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’Université de Lorraine
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article :
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Riss, France info, le 12 novembre 2025
Le directeur de Charlie Hebdo, Riss, s’oppose à la démarche de justice restaurative engagée par Salah Abdeslam, estimant qu’une personne condamnée pour terrorisme ne peut en bénéficier puisqu’elle ne relèverait pas du droit commun. Pourtant, la loi n’exclut pas ces infractions du dispositif.
À l’heure des hommages rendus pour les dix ans des attentats du 13 novembre, la démarche de justice restaurative engagée par Salah Abdeslam fait irruption dans le débat public, suscitant la vive opposition de Riss, dessinateur et directeur de Charlie Hebdo.
Selon l’avocate de Salah Abdeslam, Olivia Ronen, le terroriste condamné à la perpétuité « aimerait pouvoir expliquer un peu la situation et, peut-être, discuter, ouvrir une porte aux parties civiles », explique-t-elle sur France info le 11 novembre 2025,
Mais cela n’est pas du goût du dessinateur. « La justice restaurative c’est quelque chose qui existe pour d’autres types de crimes, délinquance, violences, pour les crimes de droit commun. Or, le terrorisme, ce n’est pas un crime de droit commun », balaie celui qui a lui-même été victime des attentats de janvier 2015, au micro de France info le lendemain, jugeant la démarche « perverse ».
Si Riss peut tout à fait critiquer la démarche engagée par Salah Abdeslam, rien dans la loi ne lui donne raison : le terrorisme n’est pas exclu du champ de la justice restaurative.
La justice restaurative est applicable aux crimes de terrorisme
La mise en place concrète de la justice restaurative reste encore balbutiante en France. Cette justice restaurative est différente de la constitution de partie civile, laquelle permet à la personne qui se dit être victime d’une infraction de demander réparation, voire de mettre en mouvement l’action publique, sous certaines conditions.
La justice restaurative ne vise quant à elle ni la réparation ni la condamnation. Il s’agit d’un processus non juridique qui cherche à apaiser le trouble causé par l’infraction en permettant, par exemple, aux auteurs et aux victimes de se comprendre. La première expérimentation de rencontres entre détenus et victimes n’a eu lieu qu’en 2010, à la maison centrale de Poissy.
Et ces démarches n’excluent aucune infraction. Les exemples sont nombreux. À l’étranger, on pense à la pratique canadienne ou à la justice transitionnelle au Rwanda. Il peut également s’agir de rencontres victimes – détenus.
En France, les mesures de justice restaurative sont variées. On en trouve différents exemples dans le guide méthodologique du ministère de la Justice.
Droit spécial
Les infractions de nature terroriste font l’objet d’un droit spécial qui se manifeste par des règles dérogatoires : allongement de la durée de la garde à vue, régime spécial pour les perquisitions, mise sur écoute sans consentement des intéressés, recours aux techniques spéciales d’investigation, existence d’un parquet national antiterroriste, compétence de juridictions spécialement composées et règles particulières pour l’exécution des peines, notamment.
Pour autant, malgré ce droit spécial, l’article 10-1 du code de procédure pénale, créé par la loi Taubira de 2014, n’empêche pas de recourir à une mesure de justice restaurative en matière de terrorisme. Le premier alinéa de cet article prévoit en effet qu’une mesure de justice restaurative peut être proposée à l’auteur et à la victime d’une infraction à l’occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l’exécution de la peine.
Toutefois, comme précisé par le ministère de la Justice (guide méthodologique), l’application de la justice restaurative aux actes de terrorisme nécessite une attention « toute particulière ». Mais cette exigence de prudence n’altère pas le cœur du dispositif : restaurer le lien social, et apaiser la victime, longtemps absente du processus juridique.
Cercles de parole ou rencontres directes ou indirectes poursuivent trois objectifs : responsabiliser l’auteur de l’infraction, contribuer à la réparation pour la victime et prévenir la récidive.