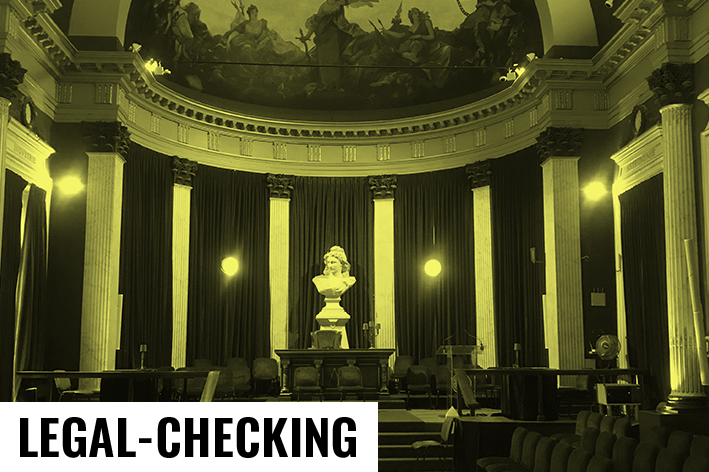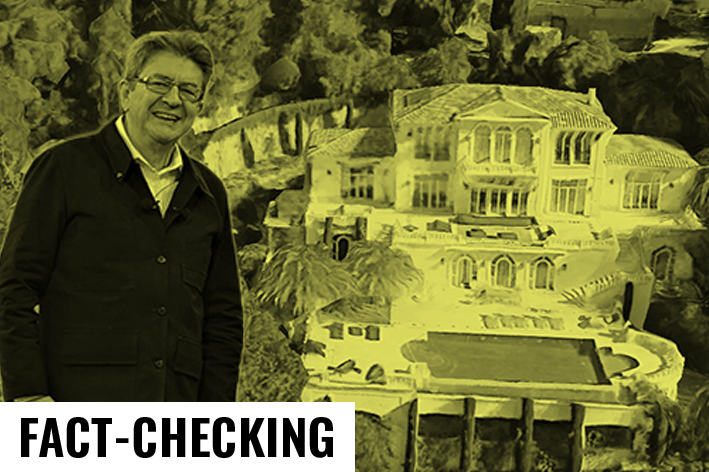Bruno Retailleau veut constitutionnaliser un principe déjà existant… au risque de méconnaître le droit européen
Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public, université de Poitiers
Relecteurs : Clément Benelbaz, maître de conférences en droit public, Université Savoie Mont Blanc
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Jean-Baptiste Breen, étudiant en master de journalisme à Sciences Po Paris
Source : Bruno Retailleau lors d'une conférence de presse dans les Hauts-de-Seine le 26 mai 2025
Bruno Retailleau souhaite inscrire dans la Constitution l’interdiction de se prévaloir de sa religion, de ses croyances ou de ses origines pour échapper à la règle commune. Une proposition avant tout symbolique, qui soulève deux questions : est-elle juridiquement utile ? Et surtout, est-elle compatible avec le droit européen, qui impose un équilibre entre liberté religieuse et intérêt général ?
Dans le sillage d’un rapport sur l’influence des Frères musulmans en France, Bruno Retailleau entend passer à l’action. Le ministre de l’Intérieur propose un nouvel outil constitutionnel pour renforcer l’autorité des principes républicains : inscrire noir sur blanc dans la Constitution que « nul ne peut se prévaloir de sa religion, de ses croyances ou de ses origines pour échapper à la règle commune ». Une formule qui résonne déjà aux oreilles des juristes, et qui mérite d’être replacée dans son cadre juridique.
Un principe déjà reconnu par le Conseil constitutionnel
Cette formule n’est pas nouvelle. Elle a été consacrée dès 2004 par le Conseil constitutionnel, qui, à partir de l’article 1er de la Constitution – « La France est une République laïque » – a dégagé un principe clair : il est interdit à quiconque d’invoquer ses croyances religieuses pour se soustraire aux règles communes. Le texte fondamental ajoute d’ailleurs que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
En somme, le droit constitutionnel français consacre déjà ce principe d’indivisibilité de la norme républicaine, au-dessus de toute considération religieuse.
Une application souple dans la jurisprudence
Mais dans la réalité, le droit n’est pas toujours rigide. Les juridictions adoptent une approche nuancée, au cas par cas. En 2020, le Conseil d’État s’est penché sur la question des repas différenciés à la cantine. Il a rappelé l’interdiction de s’exempter des règles communes au nom de convictions religieuses, tout en admettant la possibilité d’aménagements, à condition qu’ils ne compromettent pas le bon fonctionnement du service public.
Même logique du côté de la Cour de cassation. En 2022, sa chambre sociale a précisé que les restrictions à la liberté religieuse dans l’entreprise devaient être « justifiées par la nature de la tâche à accomplir », « répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante » et rester « proportionnées au but recherché ». En clair : le juge cherche à concilier convictions personnelles et exigences professionnelles.
La proposition de Bruno Retailleau vise-t-elle à graver dans le marbre un principe déjà existant, ou bien à restreindre la marge d’appréciation du juge en uniformisant l’interprétation ? Contacté, le ministère de l’Intérieur n’a pas répondu à cette question. Mais les implications d’un tel projet pourraient aller bien au-delà du cadre national.
Un obstacle de taille : le droit européen
Car du côté européen, la jurisprudence est claire. En 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a posé une exigence : avant de prendre des mesures comme un licenciement, une entreprise doit s’efforcer de concilier les exigences professionnelles avec la liberté religieuse de ses salariés. Cette décision a depuis inspiré la jurisprudence française.
Une révision constitutionnelle qui viserait à effacer toute possibilité d’accommodement au nom des croyances personnelles risquerait donc de se heurter au droit européen. Une ligne de crête que le gouvernement devra soigneusement baliser.