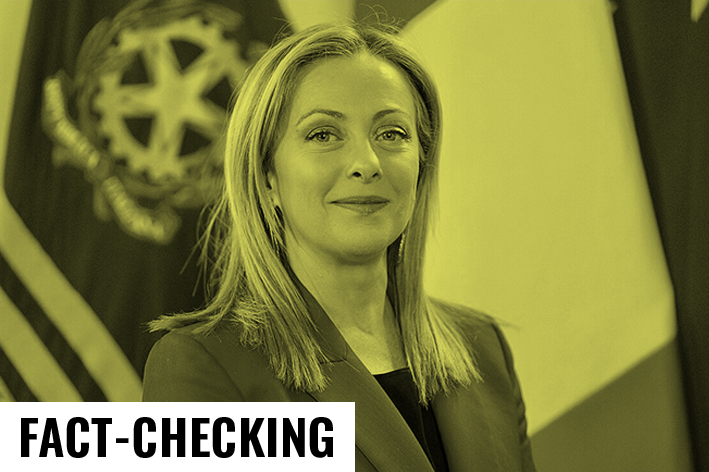Union européenne : un détournement de 723 milliards d’euros ? C’est faux !
Auteur : Nicolas Kirilowits, journaliste
Relecteur : Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clarisse Le Naour, double cursus L3 science politique et L3 droit public à l’université Lumière Lyon II
Source : Compte Facebook, le 25 juin 2025
Lancé en 2021, le plan de relance post-Covid de la Commission européenne est régulièrement critiqué pour son manque de transparence, notamment par la Cour des comptes européenne. Mais contrairement à ce qu’affirment certaines publications sur Facebook, une telle somme n’a « disparu » et l’idée d’un détournement massif relève, pour l’heure, de l’intox.
La justice virtuelle et numérique est sans appel : l’Union européenne est coupable. Son crime ? Avoir détourné les 723 milliards d’euros du plan de la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR), le grand plan de relance économique adopté par l’Union européenne en 2020, après la crise du Covid-19. « L’argent des peuples file dans les poches des copains », dénonce une publication sur Facebook.
L’accusation a été reprise le 25 juin par Angélique Furet, eurodéputée Rassemblement national, sur ses réseaux sociaux. « Mais où sont donc passés les 723 milliards, Madame Von der Leyen ? » écrit-elle sur Facebook, avançant que « l’argent a été distribué, à on ne sait pas qui, pour faire on ne sait pas quoi », en citant la Cour des comptes européenne comme caution à son propos.
Une charge lourde contre l’UE et ses institutions. Mais est-elle fondée ? Nos vérifications révèlent de nombreuses approximations. Parler d’argent « envolé » ou « disparu » relève de la désinformation. Les experts interrogés par Les Surligneurs sont formels : si la transparence laisse à désirer, une telle somme ne s’est pas volatilisée. Explications.
De mauvais chiffres
Quelques précisions d’abord. Le chiffre de 723 milliards d’euros, souvent cité, n’est pas à jour. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes européenne – chargée de surveiller l’utilisation de l’argent public de l’UE – rappelle que le budget prévu au départ était bien de 724 milliards. Mais finalement, les États membres n’ont demandé que 650 milliards : 359 milliards sous forme de subventions, et 291 milliards sous forme de prêts.
« Certains États n’ont pas choisi d’utiliser tous les prêts auxquels ils avaient droit », précise aux Surligneurs Peter Teffer, journaliste d’investigation membre de la plateforme Follow the Money, qui a enquêté sur le plan de relance européen. Or, refuser un prêt, ce n’est évidemment pas avoir à le rembourser.
Selon les données de la Commission européenne, depuis le lancement du plan en 2021, près de 62 % des subventions prévues (220 milliards d’euros) ont été versées aux États membres, et un peu moins de 50 % des prêts (141 milliards d’euros) ont été débloqués.
Autrement dit, à l’été 2025, la vraie question ne porte pas sur 723 ou 724 milliards, mais bien sur les 361 milliards d’euros déjà dépensés : le reste n’a tout simplement pas encore été débloqué. Ces précisions numéraires faites, reste à éclairer le débat sémantique.
Problèmes de transparence
Aucun des documents consultés ni les experts interrogés par Les Surligneurs, ne reprennent le vocabulaire acerbe employé par les publications. Le rapport de la Cour des comptes européenne n’est pourtant pas avare en critiques vis-à-vis de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience.
Contactée par Les Surligneurs, la Cour « regrette notamment le fait que le citoyen européen peut difficilement savoir à quoi son argent a réellement servi ». Mais jamais elle ne se réfère à des sommes disparues, envolées ou un quelconque détournement de fonds organisé par l’UE.
« Dire qu’il y a une absence totale de contrôle, c’est faire une interprétation totalement fausse des évaluations de la Cour des comptes », assène Eulalia Rubio chercheuse à l’Institut Jacques Delors, spécialiste des questions économiques européennes.
« Il est exagéré de dire que les milliards de la FRR ont complètement ‘disparu’ et que tout le monde ignore où cet argent est passé. Pourtant, il est vrai que, depuis le départ, la transparence de ce programme pose des problèmes », indique pour sa part Peter Teffer.
Des sources publiques insuffisantes
Dans les faits, la Commission européenne met à disposition un tableau de bord public, qui retrace les données et actualités liées à la FRR, ainsi qu’une carte des projets financés. Une « carte des projets soutenus par la facilité pour la reprise et la résilience » est également consultable en ligne. Par ailleurs, chaque État membre doit publier la liste des 100 plus grands bénéficiaires du plan de relance.
Peter Teffer rappelle toutefois que ces informations restent partielles : « Le total communiqué sur les bénéficiaires ne représente que 121 milliards d’euros, soit à peine un tiers des 361 milliards déjà versés aux États membres ». Le journaliste a d’ailleurs publié de nombreux articles mettant en cause l’opacité de ces financements.
En France, cette mission revient au ministère de l’Économie et des Finances, qui met en ligne un fichier Excel. On y découvre, sans détails supplémentaires, que Bpifrance figure largement en tête des bénéficiaires, avec plus de 2 milliards d’euros reçus.
Le document recense 8,3 milliards d’euros de versements, alors que la France a perçu 34 milliards d’euros au total. Ce décalage peut sans doute nourrir le sentiment de manque de transparence. D’ailleurs, les eurodéputés ont demandé dans une résolution que « la transparence et la traçabilité de l’utilisation des fonds européens soient renforcées ».
« Les raisons de ce manque de transparence sont multiples : d’abord politiquement, ce n’est pas la priorité. La priorité est donnée par les États membres au décaissement de l’argent du plan de relance », analyse Kévin Gernier, responsable de plaidoyer pour Transparency International France. Avant d’évoquer aussi des « obstacles techniques » et une crainte des États membres « liée à leur souveraineté et leur compétitivité ».
En pratique, ce manque de transparence ne signifie pas que l’argent s’est évaporé, mais qu’il est difficile pour les citoyens de savoir clairement quels projets ont été financés, dans quelles proportions et avec quels résultats, ce qui complique l’évaluation réelle de l’efficacité du plan. Un déficit d’information qui demeure préoccupant et peut légitimement alimenter les inquiétudes des citoyens.