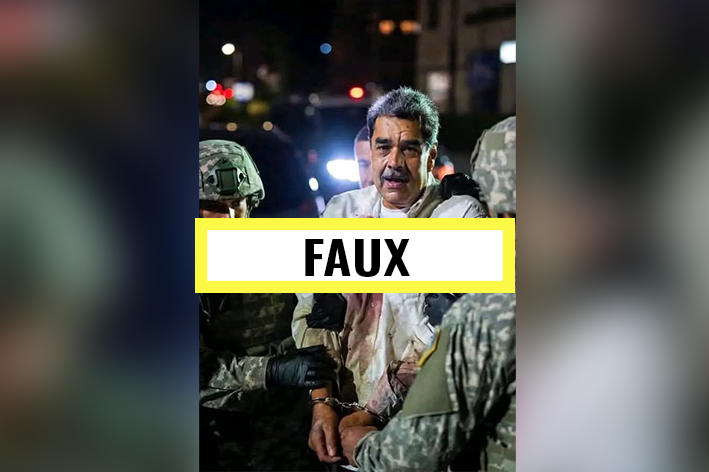Retraite additionnelle des fonctionnaires : les approximations de Gabriel Attal et Sandrine Rousseau
Auteur : Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social à l’université de Nantes
Relecteur : Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Emission L'évènement sur France 2, le 3 avril 2025
Le débat entre Gabriel Attal et Sandrine Rousseau sur la RAFP a tourné à la confusion juridique. Ni l’un ni l’autre n’ont correctement décrit ce régime obligatoire, fondé sur la répartition provisionnée.
Un face-à-face, deux approximations. À l’occasion de l’émission de France 2 « Modèle social : la France dans l’impasse » (29’) ce jeudi 20 novembre, Gabriel Attal et Sandrine Rousseau ont ferraillé autour des retraites : répartition contre capitalisation.
Lorsque la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) entre dans la discussion, l’ancien premier ministre provoque la députée de Paris : en tant que fonctionnaire, affirme-t-il, elle bénéficie déjà d’un régime par capitalisation. Réplique immédiate de Sandrine Rousseau : « On n’est pas obligé de le prendre. » Problème, ces déclarations sont juridiquement inexactes… l’une comme l’autre.
Répartition ou capitalisation : de quoi parle-t-on déjà ?
Les régimes de retraite français sont organisés selon deux grandes techniques de gestion. D’un côté, la répartition : les cotisations versées par les actifs servent à payer immédiatement les pensions des retraités. Ce système repose sur la solidarité intergénérationnelle et pose la question d’un équilibre financier entre cotisants et bénéficiaires.
De l’autre, la capitalisation : les cotisations sont épargnées pour produire des intérêts selon les investissements faits et constituer un capital qui sera utilisé plus tard pour financer la retraite de l’assuré.
La retraite additionnelle des fonctionnaires : un système obligatoire
En vigueur depuis 2005, à la suite à la réforme Fillon des retraites de 2003, la RAFP (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) est un régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires d’État, territoriaux et hospitaliers.
Elle est financée par des cotisations (5 % employeur, 5 % agent soit 10 %) prélevées seulement sur les primes et indemnités qui ne sont justement pas prises en compte dans leur retraite principale.
Ces cotisations sont converties en points (1,4394 € vaut 1 point dit « d’achat » en 2025). Lorsque l’agent part en retraite, ses points sont à nouveau convertis en euros (1 point “de service” vaut alors 0,05593 €).
Les chiffres de ces conversions évoluent régulièrement. Le nombre de points détermine alors si le fonctionnaire retraité reçoit un capital en une seule fois (s’il a jusqu’à 5124 points) ou une pension mensuelle (s’il a au moins 5125 points) dont le montant varie selon un savant calcul mêlant le nombre de points, l’âge de départ en retraite et la valeur du point au moment de ce départ.
Or, ce régime est légalement obligatoire depuis sa création : les cotisations sont prélevées par l’employeur public de l’agent avant le versement de son traitement. Un fonctionnaire ne peut s’y opposer. Seuls certains agents (fonctionnaires de l’Etat, les magistrats et les militaires) peuvent cotiser volontairement à ce régime pour la durée de leur service, après leur prise de poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie… ce qui n’est a priori pas le cas de Sandrine Rousseau.
Il est fort probable que la députée de Paris ait confondu la RAFP avec la PREFON. Celle-ci est un régime de retraite complémentaire facultatif créé en 1968 et spécifiquement ouvert aux agents publics (fonctionnaires, agents contractuels, militaires, anciens agents, conjoints d’affiliés, etc.).
Il s’agit d’un produit d’épargne retraite volontaire, donc facultatif, qui fonctionne par capitalisation stricte. Les cotisations sont faites seulement par l’agent, sur la base d’un prélèvement ou de versements volontaires, directement depuis son compte bancaire.
La RAFP : un régime par répartition provisionnée
Gabriel Attal a-t-il raison quand il parle de capitalisation pour la RAFP ? Certitude : celle-ci ne fonctionne pas par répartition immédiate. L’argent cotisé par un fonctionnaire en activité n’est pas immédiatement reversé aux agents à la retraite.
Les cotisations sont placées sur les marchés financiers dans un portefeuille d’actifs (actions, obligations, etc.) par l’établissement public ERAFP, selon un principe d’investissement socialement responsable (ISR) prenant en compte le développement durable.
Mais un tel placement collectif ne signifie pas forcément un régime par capitalisation stricte comme le sont les Plans d’épargne retraite (PER individuel ou PER d’entreprise collectif), les contrats d’assurance vie retraite. Pour ceux-ci, l’épargnant récupère exactement la somme accumulée auxquels s’ajoutent les rendements financiers moins d’éventuels frais.
Or, le législateur de 2003 a lui-même juridiquement qualifié la RAFP de « régime par répartition provisionnée » et pas de capitalisation, comme le dit Gabriel Attal. En effet, un euro cotisé ne donne pas un euro perçu plus les intérêts du seul placement, comme le montre la conversion par points précédemment exposée. C’est le conseil d’administration de l’ERAFP qui revalorise chaque année la valeur du point d’achat comme de service, en prenant en compte les « exigences prudentielles applicables au régime ».
Ni régime par capitalisation, ni dispositif facultatif : la retraite additionnelle des fonctionnaires (RAFP) est un régime obligatoire fondé sur la répartition provisionnée. Et le court débat entre Gabriel Attal et Sandrine Rousseau aura visiblement suffi à faire dérailler la précision juridique.