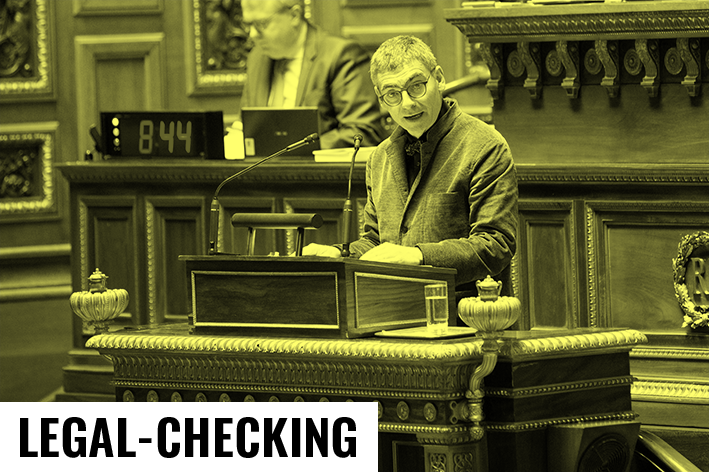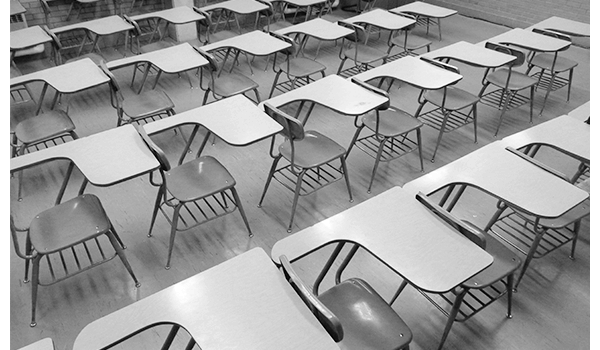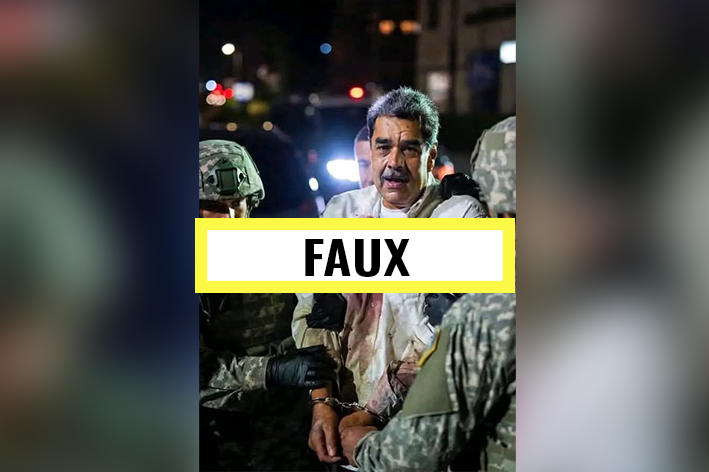Prière dans les écoles privées sous contrat : un droit… vraiment ?
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris Saclay
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Compte X d'Anne Coffinier-Barry, le 10 novembre 2025
Selon Anne Coffinier-Barry, la présidente de la fondation Kairos, les établissements privés sous contrat seraient fondés sur la liberté de conscience, et leur « caractère propre » inclurait le droit d’organiser des prières, y compris pendant le temps dédié aux programmes scolaires officiels. Problème : ce n’est pas ce que dit le droit.
On savait déjà que certains établissements privés sous contrat avaient la foi. On découvre maintenant qu’ils auraient aussi un droit divin à faire prier les élèves pendant les temps scolaires financés par l’État.
Le 10 novembre 2025, Anne Coffinier-Barry, qui se proclame « experte en éducation », fondatrice de la Fondation Kairos–Institut de France et présidente de l’association Créer son école, publie sur X un message très tranché : les établissements privés sous contrat ne seraient pas un « service bis » de l’école publique, mais reposeraient sur la liberté de conscience, et leur « caractère propre » serait un droit, ce qui inclurait donc « la prière ».
Ce message, accompagné d’une vidéo de son intervention sur la chaîne Cnews, se veut une réponse aux déclarations du ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, tenues lors d’une commission des Affaires culturelles à l’Assemblée nationale, quelques jours plus tôt : « Lorsque l’État paie un professeur, il le paie pour enseigner. Ça me semble l’évidence. Donc une minute payée par l’État, c’est une minute d’enseignement, ça ne sert pas à autre chose. Et donc je ne vois pas comment sur un temps d’enseignement, on pourrait faire une prière ».
Anne Coffinier-Barry ne dit pas textuellement que la prière en classe doit être autorisée. Mais en invoquant le « caractère propre » et la « liberté de conscience » en réponse directe à une déclaration du ministre sur le temps d’enseignement financé par l’État, elle laisse entendre que ces établissements pourraient organiser des prières dans ce cadre-là. Ce flottement mérite d’être clarifié par le droit.
Confusion entre liberté de conscience et caractère propre
D’entrée de jeu, Anne Coffinier-Barry confond le caractère propre d’une école privée — à savoir, lorsque c’est le cas, le caractère confessionnel — et le principe de liberté de conscience, qui profite à tous les élèves. Contrairement à ce que sous-entend cette « experte en éducation », les contrats passés entre l’État et certaines écoles privées ne confèrent aucun un droit à la prière en classe. C’est même l’inverse.
C’est la « loi Debré » de 1959 qui met en place les contrats d’association entre l’État et les établissements privés d’enseignement qui le souhaitent, et qui au demeurant ne sont pas tous confessionnels. Elle se retrouve aujourd’hui dans le code de l’éducation, en des termes on ne peut plus clairs.
Il est important de citer l’article en question : « Dans les établissements privés qui ont passé (un contrat), l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. L’établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ».
Il en résulte d’abord que certes, un établissement d’enseignement privé, même s’il a conclu un contrat avec l’État, peut conserver son « caractère propre », en l’occurrence confessionnel. Cela signifie qu’il peut dispenser des cours religieux ou philosophiques conformes à son orientation.
Mais, ensuite, les enseignements délivrés dans ces établissements se font sous le contrôle de l’État, qui veille à ce que les enseignements ou activités « propres » se fassent sur des heures différentes des heures de cours obligatoires, sous peine de voir le contrat, et les financements qui vont avec, être remis en cause.
Or, on rappelle que l’État prend en charge l’intégralité des salaires des enseignants, ainsi que leur retraite, et que le principe de laïcité (article 1er de la Constitution) interdit que ces sommes soient consacrées à de la prière, ne fut-ce que quelques minutes. Enfin, les contrats d’association comportent une autre contrepartie légale : « Tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyances, y ont accès ». Si on autorisait la prière durant les cours, cela signifierait par exemple qu’un enfant musulman dans une école catholique serait tenu d’y assister.
Ainsi, la liberté de conscience dont se prévaut « l’experte » deviendrait, pour les enfants issus d’autres religions, une violation de leur propre liberté de conscience. Un raisonnement juridique dont on peut se demander s’il ne sert pas un objectif : faire fuir des établissements catholiques les élèves non catholiques, pour les renvoyer vers l’école publique.
En dehors des temps scolaires dédiés aux programmes, prie qui veut !
Si l’établissement privé est tenu d’observer la même neutralité et la même laïcité qu’un établissement public s’agissant des enseignements dédiés aux programmes officiels, il jouit d’une liberté concernant les activités proposées à côté, sous réserve du respect d’autres lois, notamment pénales.
En somme, si des temps de prières ou de recueillements peuvent être organisés au sein des établissements privés sous contrat, ceux-ci ne peuvent pas se substituer au temps consacré à l’enseignement ni s’imposer aux élèves.















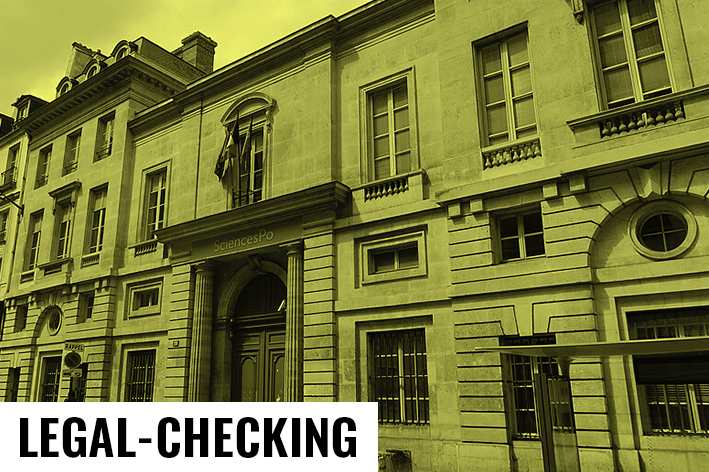
 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents