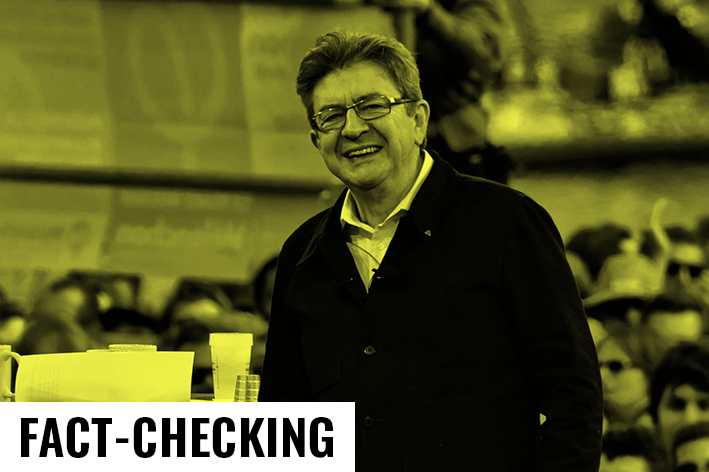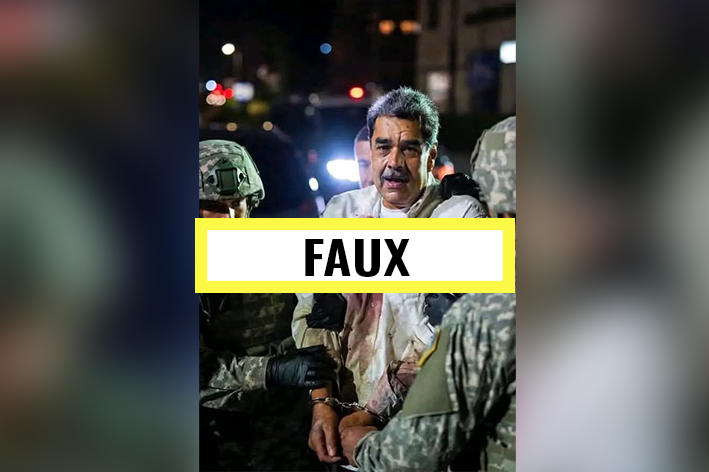Meyer Habib avait-il le droit de porter une kippa au tribunal ?
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Relecteurs : Clément Benelbaz, maître de conférences HDR en droit public à l’Université Savoie-Mont Blanc
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Publication Facebook, 31 octobre 2025
À son audience au tribunal de Paris, Meyer Habib portait sa kippa, suscitant des critiques au nom de la laïcité. Pourtant, le droit autorise les usagers du service public à afficher leurs convictions religieuses.
Un député de la nation s’est-il assis sur l’un des principes fondateurs de la République qu’il est censé représenter ? C’est ce dont sont persuadés de nombreux internautes.
Ce jeudi 30 octobre 2025, lors de son audience devant le tribunal correctionnel de Paris, Meyer Habib, ancien député des Français de l’étranger, est apparu portant une kippa. Il y poursuivait le député La France insoumise David Guiraud, qu’il accuse d’antisémitisme, après que ce dernier l’a comparé à un cochon sur les réseaux sociaux.
Mais ce n’est pas tant le procès qui a retenu l’attention que le couvre-chef religieux du plaignant. Pour certains internautes, ce port de la kippa dans une enceinte judiciaire constituerait une atteinte au principe de laïcité, censé garantir la neutralité des institutions. D’autres y voient simplement l’expression d’une liberté de religion que la République protège également.
Alors, la loi interdit-elle vraiment à un citoyen — même député — de porter un signe religieux au tribunal ?
Pas de neutralité pour les usagers du service public
Le principe de laïcité, issu des exigences de neutralité et d’égalité, garantit aux usagers qu’aucune discrimination ne sera opérée à leur égard en raison de leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Il s’impose aux agents du service public, qui doivent s’abstenir de manifester leurs croyances et respecter un devoir de réserve, selon une décision du Conseil d’État de 1935.
En revanche, ce principe ne s’applique pas aux usagers du service public. Ces derniers peuvent ainsi pénétrer dans une mairie, un tribunal ou tout autre service public en arborant un signe religieux ou politique — croix, kippa, voile, insigne de parti, etc. — sans que cela pose de difficulté.
La seule limite tient à la préservation du bon fonctionnement du service : la manifestation de convictions ne doit pas troubler l’ordre ni gêner les autres usagers. Les établissements scolaires constituent une exception, la neutralité des élèves y étant expressément prévue par la loi.
De même, les jurés dans un tribunal doivent prêter serment « debout et découverts » selon l’article 304 du code de procédure pénale, ce qui leur interdirait de porter un quelconque couvre-chef, au moins le temps de leur serment.
En l’espèce, Meyer Habib n’était pas agent du service public dans le tribunal ni juré, mais simple usager. Il pouvait donc afficher son appartenance religieuse, à condition que cela ne perturbe pas le fonctionnement du lieu — par exemple, en provoquant une désorganisation ou le départ des autres usagers.
Une situation tranchée par le juge européen
La Cour européenne des droits de l’Homme a estimé en 2017, au sujet des parties civiles, qu’il existait « un droit passif des usagers du service public de la justice de manifester leurs convictions religieuses ».
Puis, en 2018, la Cour a jugé que l’interdiction du port de vêtements religieux par des particuliers dans une salle de tribunal n’était pas justifiée, à condition que celui-ci n’entrave pas le déroulement normal du procès et ne vise pas à manquer de respect envers le tribunal.
Cela découle de l’article 9 de la Convention, qui protège « la liberté de manifester sa religion ou sa conviction […] en public ». S’il avait été interdit à Meyer Habib de porter sa kippa dans l’enceinte du tribunal, la France aurait à coup sûr été condamnée par la Cour de Strasbourg.