Une loi pourrait-elle interdire d’attaquer un projet autorisé par la préfecture ?
Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public, université de Poitiers
Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay
Etienne Merle, journaliste
Maylis Ygrand, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste
Source : Germinal Peiro, président du conseil départemental de Dordogne, le 27 mars 2025
L’abandon potentiel de l’autoroute A69 relance le débat sur le pouvoir des juges face aux projets d’infrastructures. En Dordogne, un élu propose de restreindre les recours en justice pour éviter l’annulation de chantiers pourtant validés par l’État. Une initiative qui pourrait bafouer des principes fondamentaux du droit.
La décision du tribunal administratif de Toulouse continue de faire des vagues. Alors que plus de la moitié du chantier est déjà achevée, les travaux de l’autoroute A69, reliant Castres à Toulouse, sont brusquement interrompus depuis le 27 février 2025. En cause ? L’annulation, par la justice, de l’arrêté préfectoral autorisant le projet.
Si les réactions politiques ont largement occupé l’espace médiatique, l’A69 est loin d’être un cas isolé. En 2020, un scénario similaire s’est joué en Dordogne : pour des raisons comparables, la justice a définitivement enterré le projet de contournement du village de Beynac-et-Cazenac. Résultat : de gigantesques piles restent figées dans la rivière, vestiges d’un pont qui ne verra jamais le jour.
Questionné par nos confrères de TF1, le président du conseil départemental de Dordogne, Germinal Peiro (Parti socialiste), a annoncé avoir fait adopter ces derniers jours par le conseil départemental une motion pour demander au gouvernement « de modifier le droit » pour éviter que des projets autorisés par les préfets, et donc l’État, ne soient ensuite retoqués par la justice. Pour cela, il propose de faire évoluer la loi « pour coupler la déclaration d’utilité publique avec l’autorisation environnementale », précise la communication du département aux Surligneurs.
« Je ne suis évidemment pas pour que l’on fasse n’importe quoi et qu’il n’y ait plus de précaution prise dans ce type de projet, mais il faut faire évoluer le droit pour faire en sorte qu’un projet autorisé ne puisse plus être attaqué », explique l’élu à TF1. Des propos qui posent de sérieux problèmes en droit.
Contraire au principe du droit au recours
Ce que souhaite le président du département périgourdin, c’est empêcher les opposants d’un projet de former un recours devant le juge contre l’autorisation de travaux délivrée par le préfet. Mais empêcher des personnes de saisir le juge sur des sujets qui les concernent, c’est tout simplement supprimer le droit au recours.
En 1996, le Conseil constitutionnel reconnaissait au droit au recours effectif une valeur constitutionnelle, en le déduisant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Nul doute que, si une loi venait priver les justiciables opposés à certains projets d’infrastructures de les contester, le Conseil la censurerait purement et simplement.
Et si d’aventure les sages de la rue de Montpensier ne censuraient pas une telle loi, la France serait à coup sûr condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 13 de sa Convention protège le droit de saisir un juge pour constater une violation d’un droit.
Le juge est une garantie, pas un obstacle
Germinal Peiro assimile l’autorité qui délivre l’autorisation de construire et le juge qui en contrôle la légalité à une seule « République ». S’il est vrai que ces deux autorités travaillent sous la République française, elles incarnent deux pouvoirs bien distincts. Le préfet représente l’exécutif qui applique les lois, et le juge appartient au pouvoir judiciaire qui contrôle si la loi est bien appliquée. Ainsi va l’équilibre des pouvoirs dans une séparation bien comprise.
Il n’est donc pas illogique, et même tout à fait normal dans un État de droit, que le juge donne tort au préfet si ses décisions sont illégales. Ce n’est pas aller contre les élus, c’est faire respecter la loi, à laquelle les préfets et les élus locaux sont aussi soumis.






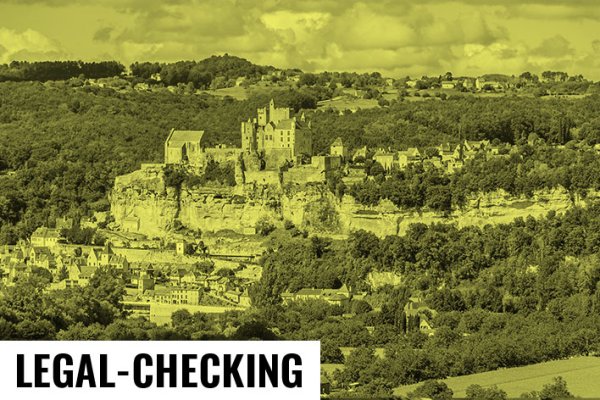








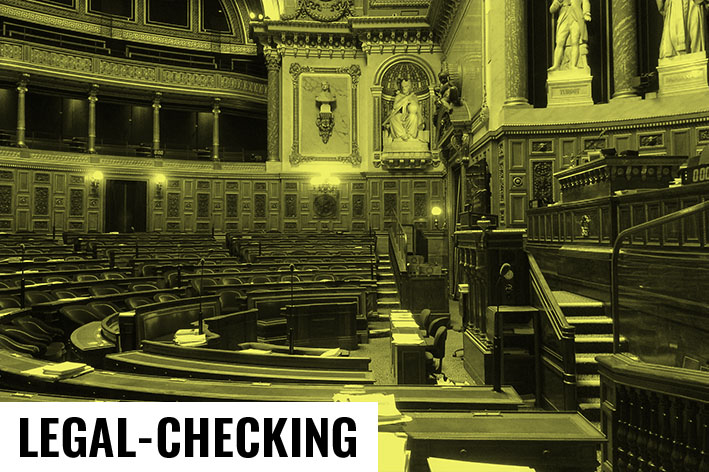
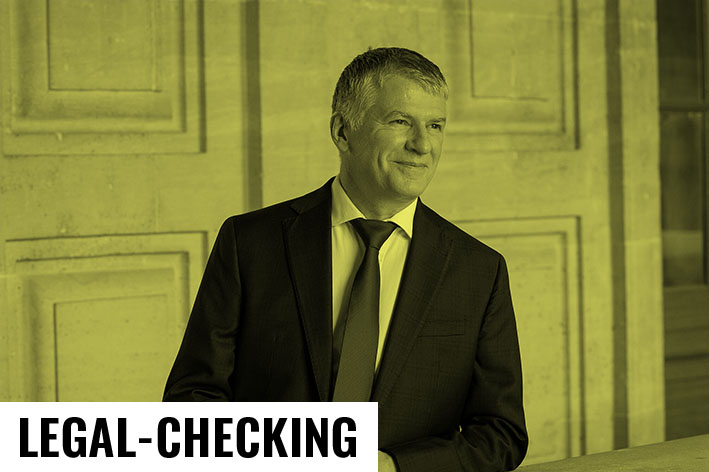
 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents


