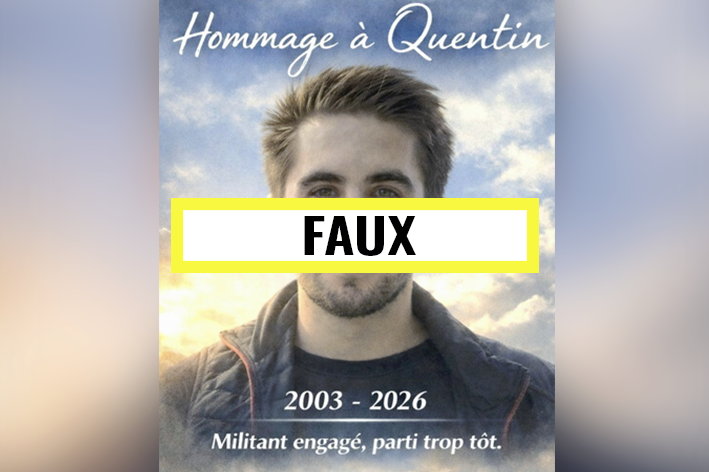Un Tribunal spécial pour l’Ukraine : une réponse à l’impunité de l’agression russe ?
Dernière modification : 4 septembre 2025
Autrice : Fanny Geiger, master Droit des libertés à l’Université de Caen
Relectrice : Maria Castillo, maîtresse de conférences en droit public à l’Université de Caen
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Fanny Velay, étudiante en journalisme à l’École W
Face à l’incapacité de la Cour pénale internationale à juger le crime d’agression en Ukraine, Kiev et le Conseil de l’Europe ont acté, le 25 juin 2025, la création d’un Tribunal spécial. Ce mécanisme inédit vise à combler les lacunes du droit international en garantissant la poursuite des responsables de l’invasion russe, malgré les blocages politiques et juridiques.
Alors que les hostilités se poursuivent sans relâche dans la guerre opposant l’Ukraine à la Russie, l’Ukraine et le Conseil de l’Europe ont officiellement acté, le 25 juin 2025, la création d’un Tribunal spécial chargé de juger le crime d’agression. Cette initiative constitue une avancée historique, puisqu’il s’agit de la première fois que le Conseil de l’Europe met en place un tel mécanisme judiciaire. Ce tribunal vise à pallier les lacunes de la Cour pénale internationale (CPI) dans un contexte où la justice internationale traditionnelle se heurte à des obstacles majeurs.
Pourquoi la CPI semble-t-elle impuissante ?
Instituée en 2002, la CPI vise à lutter contre l’impunité des auteurs des crimes internationaux les plus graves, en complétant les juridictions nationales défaillantes ou inactives. Dans le cas de l’Ukraine, la CPI est compétente pour enquêter et poursuivre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis,
...












 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents