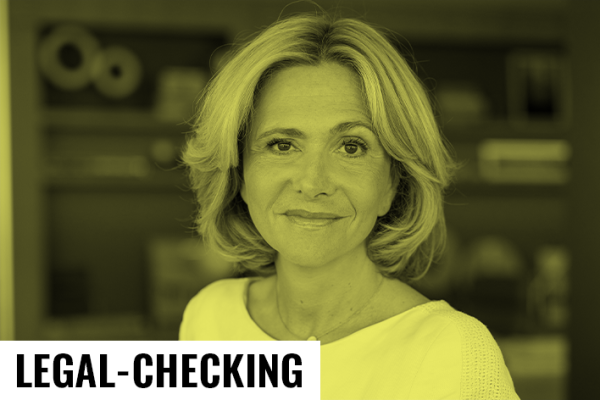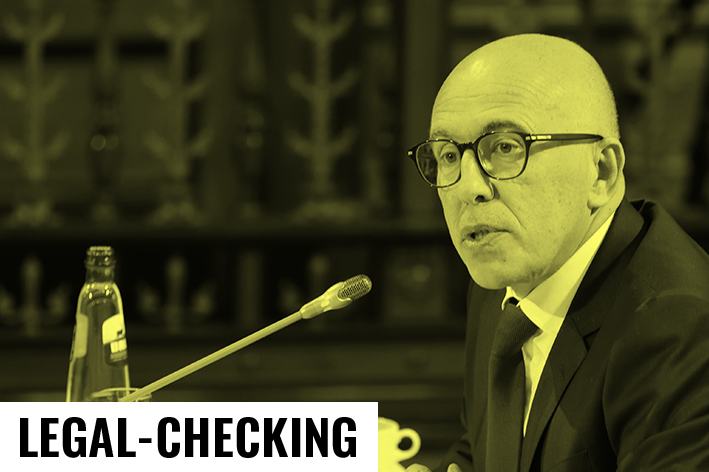Pourrait-on interdire le droit de grève pendant les « heures de pointe » ?
Dernière modification : 26 mai 2025
Auteur : Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social à l’université de Nantes
Relecteurs : Bertrand-Léo Combrade, professeur de droit public à l’université de Poitiers
Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste
Source : Télématin, France 2, le 5 mai 2025
La grève à la SNCF du pont du 8 mai relance des propositions de restriction du droit de grève dans les services publics de transport. Valérie Pécresse propose d’ interdire toute grève pendant les heures de pointe en Île-de-France. Une mesure qui, comme d’autres avant elle, pourrait se heurter à un obstacle de taille : la Constitution.
Voilà une nouvelle proposition pour restreindre le droit de grève qui pourrait bien être sur les rails de l’inconstitutionnalité. Dans l’émission Télématin du 5 mai 2025 sur France 2, Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France a proposé d’interdire la grève à certains moments de la journée pour garantir un « service plein » pendant les « heures de pointe », notamment dans les transports franciliens.
Un débat vieux comme ce droit
C’est loin d’être la première fois que le sujet débarque sur la place publique. En 2023 et 2024, les Surligneurs rappelaient à Véronique Besse, Laurent Wauquiez et Eric Ciotti le risque d’inconstitutionnalité de leurs propositions d’interdire le droit de grève durant les vacances scolaires, la veille de celles-ci ou les jours fériés. Certaines des propositions ont même trouvé leur chemin dans l’Hémicycle de l’Assemblée nationale et du Sénat . Il en va ainsi de celle, de la députée Véronique Besse, déposée en décembre 2024, renvoyée en commission sans qu’elle n’ait pour le moment été débattue, ou encore celle du sénateur Hervé Marseille, adoptée en première lecture, en avril 2024, au Sénat puis transmise en commission à l’Assemblée nationale, sans non plus avoir été discutée depuis.
À l’occasion de cette nouvelle tentative de restreindre le droit de grève, rappelons ici les raisons pour lesquelles une telle restriction se heurterait à la Constitution
Concilier le droit de grève avec les autres droits constitutionnels
La liberté d’aller et venir et le principe de continuité des services publics ont tous deux, selon le Conseil constitutionnel, valeur constitutionnelle. C’est principalement avec ces deux principes que doit être concilié le droit de grève, qui a également valeur constitutionnelle. Concrètement, c’est au Parlement qu’il revient de concilier ces différentes exigences lors de l’élaboration d’une loi.
Si le Parlement a la faculté, au nom de certaines libertés (comme la liberté d’aller et venir des usagers) et de principes (la continuité des services publics), d’en restreindre d’autres (comme le droit de grève) cette restriction ne doit pas être disproportionnée. Une telle disproportion, en ce qu’elle révèlerait une insuffisante conciliation entre principes constitutionnels, justifierait une censure de la loi par le Conseil constitutionnel s’il est saisi.
L’interdiction du droit de grève en France : des cas très limités
Actuellement, le nombre de professions privées du droit de grève en France est limité. Seuls certains agents publics sont concernés, comme les soldats et gendarmes, les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS), les policiers, les gardiens de prisons et les services extérieurs de l’administration pénitentiaire, les magistrats de l’ordre judiciaire, les services des transmissions du ministère de l’Intérieur et les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile. De 1964 à 1984, les contrôleurs de la navigation aérienne ont également été privés du droit de grève avant que ne soit établi un régime de service minimum.
Pour autant, les personnels du secteur des transports entreraient-ils dans la catégorie définie par le Conseil constitutionnel comme celle des « agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays »? Pour le moment, non. Ce n’est pas le cas en l’état de sa jurisprudence et il y a fort peu de chance que cela le devienne.
En revanche, la loi peut apporter des restrictions au droit de grève, qui sans l’interdire en limitent l’exercice. Bien des cas existent dans les services publics, par exemple l’obligation de préavis qui empêche le déclenchement inopiné d’une grève. La loi de 2007 a, par exemple, rendu obligatoire aux grévistes de se déclarer individuellement 48 heures à l’avance afin de permettre à l’entreprise d’organiser un service minimum avec les non-grévistes. De même, certaines formes de grève sont interdites, comme les grèves tournantes – cessation du travail par roulement concerté.
Il est donc possible de restreindre le droit de grève. Mais là encore, il faut une proportionnalité entre cette restriction et la liberté protégée (celle d’aller et venir des usagers notamment). Or, en l’état de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et donc sauf revirement, interdire la grève aux heures de pointe paraît disproportionné (Conseil constitutionnel, 1979).
Une plage horaire large et floue
D’autant que, lors de son intervention, Valérie Pécresse ne précise pas ce qu’elle entend par « heures de pointe ». Dans une récente proposition de loi portant sur un sujet proche, le sénateur Hervé Marseille considérait qu’il s’agissait des périodes allant de 6 heures 30 à 9 heures 30 et de 17 heures à 20 heures. Or, cette notion « d’heure de pointe » n’est pas évidente, ni commune à l’ensemble des travailleurs et travailleuses. En 2021, 45 % des salariés travaillaient en moyenne au moins une fois par mois en horaire atypique. Dans les entreprises pratiquant le « travail en continu » (communément appelé les « trois huit »), les horaires sont souvent 6h-14h, 14h-22h, 22h-6h (ou 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h). Ce traitement différencié des travailleurs par la proposition de Valérie Pécresse pourrait avoir un impact sur sa conformité à la Constitution.
Plus largement, la plage horaire – bien floue ceci dit – semble très (trop) importante. Ainsi, interdire la grève à raison de six heures par jour – soit le quart d’une journée calendaire et 43 % du temps d’un salarié qui travaille sept heures par jour dans le cadre des 35h – pourrait être considéré par le Conseil constitutionnel comme portant une atteinte disproportionnée au droit de grève sous prétexte d’assurer la continuité du service public et de protéger la liberté d’aller et venir.
Ancienne conseillère d’État, Valérie Pécresse le sait mieux que d’autres En somme, la proposition apparaît plus destinée à surfer sur la colère des usagers qu’à passer l’obstacle du juge constitutionnel.