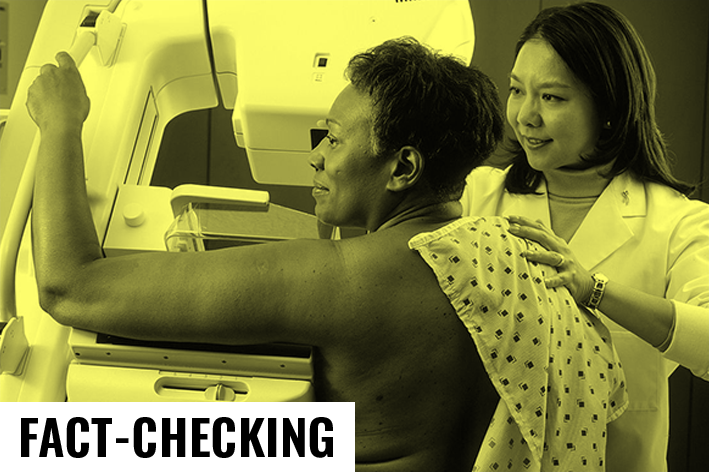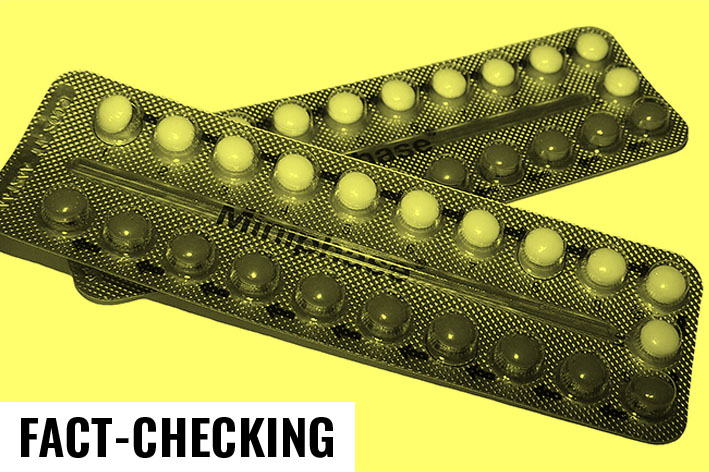Pourquoi on ne peut pas affirmer que des scientifiques ont découvert « l’origine » de la sclérose en plaques
Dernière modification : 12 août 2025
Auteur : Nicolas Kirilowits, journaliste
Relectrice : Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clarisse Le Naour, double cursus L3 science politique et L3 droit public à l’université Lumière Lyon II
Source : Compte Facebook, le 29 juillet 2025
Une étude allemande a permis de caractériser un lien potentiel entre le microbiote intestinal et la maladie. Aussi prometteurs soient-ils, ces travaux ne permettent pas pour autant d’affirmer que les bactéries identifiées soient l’unique cause de la sclérose en plaques.
Près de 2,9 millions de personnes vivent dans le monde avec la sclérose en plaques (SEP) selon des données de la MS International Federation, la fédération internationale qui regroupe les organisations représentatives de la maladie.
Autant de personnes potentiellement concernées par cette annonce diffusée fin juillet 2025 dans plusieurs posts sur les réseaux sociaux : « Des scientifiques viennent de percer le code de la sclérose en plaques après des décennies de recherche ». D’après ces publications, « deux bactéries intestinales » seraient la cause de la maladie.
La découverte scientifique est évidemment, si l’on se fie à ces messages, une bonne nouvelle pour le développement d’un traitement ciblé contre la SEP. Toutefois, une lecture approfondie de l’étude sur laquelle se basent ces informations permet de déceler des failles dans l’interprétation qui en a été faite.
En effet, contrairement au ton affirmatif employé par les publications, les résultats de l’étude n’indiquent jamais que « le code le sclérose en plaques » ait été percé.
Une piste, parmi d’autres
« Nos observations expérimentales, pas encore achevées, ne permettront pas d’identifier les causes de la SEP. Cette maladie est extrêmement complexe, impliquant des facteurs génétiques, environnementaux et microbiens, et il n’existe probablement pas de cause unique », nous assure à cet égard le docteur Hartmut Wekerle, l’un des responsables de l’étude.
Or, comme le résume un article de vulgarisation publié par l’institut allemand Max Planck, auquel est rattaché Hartmut Wekerle, parmi les facteurs soupçonnés de déclencher la maladie se trouve « les micro-organismes présents dans l’intestin », soit l’objet de l’étude portée notamment par l’hôpital universitaire de Munich.
Concrètement, ces travaux, décomposés en deux phases, se sont concentrés d’abord sur l’examen des échantillons de selles de 81 paires de jumeaux dont l’un est atteint de la maladie. Ces observations ont permis d’établir des différences quant à la présence de bactéries dans les selles des jumeaux.
Nouveauté, les scientifiques ont par la suite pris des échantillons du microbiote présent dans les intestins grêles de certaines des paires de jumeaux qui ont ensuite été incorporées dans des souris transgéniques afin de mesurer leur pathogénicité.
Résultat : une maladie semblable à la sclérose en plaques a été observée « chez des souris colonisées par des échantillons du [microbiote de l’intestin grêle des personnes atteintes de] SEP, indiquant la présence de micro-organismes pathogènes dans l’intestin grêle des personnes atteintes de SEP », explique l’institut Max Planck. Or, parmi ces micro-organismes, deux se sont révélés être particulièrement dominants : la Eisenbergiella tayi et la Lachnoclostridiumi. Soit les « deux bactéries intestinales » mentionnées par les publications.
Suffisant dès lors pour percer le mystère de la sclérose en plaques ?
Non, de l’aveu même du docteur Hartmut Wekerle. « Nos études sont à un stade précoce et nous prévoyons que d’autres microbes déclencheurs de la SEP pourraient être découverts. », précisent-ils aux Surligneurs.
Dans un message sur X, Florian Deygas, administrateur de la fondation France Sclérose en Plaques, rappelait également à l’égard des interprétations hâtives diffusées sur les réseaux sociaux que « c’est une piste de recherche élégante, originale, prometteuse. Pas une révolution thérapeutique. Pas une percée clinique. Et certainement pas une découverte qui change tout. »
Une maladie multifactorielle
Dans les faits, en l’état actuel des connaissances, l’origine de la sclérose en plaques n’est toujours pas formellement établie. « Bien que la sclérose en plaques ait été décrite par Charcot il y a plus d’un siècle et demi, les causes de cette maladie du système nerveux central restent encore inconnues. », indique l’Institut du cerveau, en citant des facteurs génétiques et environnementaux. « On pense que des facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle. », abonde l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Autrement dit, « la SEP est une maladie multifactorielle complexe », résume auprès des Surligneurs, Laureline Berthelot, chargée de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).
Dans une vidéo publiée en avril par l’Inserm, Anne Astier, immunologiste à l’Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires, citait, parmi « les facteurs de risques identifiés » : l’infection par le virus Epstein-Barr, le tabagisme, l’obésité et la déficience en vitamine D.
Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que le microbiote intestinal est étudié pour son éventuel lien avec la SEP, comme le prouve notamment cette autre récente étude de l’école de médecine de Yale, aux États-Unis, ou ce livret informatif publié par Sanofi et le professeur Philippe Cabre, neurologue au CHU de Martinique.
« Pour le moment on ne sait pas encore si le microbiote altéré est la cause ou la conséquence de la sclérose en plaques », explicite Laureline Berthelot.