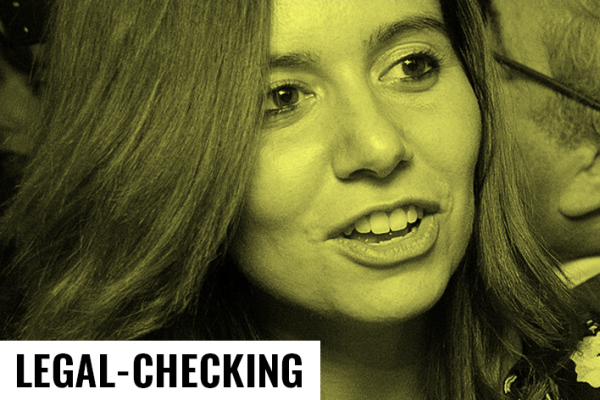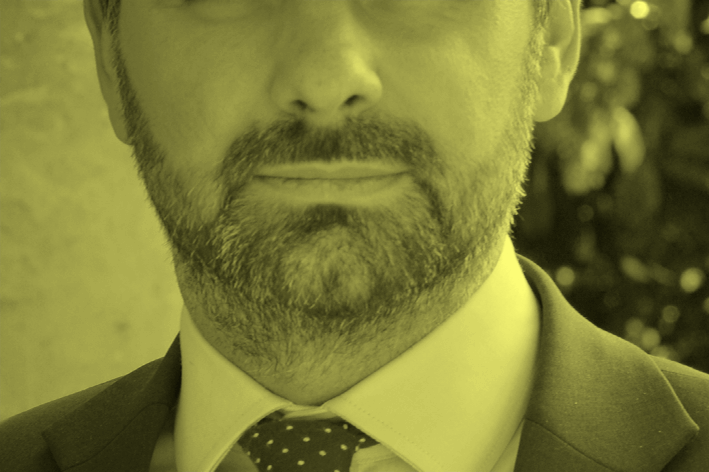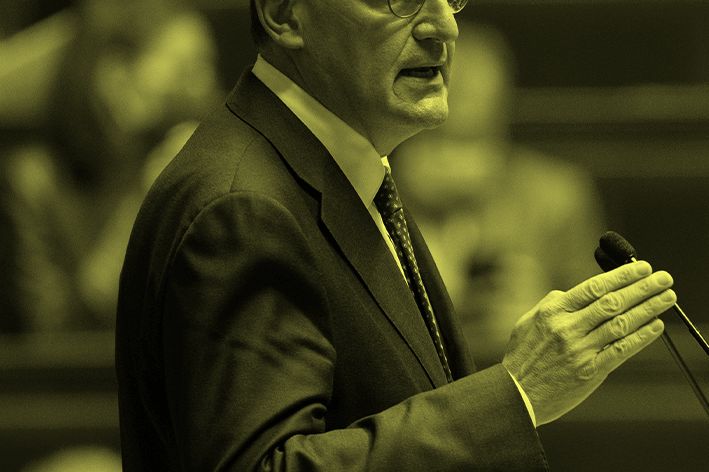Peut-on supprimer le juge des libertés et de la détention pour assurer l’exécution des peines comme le dit Sarah Knafo ?
Dernière modification : 2 février 2025
Autrice : Lylou Joly, étudiante en Master 2 Droit pénal financier et international, université de Lorraine
Relecteur : Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal, université de Lorraine
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste
Source : Europe 1, le 27 janvier 2025
En proposant de supprimer le juge des libertés et de la détention pour que « la peine prononcée soit la peine exécutée », Sarah Knafo confond la fonction de ce magistrat avec celle du juge de l’application des peines et se méprend sur son action, strictement encadrée par la loi. Au-delà de la confusion, la suppression du JAP pourrait contrevenir au principe fondamental de l’individualisation des peines.
Invitée sur le plateau d’Europe 1 ce lundi 27 janvier, Sarah Knafo, députée européenne du parti Reconquête, a affirmé avoir trouvé la solution pour que la peine prononcée par un juge soit la même que celle qui est finalement exécutée : « à mon sens, il faut supprimer le juge de la liberté [sic] et de la détention », défend Sarah Knafo au micro de la radio. Cette affirmation posée avec la force de l’évidence est pour le moins surprenante, et pour cause : le juge des libertés et de la détention (JLD) n’a rien à voir avec l’exécution d’une peine prononcée puisqu’il intervient… bien avant le prononcé de la peine !
On l’aura compris, Sarah Knafo a confondu le JLD et le juge de l’application des peines (JAP). Pourtant, la distinction entre ces deux magistrats du siège est simple. Revenons alors sur leurs fonctions respectives.
Les pieds dans le tapis
Le juge des libertés et de la détention, fonction créée par la loi du 15 juin 2000, est un magistrat du siège spécialisé en matière de liberté individuelle. Son champ de compétence est relatif à la détention provisoire des personnes mises en examen et à ses alternatives comme le placement sous contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique. Il est également compétent pour prolonger la garde à vue pour certaines infractions spécifiques, telles que le terrorisme ou le trafic de stupéfiants.
En bref, le JLD n’intervient qu’en amont du procès pénal, tant que personne n’a été condamné
Le magistrat chargé de l’application des peines est, comme son nom l’indique, le juge de l’application des peines. Son champ de compétence est déterminé aux articles 712-1 et suivants du Code de procédure pénale. Il détermine « les principales modalités d’exécution des peines privatives de liberté ».
Ainsi, il a comme pouvoir d’ordonner, modifier, ajourner ou révoquer les mesures de sursis probatoire, de permission de sortie, mais aussi de prononcer des aménagements de peine, comme la libération conditionnelle, par exemple. Le JAP intervient donc après le procès pénal. Pour certains aménagements, c’est même le tribunal de l’application des peines qui est compétent.
Supprimer le JAP ?
Si l’on met de côté la confusion entre les deux magistrats, la députée européenne semble ensuite affirmer que le JAP (et non le JLD, il faut suivre) a la possibilité de libérer tout criminel, s’il estime que celui-ci s’est bien comporté en prison. A-t-elle raison sur ce point ? Non, pas du tout.
Les compétences du JAP sont strictement encadrées par le code de procédure pénale. Le JAP statue à l’issue d’une procédure, après avoir entendu le procureur de la République. Il doit respecter les conditions prévues pour chaque aménagement et sa décision peut faire l’objet d’un recours devant une autre juridiction : la chambre de l’application des peines.
De cela, on peut aisément comprendre que la décision de « faire sortir », ou pas, un individu de prison ne relève pas de la seule décision souveraine du JAP, contrairement à ce qu’affirme Sarah Knafo qui y voit pourtant une « idéologisation de la justice ».
Si l’on revient à la proposition principale de Sarah Knafo : est-il possible de supprimer le JAP ?
Rien dans la Constitution du 4 octobre 1958 ne semble rendre obligatoire l’existence du JAP. Et le Conseil constitutionnel n’a jamais rendu une décision dans laquelle il aurait exigé qu’existe un JAP. D’ailleurs, le JAP n’a pas toujours existé puisqu’il n’a été créé qu’en 1958 et que son rôle actuel en matière d’aménagements de peine résulte réellement d’une loi du 9 mars 2004. Jusqu’à cette loi, il ne décidait pas de tous les aménagements.
Supprimer le JAP, pourquoi pas… Mais cela ne signifierait pas qu’il n’y aurait plus d’aménagements de peine or, cela est problématique en soi.
Il existe en effet un principe à valeur constitutionnelle : le principe d’individualisation des peines. Cette exigence d’individualisation des peines suppose notamment de prendre en compte, en principe, l’évolution du condamné pendant l’exécution de sa peine.
À ce titre, le JAP est le garant de ce principe : il va veiller à ce que la peine exécutée par un individu soit toujours nécessaire, proportionnée, et individualisée. Si ce n’était plus lui qui s’assurait de cela, il faudrait que ce soit quelqu’un d’autre. Autant garder le JAP, non ?