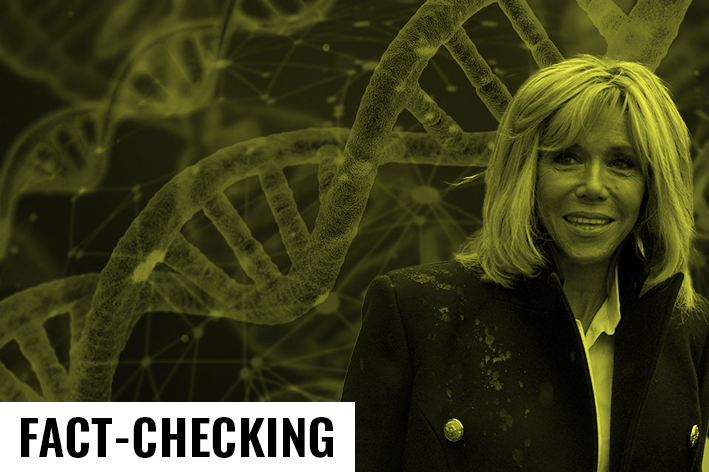Peut-on envoyer les trafiquants de drogues les plus dangereux dans une prison en Guyane ?
Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Gérald Darmanin, le JDD le 17 mai 2025
Présenté comme une réponse implacable au trafic de stupéfiants et au grand banditisme, le projet de Gérald Darmanin divise. Au regard du droit, l’initiative soulève de sérieuses inquiétudes.
Pour lutter contre le trafic de stupéfiants et le grand banditisme, Gérald Darmanin veut frapper fort. Le ministre de la Justice a annoncé la création d’une prison de haute sécurité… en plein cœur de la jungle guyanaise. Auprès du JDD, le ministre de la Justice a affirmé, le 17 mai, qu’il souhaitait que cette prison « serve à éloigner durablement les têtes de réseau du narcotrafic » dans la mesure où « ils ne pourront plus avoir aucun contact avec leurs filières criminelles ». De quoi imaginer des transferts des détenus de la métropole vers la Guyane.
Soutenu d’un côté par les partisans d’une plus grande fermeté, contesté de l’autre par ceux qui dénoncent “le retour du bagne”, Gérald Darmanin a fini par nuancer ses propres annonces, ce 19 mai, assurant que l’établissement pénitentiaire n’avait pas vocation à accueillir des détenus venus de la métropole.
Un rétropédalage lié aux vives critiques ? Peut-être. Mais ce revirement est sans doute à chercher du côté du droit. En effet, le projet initial du ministre se heurtait aussi à des principes juridiques.
Comme nous l’avons fait pour le bagne aux îles Kerguelen de Nicolas Dupont-Aignan ou le centre de rétention administrative à Saint-Pierre-et-Miquelon de Laurent Wauquiez, Les Surligneurs analysent ce projet sur le plan juridique, indépendamment des commentaires politiques.
Le placement de détenus vivant déjà en Guyane ne soulève a priori pas de problème : ils seraient incarcérés à proximité de leur lieu de vie. Mais si la future prison devait accueillir des narcotrafiquants venus de l’Hexagone, la situation deviendrait beaucoup plus délicate.
Un risque d’atteinte aux droits fondamentaux des détenus
Le statut de détenus prive par nature celui qui en est frappé de sa liberté d’aller et venir, mais il ne le prive pas de tous ses autres droits. En particulier, en 2009, le Conseil d’État avait considéré que le transfert d’un détenu vers un établissement situé à 800 km de sa famille portait une atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. L’État doit donc assurer au détenu la possibilité d’avoir une vie familiale dans une mesure compatible avec le statut de détenu.
Même son de cloche à Strasbourg : en 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) avait estimé qu’une incarcération à 700 km de la famille du détenu empêchait le maintien de liens familiaux normaux. Le juge européen a considéré que “le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale”.
La Cour rappelle par ailleurs que l’État est tenu de tout mettre en œuvre pour que les détenus exercent ce droit à une vie familiale aussi normale que possible compte tenu du statut de détenu.
Précisons toutefois que le juge, dans ces affaires, statue au cas par cas. Le cas d’un détenu qui s’était “planqué” loin de sa famille durant des années avant d’être arrêté, jugé et incarcéré loin de chez lui pour des raisons de sécurité, ne sera pas traité de la même manière que le cas d’un détenu arrêté alors qu’il vit en famille chez lui. Les possibilités de liaisons téléphoniques et en visio sont prises en compte par le juge, mais sans toutefois remplacer le lien à travers les visites.
Risque d’atteinte aux droits de la défense
En plus de sa vie privée et familiale, c’est le droit de la défense du détenu qui peut être entravé par un tel éloignement. Au même titre que sa famille, l’avocat du détenu doit pouvoir se rendre sur place pour échanger avec son client, et l’État a l’obligation de faire respecter ce droit. Le Conseil d’État a rappelé il y a peu que cela constituait une liberté fondamentale. Gérald Darmanin s’engagera-t-il à ce que l’État prenne en charge les frais de déplacement des avocats entre l’Hexagone et la Guyane ?
Une conversation à distance est toutefois envisageable, par téléphone ou en visioconférence. Mais là encore, au vu du secret professionnel de l’avocat qui commande une stricte confidentialité des échanges avec son client, l’État doit garantir que la liaison sera sécurisée. Il est en revanche totalement inenvisageable qu’un agent du centre pénitentiaire puisse avoir accès aux conversations entre le détenu et son avocat. Le détenu doit avoir confiance en son avocat, ce qui repose aussi sur la confidentialité des liaisons téléphoniques et autres correspondances.
En somme, si le Garde des Sceaux maintient son projet et y enferme des personnes venues de loin, il est à craindre que les contentieux se multiplient.
















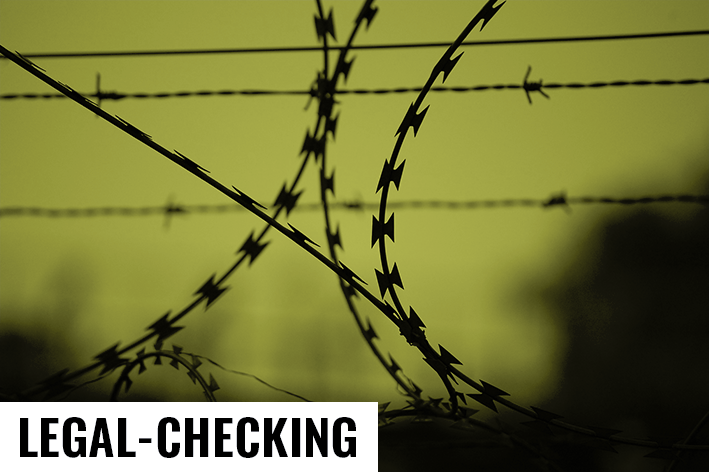
 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents