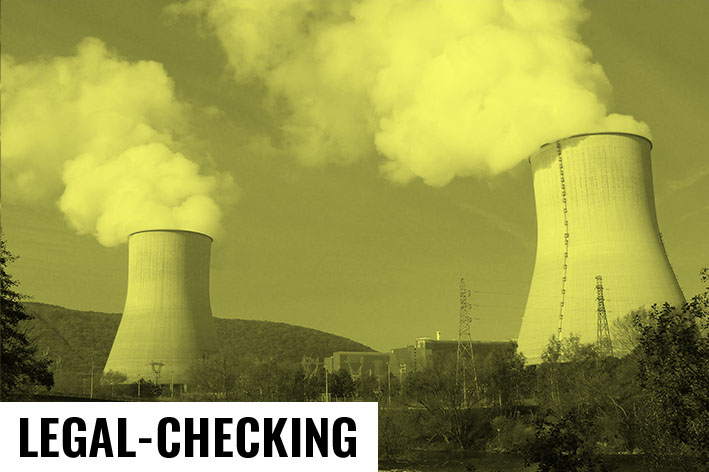La panne d’électricité générale en Espagne et au Portugal n’a pas fait plus de morts que Fukushima
Auteur : Nicolas Kirilowits, journaliste
Relectrice : Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Léocadie Petillot, juriste et étudiante en journalisme au CFJ
Source : Compte Twitter, 30 avril 2025
Les deux événements, évidemment distincts par leurs formes et leurs multiples conséquences, ne peuvent être comparés selon un seul bilan humain, par ailleurs difficile à établir.
Comparaison n’est pas raison, affirme l’adage. Une maxime dont ne s’est visiblement guère préoccupé le célèbre animateur de M6, Mac Lesggy sur X qui n’a pas hésité à comparer la panne de courant massive qui a affecté l’Espagne et le Portugal, le 28 avril 2025, à l’accident nucléaire de Fukushima.
« Le blackout vient de faire plus de victimes directes (3 à ce jour) que l’accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi », rapporte l’animateur. D’autres internautes reprennent le raisonnement tout en imputant la responsabilité de la panne d’électricité aux énergies renouvelables.
Toutefois, le parallèle entre les deux événements est contestable, comme l’ont expliqué des spécialistes aux Surligneurs.
Victimes directes et indirectes
L’accident qui a touché la centrale nucléaire japonaise en 2011 n’a, officiellement, fait aucun mort direct, comme l’ont confirmé plusieurs rapports internationaux (UNESCEAR, NEA, WNA). Cependant, il n’a pas été sans conséquences – soit sans effets indirects – pour les habitants de la région, contraints notamment d’évacuer en urgence des zones contaminées.
Ainsi, le rapport de la World Nuclear Association, cité plus haut, évoque « 2 313 décès liés à la catastrophe parmi les personnes évacuées de la préfecture de Fukushima. » Une donnée que confirme aux Surligneurs, David Boilley, président de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO) et membre du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN).
De récents travaux menés par des chercheurs japonais mentionnent le chiffre de 3 691 victimes indirectes des événements survenus le 11 mars 2011.
« Le nombre de morts provoqués par un accident nucléaire tel que celui de Fukushima est toujours très compliqué à évaluer », rappelle Sandrine Revet, anthropologue et directrice de recherche à Sciences Po.
De manière générale, « la série d’événements a eu un impact sur le bien-être des individus et de la communauté, et l’évacuation aurait entraîné des décès prématurés dus au manque de soins de santé ou de médicaments, à des problèmes liés au stress, etc. », résume pour sa part l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE dans son rapport.
Non sans lien, en septembre 2023, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), affirmait dans un article que « pour beaucoup de personnes, le traumatisme initial s’est mué en désespoir au fur et à mesure que s’affirmait dans leur esprit le sentiment d’une perte totale de maîtrise de leur quotidien. »
La problématique des conséquences indirectes a été évoquée dès 2014 par la chercheuse, associée à la Maison franco-japonaise de Tokyo, Cécile Asanuma-Brice, dans une tribune à Libération et dans laquelle elle parlait alors de « la légende du zéro mort ».
Une comparaison douteuse
Aussi, pour que la comparaison avec la coupure de courant générale qui a touché la péninsule tienne debout, faut-il encore que les termes du débat soient les mêmes. Autrement dit, si l’on s’intéresse aux décès directs imputables à la catastrophe nucléaire de Fukushima, il faut le faire également pour le black-out ibérique. Or, jusqu’à preuve du contraire, ceux-ci s’élèvent également à zéro.
En effet, les autorités espagnoles et portugaises – contactées en vain – n’ont pas, à ce jour, communiqué de données officielles concernant des personnes qui auraient été directement victimes de la panne de courant géante. La presse espagnole évoque quant à elle le nombre de cinq (El Pais, RTVE), huit (ABC) ou dix personnes (Alerta) qui seraient décédées en lien avec la coupure de courant générale.
« Trois membres d’une même famille sont morts après avoir inhalé du monoxyde de carbone, probablement à cause d’un générateur qu’ils avaient allumé pour alimenter un respirateur dont l’un d’eux avait besoin », explique notamment El Pais. Une tragédie à laquelle semble se référer Mac Lesggy dans son message sur X.
L’agence de presse portugaise Lusa annonçait elle, vendredi 2 mai, l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de la mort d’une femme de 77 ans.
Si ces informations étaient confirmées, ces personnes seraient alors considérées comme des victimes indirectes de la coupure du courant. En effet, ce n’est pas la coupure en elle-même qui les a tuées. De la même manière que ce n’est pas l’accident en lui-même dans la centrale de Fukushima – conséquence du tremblement de terre – qui a tué par milliers des personnes au Japon…
Enfin, au-delà du débat sémantique, cette comparaison a-t-elle tout simplement du sens ? Non, affirment les experts interrogés par Les Surligneurs.
« On ne peut pas comparer un black-out et l’accident de Fukushima dont les effets catastrophiques se sont fait ressentir bien plus tard du fait de la contamination. », soutient Valérie November, directrice de recherche au CNRS et spécialisée dans l’analyse des risques urbains, environnementaux et naturels.
« Comparer des événements sur le nombre de morts est tout bonnement inutile et ne peut avoir pour objectif que de ‘relativiser’ l’un des deux événements, c’est un classique, y compris dans les conflits », considère Sandrine Revet.
« L’affirmation est une provocation de plus sans aucun fondement. L’impact d’un incident ou accident ne se compte pas qu’en nombre de morts », assure quant à lui David Boilley.