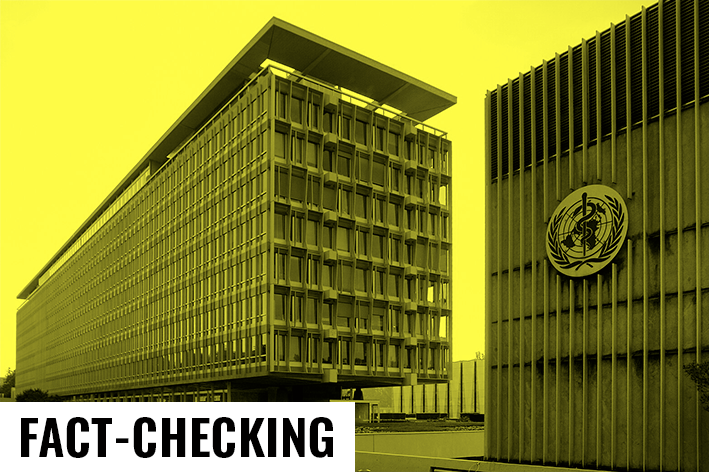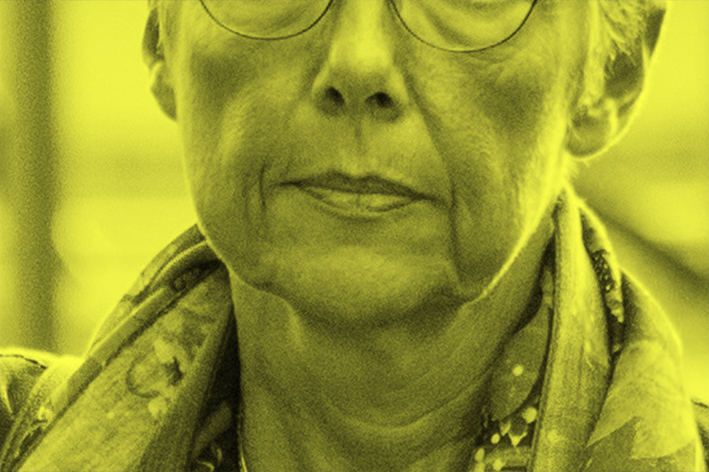Non, le futur observatoire de la désinformation médicale ne permettra pas de censurer du contenu en ligne
Autrice : Léocadie Petillot, juriste et étudiante en journalisme au CFJ
Relectrice et relecteurs : Maylis Ygrand, journaliste
Vincent Couronne, docteur en droit européen, enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste
Source : Compte Facebook, le 18 avril 2025
Contrairement à ce qu’affirme Florian Philippot, l’observatoire de lutte contre la désinformation en santé annoncé ne sera pas un outil de censure sur Internet.
Le ministre de la Santé a-t-il annoncé la création d’un observatoire chargé « d’inciter à la censure dans les médias et sur les réseaux sociaux » dans le domaine de la santé ? C’est en tout cas ce que soutient Florian Philippot sur son compte Facebook.
Une allégation tenue à la suite du colloque « Lutte contre l’obscurantisme et la désinformation en santé », le 18 avril 2025. À cette occasion, Yannick Neuder (Droite républicaine), ministre de la Santé, a proposé la création d’un observatoire de lutte contre la désinformation en santé qui pourrait « s‘adresser aux plateformes de réseaux pour attirer leur attention sur des informations fausses » ou encore « saisir l’Arcom [Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ndlr] ».
Cet observatoire pourrait-il enjoindre à retirer du contenu des plateformes ? Non, et cela, même s’il coopère avec l’Arcom ou les plateformes.
Pas un organe de régulation
Selon les mots du ministre, l’objectif de l’observatoire serait de « mutualiser les efforts de veille des institutions, des médias, des plateformes et des agences publiques », et ainsi « agréger l’ensemble de nos données sur la désinformation en santé ». Contacté par Les Surligneurs, le ministère de la Santé n’a pas donné plus de précisions sur le rôle et missions dudit observatoire.
Rien que « l’intitulé est assez révélateur : c’est un observatoire, pas un organe de régulation », commente Valère Ndior, professeur de droit public à l’Université de Bretagne occidentale. « A priori, il n’aura pas vocation à empiéter sur les prérogatives de l’Arcom », ajoute-t-il.
L’Arcom est « au cœur de l’écosystème de régulation en ligne », indique Valère Ndior. Pour autant, elle ne dispose pas du pouvoir de forcer directement une plateforme à retirer un contenu. Son action repose sur le contrôle du respect des obligations légales, notamment celles imposées par le Digital Services Act (DSA). Et pour les très grandes plateformes, comme Facebook ou Instagram, « la compétence en matière de sanctions relève en premier lieu de la Commission européenne », précise Suzanne Vergnolle, maître de conférences en droit du numérique au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
Le statut de signaleur de confiance
Pour renforcer son action directe auprès des plateformes, l’observatoire pourrait éventuellement demander à devenir « signaleur de confiance », un statut accordé par l’Arcom en France, et reconnu par l’article 22 du DSA à des entités respectant des critères stricts (expertise, indépendance, moyens techniques). Les signalements de ces entités doivent être traités en priorité par les plateformes, comme l’exige explicitement le règlement européen.
Mais, comme l’Arcom, « un signaleur de confiance ne peut pas non plus imposer une suppression. Ce sont les plateformes qui décident », rappelle Suzanne Vergnolle. Par ailleurs, les signaleurs de confiance ne peuvent se concentrer que sur les contenus illégaux, et ne peuvent donc pas demander le retrait d’un contenu de désinformation, qui, par principe, n’est pas illégal. Il n’est pas du tout sûr, par ailleurs, que l’observatoire soit considéré comme suffisamment indépendant pour être reconnu comme signaleur de confiance.
Autre voie possible : le DSA (article 9) et la loi française de 2024 visant à sécuriser l’espace numérique (dite « loi SREN ») prévoient qu’un juge peut demander en urgence à une plateforme le retrait d’un contenu. Mais là encore, ce contenu doit être illicite.
La désinformation médicale n’est pas illégale
« Concrètement, pendant le covid, cet observatoire aurait interdit de dire autre chose que “le vaccin protège de l’infection et de la transmission”, que le Pass est “formidable”, qu’il “n’y pas d’effets secondaires” et aurait censuré et criminalisé toute pensée différente ! », assène Florian Philippot dans sa publication. Mais là encore, l’ancien député européen se trompe.
Le DSA prévoit deux bases légales distinctes pour enjoindre le retrait d’un contenu en ligne. Premièrement, l’illégalité du contenu, au regard du droit européen ou national, encadrée par l’article 16 du règlement, qui oblige les plateformes à agir rapidement face à des signalements étayés. Deuxièmement, la violation des conditions générales d’utilisation (CGU) de la plateforme, définies à l’article 14 du DSA.
« Ce n’est pas parce qu’un contenu est faux ou discutable qu’il devient automatiquement illégal », rappelle Suzanne Vergnolle. À l’exception du cas de celle proférée par un médecin (Art. R.4127-13 du code de la santé publique), la désinformation médicale n’est pas illégale ni contraire aux CGU des plateformes comme Facebook ou X.
« La grande majorité des contenus retirés sur les plateformes le sont sur la base de leurs conditions générales d’utilisation, et non des règles juridiques. La suppression se fait rarement sur la base de l’illégalité, car cela nécessite une preuve. Or les CGU, rédigées très largement, permettent aux plateformes d’agir de manière quasi discrétionnaire », précise encore Suzanne Vergnolle.
Quant aux cas d’illégalité avérée du contenu, l’observatoire pourrait seulement appliquer la loi existante. En aucun cas ne pourrait-il décider de son propre chef de la légalité, ou non, d’un contenu critique des vaccins. Cette possibilité de le rendre illégal, au sens de l’article 16 du DSA, revient au législateur. Mais incriminer une telle opinion poserait évidemment « un problème en termes de liberté d’expression et risquerait d’être très discrétionnaire », indique Suzanne Vergnolle.
En l’état, l’observatoire de lutte contre la désinformation en santé, comme annoncé par le ministère, n’aurait en réalité aucun pouvoir de censure : il ne pourrait ni enjoindre à retirer des contenus ni museler les prises de parole, même les plus critiques.