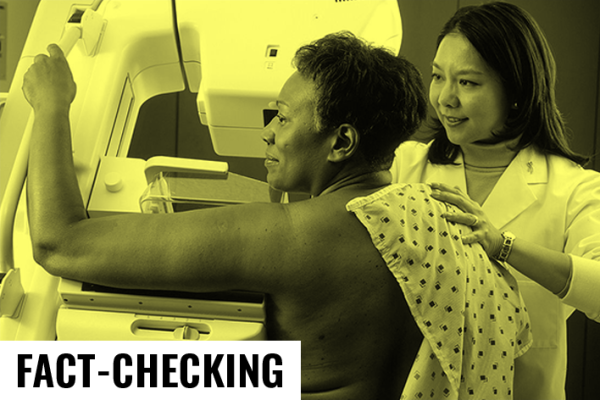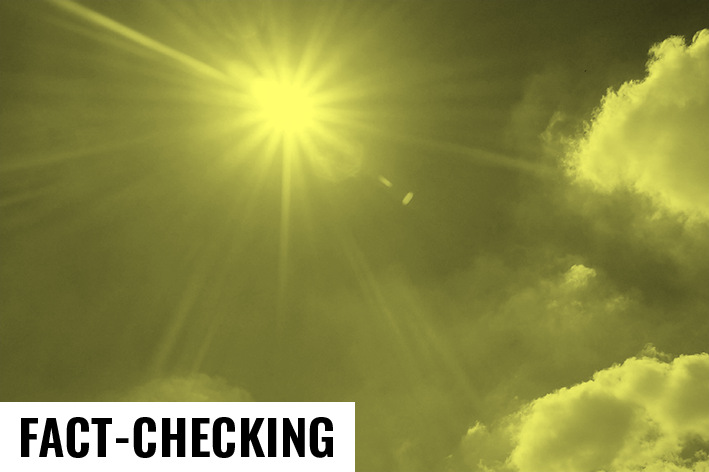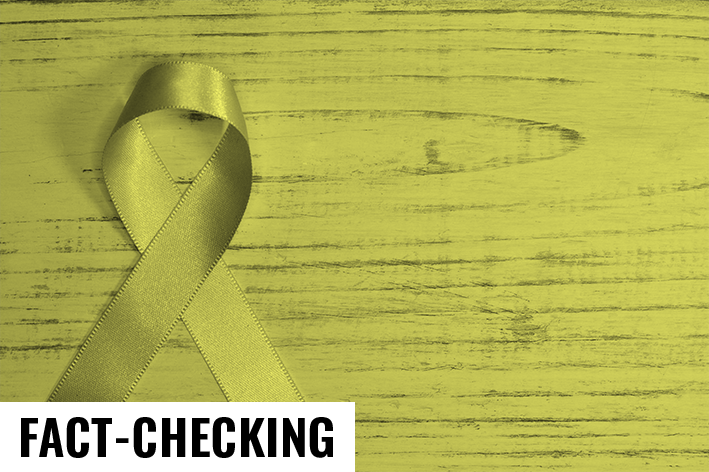Non, 60 % des diagnostics de cancer du sein ne sont pas faux
Dernière modification : 4 septembre 2025
Autrice : Maylis Ygrand, journaliste
Relecteur : Nicolas Turcev, journaliste
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Jean-Baptiste Breen, étudiant en master de journalisme à Sciences Po Paris
Source : Compte Facebook, le 20 mai 2025
Selon certains internautes, près des deux tiers des mammographies déboucheraient sur un faux positif. D’après plusieurs études, ce nombre correspond en fait au risque de recevoir au moins un résultat faussement positif sur dix examens.
Le système de dépistage du cancer du sein est-il défectueux en France ? À en croire certains internautes, il y a de quoi se poser la question : plusieurs d’entre eux affirment que 60 % des mammographies conduisent à des faux positifs.
« Cela signifie que plus de la moitié des femmes diagnostiquées avec un cancer du sein n’ont jamais eu de cancer », croit savoir une utilisatrice de Facebook. « Elles ont été injectées sous chimiothérapie, ouvertes ou irradiées… pour RIEN », dénonce une autre, sans avancer de preuves.
Souvent considérée comme l’examen de référence pour détecter un cancer du sein, la mammographie serait-elle aussi peu fiable ? Issu de plusieurs études, le chiffre avancé par les internautes a en réalité été mal interprété.
Une mammographie ne suffit pas à émettre un diagnostic
La mammographie est un examen radiologique du ou des seins qui permet de déceler certaines anomalies en prenant des images de l’intérieur du sein par le biais de rayons X.
Mais, parfois, « on a une image qui alerte le radiologue, on va faire des examens et finalement il n’y a rien », explique Corinne Balleyguier, cheffe du département d’imagerie médicale au centre de lutte contre le cancer de Gustave Roussy. C’est ce qu’on appelle un « faux positif ».
D’après une étude publiée dans la revue Nature, en février 2025, plusieurs facteurs peuvent être à l’origine d’un faux positif, comme des seins denses ou la présence de calcifications.
« Dans le cas où on observe une anomalie lors de la mammographie, il faudra ensuite confirmer le diagnostic par un prélèvement, c’est-à-dire une biopsie, pour savoir si ce que l’on a observé est bénin ou cancéreux. On n’a pas le droit de traiter une personne sur la seule base de l’imagerie », comme l’expliquait aux Surligneurs, Nasrine Callet, oncologue et médecin référent pour les femmes à risque génétique de cancer du sein et des ovaires à l’Institut Curie-Hôpital René Huguenin, en septembre 2024.
Ces faux positifs ne peuvent donc directement déboucher sur un traitement, contrairement aux dires des internautes.
Dix examens
Ce pourcentage de 60 %, émis par les internautes, existe bel et bien mais a été mal compris. Plusieurs études se sont intéressés au risque pour une femme de recevoir un résultat faussement positif au cours de sa vie.
L’une, états-unienne, publiée en 1998 dans la revue The New England Journal of Medicine, indique que « le risque cumulatif estimé d’un résultat faussement positif était de 49,1 % après 10 mammographies ».
Selon une autre plus récente, publiée en 2022 dans la revue Journal of the American Medical Association, sur une période de 10 ans avec un dépistage annuel, une femme a 56,3 % de risque d’être rappelé au moins une fois pour effectuer des examens complémentaires après une mammographie.
Dans cette même étude, les chercheurs présentent un pourcentage de 11 % de faux positifs sur l’ensemble des mammographies.
Ainsi, ce pourcentage approximatif de « 60 % », donné par les internautes, ne concerne pas la proportion de faux positifs parmi toutes les mammographies effectuées. Il s’agit en réalité du risque pour une femme de recevoir un faux positif sur dix examens.
Si la proportion de faux positifs est en réalité bien moindre que celle avancée par les internautes, ils ne sont pas pour autant sans conséquence. En effet, d’après une étude menée par le UC Davis Comprehensive Cancer Center et publiée dans la revue Annals of internal medicine en septembre 2024, les femmes ayant reçu un faux positif « étaient moins susceptibles de reprendre le dépistage ».
Mais « à partir du moment où on fait un dépistage, quel qu’il soit, il y a forcément des faux positifs », souligne Corinne Balleyguier. L’auteure principale de l’étude, Diana Miglioretti, appelle donc « les médecins à expliquer soigneusement les résultats faussement positifs à leurs patients pour les rassurer ».
Une réflexion autour de l’abaissement de l’âge de dépistage
Pour rappel : une femme sur huit sera touchée par un cancer du sein au cours de sa vie. Avec 61 214 nouveaux cas, en 2023, en France et 12 757 décès en 2022, il est, selon les derniers chiffres de l’Institut national du cancer (InCA), le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes.
C’est donc face à ce fléau que la mammographie s’est imposée dans la stratégie de dépistage du cancer du sein. En 2004, la France généralise le dépistage organisé du cancer du sein par mammographie et examen des seins, recommandé tous les deux ans, pour toutes les femmes entre 50 et 74 ans. Un âge, non laissé au hasard, car c’est après 50 ans que près de 80% des cancers du sein se développent.
Selon l’InCA, « 80 % à 90 % des cancers du sein détectés lors de l’examen auraient progressé s’ils n’avaient pas été détectés et auraient pu mettre la vie de la femme en danger ». La mammographie a donc fait ses preuves.
Début 2025, d’après des informations de France Inter, le gouvernement a saisi la Haute autorité de santé pour abaisser l’âge de dépistage.
Tandis que la Commission européenne préconisait de l’abaisser à 45 ans, en 2022, aux États-Unis, il est actuellement recommandé de démarrer le dépistage dès 40 ans.
D’autres voix s’élèvent pour proposer un dépistage plus individualisé en fonction des facteurs de risque de chaque femme. L’étude internationale, MyPeBS, a pour ambition de comparer cette stratégie de dépistage avec celle, standardisée, mise en place dans de nombreux pays. Les résultats de cette étude sont attendus pour fin 2027.
Les mammographies font l’objet de nombreuses infox sur lesquelles Les Surligneurs ont déjà pu se pencher, comme ici ou là.