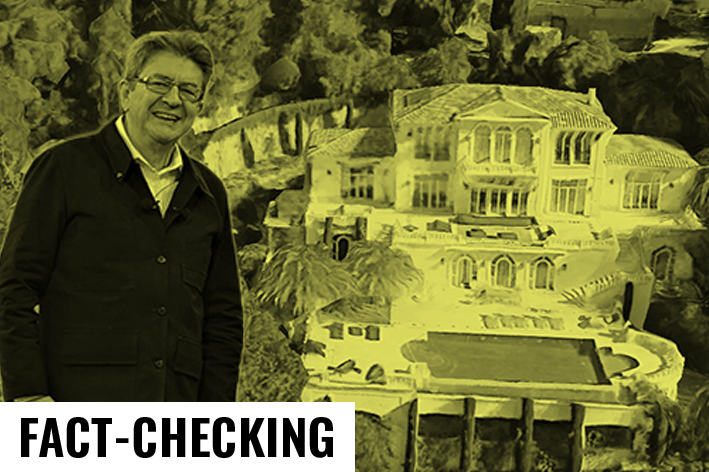L’aluminium présent dans l’eau potable peut-il provoquer la maladie d’Alzheimer ?
Auteur : Etienne Merle, journaliste
Relectrice : Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Compte Facebook, le 3 octobre 2025
Depuis plus d’un demi-siècle, la science explore la piste d’un possible rôle de l’aluminium dans la maladie d’Alzheimer. Mais malgré des décennies d’études et des études contradictoires, aucune preuve formelle de causalité n’a été établie.
Tous contaminés ? Sur Facebook des internautes partagent une image affirmant qu’il existe un lien entre la maladie d’Alzheimer et l’aluminium présent dans notre eau du robinet. « eau = aluminium = Alzheimer = prouvé scientifiquement », peut-on lire.
En arrière-plan, la photo du professeur Jean-François Dartigues, spécialiste reconnu de la maladie d’Alzheimer, laisse entendre que le chercheur cautionnerait cette conclusion.
Problème : cette équation simpliste n’est pas fidèle à la réalité scientifique. La crainte d’un lien causal entre aluminium et maladies du cerveau ne date pas d’hier : elle remonte aux années 1960, quand des expériences sur des lapins avaient montré que des sels d’aluminium (des composés chimiques dérivés de l’aluminium) pouvaient provoquer des lésions cérébrales ressemblant à celles observées dans Alzheimer.
Depuis, plusieurs études épidémiologiques – dont celles de Jean-François Dartigues – ont cherché à vérifier cette hypothèse, sans jamais parvenir à un consensus.
Des soupçons
Jean-François Dartigues a fait partie d’une équipe de chercheurs qui ont réalisé plusieurs études dont les conclusions suggèrent un lien possible entre ingestion d’aluminium via l’eau du robinet et épisodes de la maladie d’Alzheimer. Mais des limites ont été mises en avant par d’autres équipes.
En 2000, une étude française à laquelle participe Jean-François Dartigues ravive le débat. Menée sur plus de 3 700 personnes âgées de Gironde et de Dordogne, l’étude suit les participants pendant huit ans pour observer l’apparition de démences et de maladies d’Alzheimer.
Les chercheurs ont recensé la teneur en aluminium et en silice de l’eau potable dans chaque commune. En classant les concentrations d’aluminium en quatre niveaux, ils n’ont pas observé de progression régulière du risque, autrement dit pas de véritable relation dose-réponse.
Mais lorsqu’ils ont simplifié leur analyse en ne distinguant que deux groupes — les personnes exposées à moins de 0,1 mg/L et celles exposées à plus de 0,1 mg/L —, le risque relatif de démence ou de maladie d’Alzheimer apparaissait plus élevé dans le second groupe.

Un soignant parle avec un résident malades d’Alzheimer dans une maison de L’Hay-les-Roses, en périphérie de Paris, le 17 février 2022. Photo : Alain Jocard / AFP
Les mêmes chercheurs ont poursuivi leur travail, et en 2008, ils publient de nouvelles conclusions en s’intéressant à la consommation individuelle d’eau du robinet, contrairement à la majorité des autres études qui s’étaient contentées jusque-là d’estimations collectives d’exposition.
Sur plus de 1 900 personnes âgées du sud-ouest de la France, suivies pendant 15 ans, ils ont, cette fois, évalué deux types d’exposition à l’aluminium : une estimation géographique, fondée sur la qualité moyenne de l’eau du robinet dans chaque zone et une estimation individuelle, prenant en compte la consommation quotidienne d’eau du robinet.
Leurs analyses confirment les résultats de leur première étude et montrent que les participants ayant une consommation quotidienne d’aluminium supérieure à 0,1 mg/L présentaient un déclin cognitif plus marqué et un risque accru de démence, tandis qu’une teneur plus élevée en silice semblait au contraire réduire ce risque.
S’ils expliquaient qu’une « consommation haute d’aluminium via l’eau du robinet peut être un facteur de risque de la maladie d’Alzheimer », ils enjoignaient la communauté scientifique à réaliser des études supplémentaires pour « trancher le débat sur le lien entre l’aluminium ou la silice dans l’eau potable et les troubles neurologiques ou cognitifs. »
À noter que le seuil de 0,1 mg/L (soit 100 µg/L) utilisé dans l’étude correspond à la limite haute de ce qu’on observe en France. Selon un rapport sanitaire publié en 2017, 98,5 % de la population consomment une eau contenant moins de 100 µg/L d’aluminium.
3,8 % des Français – environ 2,36 millions de personnes – ont été exposés ponctuellement à des niveaux dépassant 200 µg/L, principalement dans les territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane).
Et des doutes
Dans le même temps, d’autres études sont réalisées et ne tombent pas sur les mêmes conclusions. Pour l’heure, le débat reste ouvert. En 2021, des chercheurs canadiens publient une étude sur plus de 10 000 personnes suivies pendant une dizaine d’années, qu’ils présentent comme « la plus grande évaluation prospective de l’aluminium dans l’eau potable et de la maladie d’Alzheimer réalisée à ce jour ».
Les auteurs expliquent avoir voulu corriger les faiblesses des travaux antérieurs, souvent limités par un faible nombre de participants et des définitions de cas trop imprécises. Leur cohorte, assurent-ils, repose sur « un échantillon analytique relativement large et des critères de diagnostic bien définis ».
L’étude prend aussi en compte plusieurs paramètres susceptibles d’influencer les résultats, comme le pH de l’eau, qui peut modifier la biodisponibilité de l’aluminium, ou encore la présence de silice, de fluor ou de fer, connus pour interagir avec l’aluminium dans l’organisme.
Mais malgré cette rigueur méthodologique, les conclusions demeurent prudentes. L’étude canadienne conclut qu’aucune « association globale entre les concentrations d’aluminium dans l’eau potable et le risque de maladie d’Alzheimer ». Les chercheurs notent toutefois une légère tendance à un risque accru dans certains sous-groupes, ce qui, selon eux, justifie de poursuivre les recherches.
En 2024, ce sont des chercheurs péruviens qui se penchent sur la question à travers une étude bibliométrique, c’est-à-dire l’analyse quantitative de la production scientifique. Les chercheurs se sont appuyés sur « une analyse de 390 articles publiés entre 1979 et 2023 » pour tenter de dégager une tendance sur le sujet.
Et là encore, impossible de confirmer un lien direct entre Alzheimer et l’aluminium présent dans l’eau : « Selon les analyses réalisées, les preuves scientifiques sur ce sujet restent limitées et contradictoires au sein de la communauté scientifique ».
Les auteurs notent que, parmi les études examinées, 12 (soit 60 %) rapportent « une association positive » entre exposition à l’aluminium et risque accru d’Alzheimer, tandis que 8 (40 %) ne trouvent « aucune association significative ». « Les preuves actuelles restent insuffisantes pour établir un lien de cause à effet définitif, soulignant la nécessité de recherches plus concluantes dans ce domaine », conclut le document.
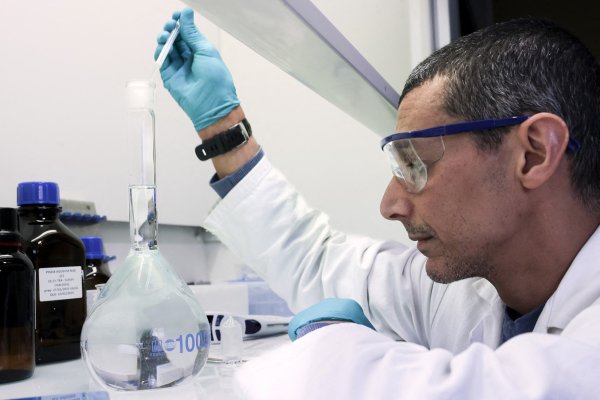
Illustration. Un technicien de laboratoire travaille sur un échantillon d’eau dans un laboratoire à Ivry-sur-Seine, près de Paris, le 13 février 2025. Photo : Alain Jocard / AFP
Qu’en disent les autorités sanitaires ?
En France, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a fait le point en 2017 dans un rapport sur la prévention d’Alzheimer. Il conclut sans ambiguïté (page 51) : « À ce jour, il n’est pas raisonnable de considérer que l’aluminium a un rôle causal dans la maladie d’Alzheimer. »
L’Organisation mondiale de la Santé adopte la même prudence. Dans un rapport (page 311), elle rappelle qu’ « il existe peu d’éléments indiquant que l’aluminium ingéré par voie orale soit toxique à court terme pour l’être humain », malgré sa présence courante dans l’alimentation, l’eau et de nombreux médicaments.
Si l’OMS reconnaît que plusieurs études épidémiologiques ont mis en évidence « une relation positive entre la présence d’aluminium dans l’eau potable et la maladie d’Alzheimer », elle souligne aussitôt qu’« il faut rester très prudent avant d’en déduire une relation causale », ces travaux n’ayant pas « pris en compte tous les facteurs de confusion » ni « l’exposition totale à l’aluminium provenant de toutes les sources ».
Enfin, les risques liés à une exposition supérieure à 100 µg/L d’aluminium dans l’eau sont jugés « faibles » — mais suffisamment incertains pour justifier, selon l’OMS, une vigilance sur le contrôle de l’aluminium dans l’eau du robinet.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les publications, la science n’est pas unanime quant à une éventuelle causalité entre l’aluminium présent – et à quelle dose – dans l’eau potable et la maladie d’Alzheimer.