L’aide militaire française à l’Ukraine est-elle contraire à la Constitution ?
Auteur : Guillaume Baticle, journaliste, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Relecteurs : Thibaud Mulier, maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre
Nicolas Turcev, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste
Source : Nicolas Dupont-Aignan, le 7 juin 2025
Depuis 2022, le gouvernement est parfois accusé de violer la Constitution en livrant des armes à l’Ukraine sans consulter le Parlement. Une interprétation controversée de l’article 35 de la loi fondamentale, qui donne une assez large marge de manœuvre au gouvernement.
Le Parlement aurait-il dû donner son aval ? Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France a livré des armes – dont des missiles SCALP – et formé des soldats ukrainiens. Pour certains responsables politiques comme François Asselineau (UPR) ou Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), ces livraisons seraient contraires à la Constitution.
Ils invoquent l’article 35, et surtout son deuxième alinéa, selon lequel le gouvernement doit « informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger ».
Ce raisonnement est partagé par certains militaires, comme les généraux Coustou et Pellizzari. Les deux hommes, radiés depuis, ont déposé une plainte auprès de la Cour de justice de la République, le tribunal qui juge les membres du gouvernement, pour « livraison illégale d’armes à l’Ukraine ». Étaient visés Gabriel Attal, alors Premier ministre, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. La plainte a finalement été jugée irrecevable en avril 2024.
Mais cette lecture de la Constitution est-elle fondée ?
Aucun texte ne définit la « guerre »
L’argument avancé par les opposants à l’aide militaire repose sur une équivalence entre la livraison d’armes et une participation active à la guerre. Selon ce raisonnement, l’article 35 imposerait soit un vote du Parlement (en cas de déclaration de guerre), soit au moins une information officielle en cas d’intervention des forces armées.
Or, aucun texte ne précise en droit français ce qui constitue une « guerre » ou une « intervention des forces armées » au sens de la Constitution. La doctrine comme la pratique gouvernementale se sont construites progressivement à partir de cas pratiques.
En 2015, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, estimait que l’opération Barkhane au Sahel ne nécessitait pas de nouveau vote, car elle prolongeait les opérations Serval et Épervier, déjà autorisées.
Un an plus tard, l’élargissement de l’opération Chammal en Syrie avait également été jugé en dehors du champ d’application de l’article 35.
En 2019, à l’inverse, Édouard Philippe avait informé le Parlement du déploiement de troupes au Tchad contre des colonnes armées, en invoquant expressément l’article 35.
Ces exemples illustrent une interprétation fluctuante, au cas par cas, selon la gravité et la visibilité de l’engagement militaire. Au regard des débats parlementaires sur la réforme constitutionnelle de 2008, le choix était d’ailleurs celui de laisser une grande marge de manœuvre au gouvernement sur ce point.
Le droit international ne dit pas autre chose
Au regard du droit international, la livraison d’armes à un État en guerre ne suffit pas à qualifier une « agression armée ».
La résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale de l’ONU de 1974, citée par la Cour internationale de justice en 1986, définit l’agression comme l’envoi de forces armées régulières ou de groupes armés se livrant eux-mêmes à des actes de force armée. Or, en Ukraine, la France n’envoie pas de troupes combattre la Russie : elle fournit du matériel et forme des soldats, ce qui, juridiquement, est très différent.
Une marge d’appréciation politique plus que juridique
En réalité, l’article 35 laisse une grande liberté d’interprétation au gouvernement. Aucun mécanisme de sanction n’existe en cas de non-consultation du Parlement, en dehors de l’arme politique de la censure (article 49 de la Constitution).
De fait, les exécutifs successifs ont développé une lecture pragmatique et parfois restrictive de l’article 35, estimant qu’il ne s’applique qu’aux interventions militaires directes et létales de l’armée française. Livrer des armes à un État allié, même en guerre, ne rentre donc pas dans ce champ, selon cette interprétation.
Dire que la France viole la Constitution en livrant des armes à l’Ukraine semble trop tranché. Ni le droit international, ni la pratique constitutionnelle française ne considèrent ces livraisons comme une « déclaration de guerre » ou une « intervention des forces armées ».
En revanche, on peut relever un déficit de transparence : l’exécutif choisit librement quand informer le Parlement, et la pratique varie selon les gouvernements. La controverse sur le contrôle parlementaire de la politique militaire et de défense reste donc ouverte.















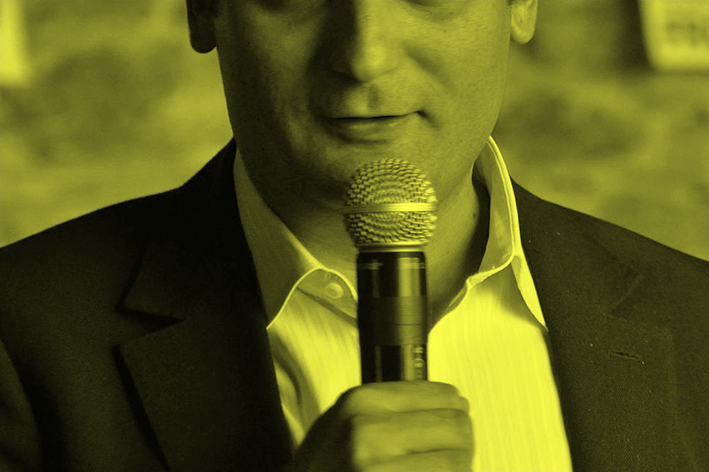
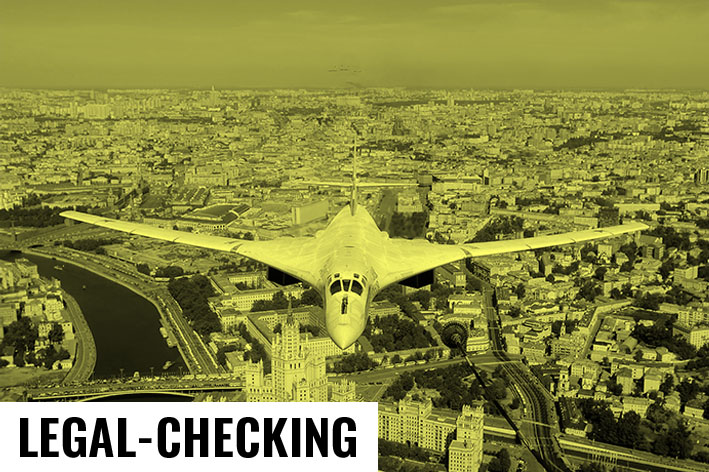
 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents


