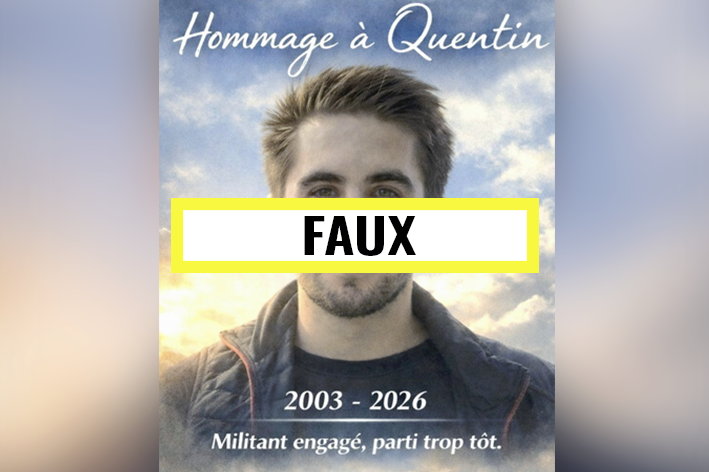La haute mer a-t-elle vraiment été une « zone de non-droit », comme l’affirme Emmanuel Macron ?
Dernière modification : 30 juin 2025
Auteur : Hugo Collin Hardy, élève de l’École normale supérieure de Rennes, en prédoctorat en droit international à l’université Paris-Panthéon-Assas
Relecteurs : Niki Aloupi, Professeure en droit public, université Paris-Panthéon-Assas
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Maylis Ygrand, journaliste
Source : Emmanuel Macron, le 9 juin 2025
Lors de la Conférence des Nations unies sur l’océan, Emmanuel Macron a qualifié la haute mer de « zone de non-droit ». Une formule largement admise dans les médias, mais juridiquement inexacte.
Alors que la question des océans s’est invitée en France à l’occasion de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’océan (UNOC-3), organisée à Nice du 9 au 23 juin 2025, le président Emmanuel Macron a comparé la haute mer à un « Far West », n’hésitant pas à la qualifier de « zone de non-droit ».
Cette expression est fréquemment relayée par des ONG et des médias, qui souhaitent attirer l’attention sur les dérives environnementales et les remises en cause du multilatéralisme.
Pourtant, d’un point de vue du droit international, cette formulation est trompeuse. La haute mer n’est pas un espace vide de règles. C’est, au contraire, une zone encadrée par un corpus juridique ancien, étoffé et toujours en évolution.
Un espace régi par le droit depuis de nombreux siècles
La haute mer correspond aux zones maritimes situées au-delà de la juridiction nationale. Seule la colonne d’eau est concernée, car les sols et sous-sols marins relèvent d’un régime juridique distinct, le régime de la « Zone internationale des fonds marins », qualifiée de « patrimoine commun de l’humanité » (article 136 CNUDM).
Selon l’article 86 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), la haute mer comprend toutes les parties de la mer situées au-delà des zones économiques exclusives, mers territoriales, eaux intérieures et eaux archipélagiques. Cela représente plus de la moitié de la surface de la planète et 64 % des océans.
Bien loin de l’image d’un « Far West » ou d’une « zone de non-droit », dans laquelle aucune règle juridique ne s’appliquerait, la haute mer, bien que « libre », est encadrée juridiquement depuis l’Antiquité.
Le droit romain posait déjà des règles d’usage pour les espaces maritimes. Avec le développement du commerce maritime, de nombreux pactes, traités et conventions ont été créés, ainsi que divers instruments internationaux de régulation des espaces marins, tels que les arbitrages, autorisations et injonctions. Plus récemment, dans la seconde moitié du XXe siècle, une série de quatre conventions sur le droit de la mer a été adoptée à Genève en 1958, dont l’une consacrée spécifiquement à la haute mer.
La Convention de Montego Bay, « constitution des océans »
Le socle actuel de ce droit est posé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM), adoptée en 1982 à Montego Bay et entrée en vigueur en 1994. Souvent surnommée « la Constitution des océans », elle structure aujourd’hui l’ensemble du droit international de la mer.
La Convention de Montego Bay consacre plusieurs libertés en haute mer relatives à la navigation, au survol, à la pose de câbles et de pipelines sous-marins, à la pêche ainsi qu’à la recherche scientifique. Ces libertés, cependant, ne sont ni absolues ni exemptes de règles.
Ainsi, l’article 87 impose que leur exercice se fasse dans le respect des droits des autres États. L’article 192 établit une obligation générale de protection et de préservation du milieu marin. Quant à l’article 116, il encadre l’activité de pêche afin de prévenir la surexploitation des ressources et de garantir un partage équitable entre les États.
Les navires en haute mer demeurent soumis à la compétence exclusive de l’État du pavillon, qui doit exercer à leur égard son contrôle et sa juridiction effectifs (articles 92 et 94 CNUDM), sauf exceptions limitativement énumérées dans l’article 110 de la Convention. La haute mer n’est donc ni une « zone de non-droit » ni un « Far West ».
Il est erroné de considérer la haute mer comme un espace hors de tout contrôle juridique, puisque son fonctionnement est encadré par un ensemble précis de règles et obligations internationales. Ce n’est pas tout : la Convention est directement complétée par trois accords qui s’y rapportent expressément.
Une gouvernance multilatérale renforcée par un nouvel accord
Face aux enjeux environnementaux croissants, la gouvernance multilatérale de la haute mer a été renforcée en 2023 par l’adoption d’un nouvel accord, dit Accord « BBNJ » (« Biodiversity Beyond National Jurisdiction », en anglais). Ce texte vise à compléter la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en établissant des règles relatives à la création d’aires marines protégées, à la réalisation d’études d’impact environnemental, au transfert de technologies et au partage équitable des bénéfices issus des ressources génétiques marines.
Il s’inscrit dans la continuité des accords de 1994 relatif à la Partie XI (Zone internationale des fonds marins) et de 1995 sur les stocks de poissons migrateurs. L’Accord BBNJ nécessite que soixante États le ratifient pour entrer en vigueur. Ce seuil pourrait être atteint d’ici à la fin de l’année 2025.
En plus de ces trois accords se rapportant à la Convention de Montego Bay, une multitude d’accords internationaux gravitent autour de la Convention et rendent le cadre juridique très dense, soit tout le contraire d’une zone de non-droit.
Citons, entre autres traités qui s’intéressent le milieu marin : les conventions signées dans le cadre de l’Organisation maritime internationale, la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, ou encore la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique de 2001.
Il existe par ailleurs de nombreuses conventions « régionales » qui visent à protéger des espaces déterminés, comme la Convention OSPAR de 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, la Convention de Barcelone de 1976 pour la protection de la Méditerranée ou la Convention de Nouméa de 1986 sur la protection des ressources naturelles et de l’environnement de la région du Pacifique Sud.
Enfin, de nombreux instruments juridiques dits de « soft law » (« droit souple », en français) complètent ce régime, tel que l’objectif de développement durable n° 14 de l’Agenda 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies, qui vise à « conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ».
Des juges nationaux, régionaux et internationaux
Par ailleurs, la haute mer n’échappe pas au contrôle judiciaire, avec plusieurs instances régionales, nationales et internationales chargées de veiller au respect de ces normes.
La Convention de 1982 a institué une juridiction internationale spécialisée, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), chargé de trancher les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Convention.
La Cour internationale de justice, les tribunaux arbitraux ainsi que, dans certains cas, des juridictions nationales et régionales, peuvent aussi connaître d’affaires relatives à la haute mer.
Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a expressément rappelé, notamment par deux arrêts (Medvedyev et autres c. France du 29 mars 2010 et Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012), que la haute mer n’est pas une zone de non-droit.
Au-delà des nombreux instruments spécifiques du droit de la mer qui régissent la haute mer, d’autres branches du droit international public — telles que le droit des droits de l’homme, le droit d’asile ou le droit relatif aux changements climatiques — s’y appliquent également. Bien que certains États ou acteurs privés puissent être tentés d’ignorer ce cadre, cela ne remet en cause ni son existence ni sa légitimité.
Vers une consolidation continue du droit international de la mer
D’autres initiatives internationales visant à renforcer la protection de la haute mer sont en cours. Un projet de traité sur la pollution plastique est en négociation depuis 2022 sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). La sixième session de négociation doit avoir lieu à Genève du 5 au 14 août 2025.
Autre initiative, le plan « Océan silencieux », annoncé lors de la Conférence de Nice et soutenu par une coalition de trente-sept États, vise à encadrer les nuisances acoustiques liées au transport maritime, en coordination avec l’Organisation maritime internationale (OMI). Ces évolutions témoignent d’une consolidation progressive du droit international applicable aux espaces maritimes, loin de constituer un vide juridique.
Ainsi, qualifier la haute mer de « zone de non-droit » est juridiquement inexact. Cette formule, sans doute efficace sur le plan médiatique, occulte la réalité d’un cadre juridique dense et en perpétuelle évolution. Si des lacunes peuvent être identifiées, elles concernent davantage l’application et la portée des règles, plutôt que leur inexistence. En réalité, on oublie trop souvent que, si certaines dérives font parfois l’actualité, de nombreux acteurs publics et privés (États, entreprises, navires, ONG…) respectent scrupuleusement le droit applicable en haute mer.
[Mise à jour : une mauvaise version de l’article a été publiée par erreur le 27 juin 2025 avant d’être retiré du site quelques heures plus tard.]