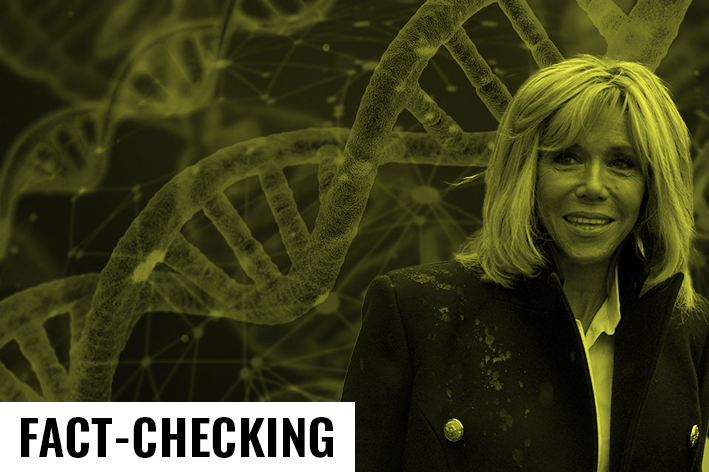Informer les victimes de la sortie de prison de leurs agresseurs : la mesure proposée par Gérald Darmanin est-elle innovante ?
Autrice : Manon Scotte, doctorante en droit privé et sciences criminelles à l’université de Lille
Relecteurs : Jean-Baptiste Thierry, Professeur de droit pénal, université de Lorraine
Maylis Ygrand, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Maylis Ygrand, journaliste
Source : Interview de Gérald Darmanin, LCI, le 14 octobre 2025
Lors d’une interview pour LCI, Gérald Darmanin a regretté que les victimes soient les « grandes oubliées […] du ministère de la Justice ». Pour y pallier, le garde des Sceaux appelle dans une circulaire à, dès à présent, informer toutes les victimes quand leur agresseur sort de prison. Conditionnée et lacunaire, cette mesure existe néanmoins déjà.
Gérald Darmanin au chevet des victimes ? Lors d’une interview diffusée par la chaîne LCI, le mardi 14 octobre 2025, le garde des Sceaux a déploré le manque de considération des victimes d’infraction, qu’il qualifie de « grandes oubliées de l’action publique en général et du ministère de la Justice en particulier ».
Face à cette supposée indifférence, le ministre de la Justice a annoncé la publication d’une circulaire relative à l’accueil et à l’amélioration de la prise en charge des victimes d’infractions pénales. Parmi les mesures visées, Gérald Darmanin souhaite que « toutes les victimes [soient] prévenues quand leur agresseur sort de prison, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et parfois peut créer des drames ».
Mais si ce droit est conditionné, il existe déjà dans le Code de procédure pénale. Le garde des Sceaux aurait-il oublié certaines dispositions procédurales ou souligne-t-il les lacunes existantes ? Quoi qu’il en soit, cette déclaration du ministre de la Justice mérite d’être précisée.
Des victimes pouvant être impliquées dans le projet de sortie
Depuis sa création par la loi du 15 juin 2000, l’article préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que « l’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ».
Parmi ces derniers, exposés à l’article 707 du Code de procédure pénale, figure celui d’être informé de la fin de l’exécution d’une peine privative de liberté. Les articles 712-16-1 et 712-16-2 viennent ensuite fixer le cadre.
D’abord, l’article 712-16-1 du Code de procédure pénale enjoint les juridictions d’application des peines de prendre en considération les conséquences de cette décision sur les intérêts de la victime lorsque la libération du condamné est envisagée avant la date d’échéance de sa peine.
C’est le cas dans lequel l’exécution de la peine est aménagée par des modalités destinées à la réinsertion du condamné. La juridiction d’application des peines a la faculté d’octroyer, par exemple, une mesure de semi-liberté, de détention à domicile sous surveillance électronique ou encore de libération conditionnelle.
Dans ces circonstances, le juge d’application des peines peut, s’il l’estime opportun et avant de prendre une décision, informer la victime qu’elle peut lui présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours. En plus d’être informée du projet de sortie de son agresseur, la victime peut ainsi avoir un rôle actif dans la prise de décision.
Cette règle s’applique sans considération de la nature de l’infraction commise et préalablement à toute décision entraînant la cessation même temporaire de l’incarcération.
Des infractions bien précises
Quant à l’article 712-16-2 du même code, son sixième alinéa fixe plusieurs conditions à ce droit d’information : l’affaire doit concerner un certain type d’infractions, la victime doit en avoir fait la demande et la peine doit être arrivée à échéance.
La personne condamnée doit donc avoir commis une infraction au sein du couple en vertu de l’article D1-11-2 du Code de procédure pénale ou une des infractions prévues à l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Ces dernières concernent très majoritairement des faits de nature sexuelle ou commis sur un mineur. Mais certaines infractions en la matière échappent à cette garantie d’information.
Par exemple, dans l’affaire d’Elias — citée dans l’interview de Gérald Darmanin —, les mis en cause sont poursuivis du chef d’extorsion avec violences ayant entraîné la mort.
L’infraction est certes punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d’amende mais ne figure pas dans le champ d’application de l’article 712-16-2. Autrement dit : le droit à l’information n’est pas prévu pour ce type d’infraction, alors même que la victime était ici mineure.
Pour bénéficier des garanties d’informations prévues à l’alinéa 6 de l’article 712-16-2 du Code de procédure pénale, la victime doit expressément demander à être prévenue. Ce droit à l’information, qui ne concerne que le cas où le condamné est incarcéré jusqu’au terme de sa peine, doit être réclamé auprès du procureur de la République (article D49-65-1 du Code de procédure pénale).
Une interdiction d’entrer en contact avec la victime
Enfin, en dehors de son sixième alinéa, l’article 712-16-2 du Code de procédure pénale prévoit d’autres possibilités afin d’éviter que les victimes croisent leurs agresseurs. Le juge d’application des peines peut prononcer une interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître à proximité de son lieu d’habitation ou de travail lorsque cette rencontre est plausible et paraît devoir être évitée.
Dans ce cas-là, l’obligation est même de principe car, en vertu de l’article D49-72 du Code de procédure pénale, la victime doit prévenir le parquet si elle ne souhaite pas être avertie des modalités d’exécution de la peine.
La victime est donc inévitablement informée de la sortie ou du projet de sortie de détention, sauf si sa personnalité justifierait de ne pas le faire ou que le condamné bénéficie seulement d’une permission de sortie. À noter, ces prescriptions relatives à l’information s’appliquent également dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une fin de détention provisoire, ou lorsque les mesures d’interdiction arrivent à échéance à la fin d’une période de sursis probatoire.
Une évolution fulgurante des droits des victimes
En somme, le dispositif d’information de la victime à propos de la libération temporaire ou définitive de la personne condamnée varie selon la nature de l’infraction, la date d’échéance de la peine et la volonté du juge d’application des peines. Le droit à l’information n’est donc pas absolu et apparaît perfectible.
Toutefois, considérer les victimes comme de « grandes oubliées » de l’action publique relaie une vision obsolète de la justice pénale, au sein de laquelle elles ne sont définitivement plus des intruses.
Le garde des Sceaux emprunte en réalité une expression utilisée il y a plus de vingt ans par la doctrine pénale et qui n’a plus grand sens tant les droits des victimes ont connu une évolution fulgurante.
Au fond, Gérald Darmanin ne fait donc qu’encourager ce qui existe déjà et la forme en témoigne : les instructions données par la voie d’une circulaire n’ont aucune autre incidence que celle de commenter, fixer ou orienter l’application d’une loi ou d’un règlement existant. La circulaire, publiée au Journal officiel le 13 octobre 2025, nous fait donc tourner en rond.















 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents