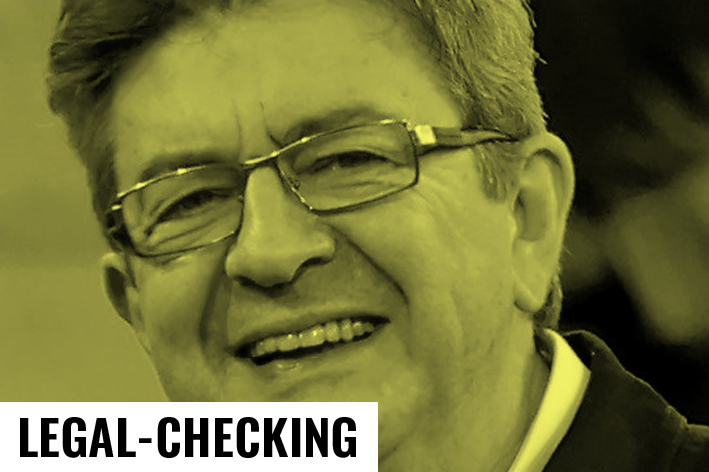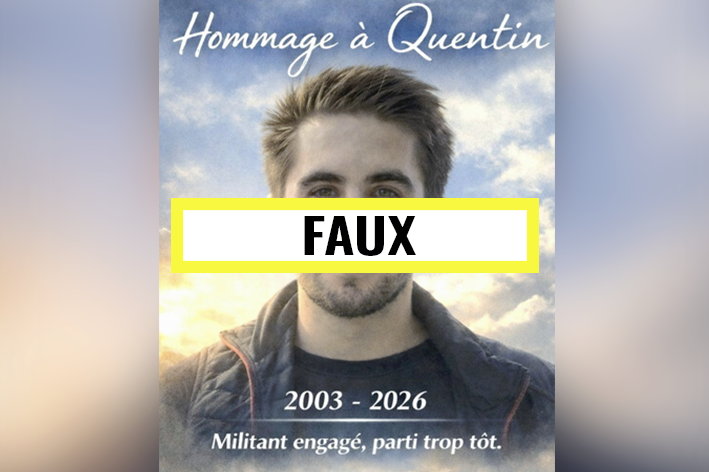Inéligibilité de Marine Le Pen : la démocratie a-t-elle été « exécutée » comme l’affirme Jordan Bardella ?
Dernière modification : 2 avril 2025
Autrices : Alicia Desbeux, M2 Droit pénal approfondi
Claire Harion, M2 Droit pénal financier et international, Faculté de Nancy
Relecteurs : Etienne Merle, journaliste
Jean-Baptiste Thierry, professeur de droit pénal à l’université de Lorraine
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Maylis Ygrand, journaliste
Source : Compte X de Jordan Bardella, le 31 mars 2025
Marine Le Pen a été condamnée à une peine d’inéligibilité de cinq ans avec effet immédiat. Une décision critiquée par Jordan Bardella qui accuse la justice d’avoir « exécuté » la démocratie. En réalité, le prononcé de cette peine n’est que l’application conforme de la loi votée par les parlementaires.
Les réactions sont à la mesure de l’évènement. Ce lundi 31 mars, le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision concernant l’affaire des assistants parlementaires du Front national (renommé Rassemblement national depuis le 1er juin 2018).
Le tribunal de Paris a reconnu coupable Marine Le Pen de détournement de fonds publics à l’issue de près de dix ans d’enquête. La députée a été condamnée à quatre ans d’emprisonnement, dont deux fermes aménageables sous surveillance électronique, 100 000 euros d’amende ainsi que cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire.
Si l’envergure politique de Marine Le Pen — deux fois finalistes à l’élection présidentielle — rend cette décision exceptionnelle, le prononcé de cette peine est récurrent. L’ancien maire de Toulon Hubert Falco ou dernièrement Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande, ont été condamnés pour des infractions d’atteinte à la probité, à cinq ans d’inéligibilité également avec exécution provisoire.
Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle été condamnée ?
De 2017 à 2023, dans les affaires de détournements de fonds publics, les condamnations ont toujours inclus une peine complémentaire d’inéligibilité, selon les statistiques transmises par le ministère de la Justice auprès de Libération en novembre dernier. Ainsi, la condamnation à l’encontre de Marine Le Pen résulte plutôt d’une continuité d’une jurisprudence constante que d’un parti pris des juges ou d’une sévérité inhabituelle.
Dans la décision, le tribunal insiste sur le contexte des infractions commises en relevant que « les infractions commises dont la gravité a été relevée, sont liées à l’exercice d’un mandat électif public et ont précisément constitué, au-delà des manquements à l’exigence de probité, une atteinte aux règles du jeu démocratique au préjudice du corps électoral dans son ensemble ».
S’agissant plus particulièrement de l’exécution provisoire, ils ajoutent : « La proposition de la défense de laisser le peuple souverain décider d’une hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui découlerait du statut d’élu ou de candidat, en violation du principe d’égalité devant la loi ».
Quant au risque de récidive, ils insistent sur la défense choisie par Marine Le Pen, consistant à revendiquer une impunité pour les faits commis : « Dans le cadre de ce système de défense d’un parti autant que de ses dirigeants, qui tend à contester la compétence matérielle du tribunal autant que les faits, dans une conception narrative de la vérité, le risque de récidive est objectivement caractérisé ».
Concernant l’exécution provisoire, elle signifie l’application immédiate de la peine, après décision du tribunal correctionnel, quand bien même Marine Le Pen interjetterait appel, ce qu’elle entend faire dans les plus courts délais, selon les dires de son avocat Rodolphe Bosselut et sa déclaration sur le plateau de TF1.
Une démocratie française au contraire affirmée
Jordan Bardella et d’autres personnalités politiques de tout bord critiquent l’application de cette peine complémentaire en ce qu’elle porterait atteinte à la démocratie française, refusant la liberté au peuple de choisir qui élire lors des prochaines élections présidentielles. Pourtant, l’application de la peine d’inéligibilité est au contraire la manifestation de l’exercice de la démocratie. En effet, un rappel de l’instauration de cette peine s’impose.
Contrairement à une idée répandue, cette sanction n’a pas été introduite par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui vise à renforcer la transparence et la probité en politique. L’inéligibilité existait bien avant : la seule différence réside dans son application. Auparavant, elle relevait de l’appréciation du juge, qui devait justifier sa décision de l’imposer. Depuis la loi Sapin 2, la logique s’est inversée : le juge doit désormais motiver son choix de ne pas la prononcer.
Dans le jugement, les magistrats rappellent que, puisque les faits reprochés à Marine Le Pen sont antérieurs à cette réforme, l’inéligibilité n’était pas automatique. Pourtant, ils ont estimé nécessaire de l’appliquer, conformément à la volonté du législateur (les parlementaires) d’assurer la probité des élus.
Ainsi, loin d’être une décision arbitraire, cette condamnation s’inscrit dans le cadre légal défini par le Parlement. Difficile, dans ces conditions, d’y voir un déni de démocratie : c’est au contraire l’application d’une loi votée par les représentants du peuple.
Si le débat sur la pertinence de cette peine et son impact sur la vie politique est légitime, il n’en demeure pas moins que son application dans cette affaire témoigne du bon fonctionnement des institutions démocratiques. Parler d’une « exécution » de la démocratie, comme le fait Jordan Bardella, est aussi faux en droit, qu’en fait.