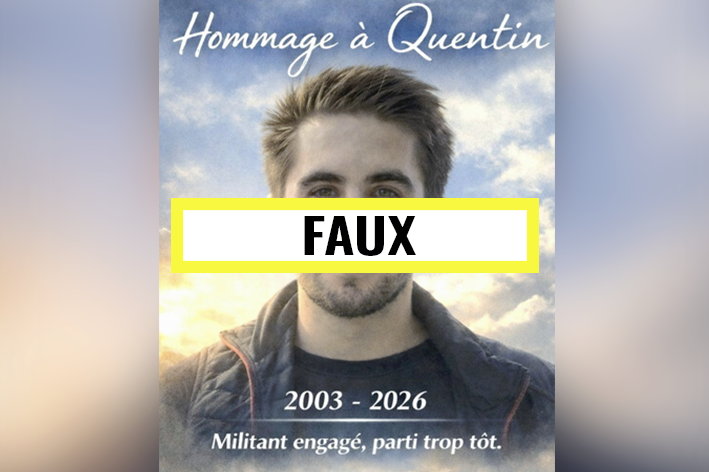Gaza : Israël avait-il le droit d’intercepter les bateaux de la Global Sumud Flotilla ?
Autrice : Clara Robert-Motta, journaliste
Relectrices : Hélène Raspail, professeure en droit public international à l’université du Mans
Pascale Ricard, chargée de recherche au CNRS au laboratoire Droit international, européen et comparé de l’université Aix-Marseille
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste
Source : Ministère des affaires étrangères israélien, le 2 octobre 2025
Entre le 1er et le 2 octobre 2025, l’armée israélienne a arraisonné les bateaux de la Global Sumud Flotilla. Une cinquantaine de navires en route depuis les côtes espagnoles transportaient de l’aide humanitaire et entendaient briser le blocus autour de Gaza qu’ils jugent illégal. Ces interceptions qui ont eu lieu au-delà de la mer territoriale sont illégales au regard du droit de la mer.
Les images de cette cinquantaine de bateaux, un drapeau de la Palestine battant sur chacun d’entre eux, ont fait le tour du monde. Ce 2 octobre, ce sont d’autres images, celles de soldats israéliens sur le pont de ces mêmes bateaux, qui circulent à travers le globe. Entre le 1er et le 2 octobre, les bateaux de la Global Sumud Flotilla ont été arraisonnés par l’armée israélienne.
Les navires, qui ont pour leur grande majorité quitté l’Espagne fin août, avaient pour but d’accéder à la bande de Gaza afin de briser le blocus humanitaire imposé par Israël autour du territoire palestinien et jugé illégal par la Global Sumud Flotilla.
Alors que leurs bateaux ont été arraisonnés les uns après les autres, l’organisation dénonce des interceptions illégales et le « kidnapping » des personnes à leur bord, dont de nombreux élus, personnalités médiatiques du monde entier. De son côté, le gouvernement israélien assure être dans son bon droit, car les navires briseraient un « blocus légal ».
La question de la localisation des araisonnages est essentielle, car Israël – bien qu’il invoque la protection de son blocus pourtant contesté – a intercepté les bateaux dans une zone sur laquelle il n’avait pas de souveraineté, et le blocus ne permet pas d’arrêter des navires qui transportent de l’aide humanitaire.
Des interceptions à l’écart d’une zone de souveraineté israélienne
Aux alentours de 4 heures du matin, jeudi 2 octobre, le bateau dans lequel naviguait l’eurodéputée française, Rima Hassan, est approché par un navire de l’armée israélienne. L’élue française filme en direct avant de jeter son téléphone à la mer. D’après les dernières coordonnées GPS du tracker de l’organisation, le Captain Nikos se trouvait à une quarantaine de milles des rives palestiniennes lorsqu’il a été intercepté.
D’après une communication du gouvernement israélien, aucun navire de la flottille n’aurait réussi à franchir la limite du blocus et le dernier bateau a été intercepté le 3 octobre.
Or, l’endroit dans lequel les bateaux ont été interceptés compte. En effet, les États ont un droit sur les eaux qui jouxtent leurs côtes maritimes. La convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite de « Montego Bay » (1982) édicte des règles simples : jusqu’à 12 milles à partir du rivage, c’est la « mer territoriale » sur lequel l’État exerce une souveraineté juridique (et qui s’étend au survol aérien). Il peut exister une « zone contiguë » (jusqu’à 12 milles après la fin de la mer territoriale – donc 24 milles maximum du rivage) dans laquelle l’État n’est pas souverain, mais dans lequel il peut exercer un contrôle en vue de « prévenir des infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale ».
Après, et jusqu’à 200 milles nautiques, il peut exister une zone économique exclusive (ZEE) pour l’État côtier. En Méditerranée, comme l’espace est restreint, les frontières maritimes sont conflictuelles et pas forcément universellement admises par tous les États. Ici, les navires ont été arrêtés, pour leur majorité, dans la ZEE égyptienne, et non pas israélienne. Quoi qu’il en soit, cette distinction ne change rien.
« Les ZEE ne sont pas des zones de souveraineté, explique Nathalie Ros, professeur de droit public à l’université de Tours et spécialiste du droit international de la mer. L’État n’a que des droits souverains sur les ressources et pas sur la zone elle-même ; en d’autres termes pour tout ce qui n’est pas économique (pêche, exploitation des énergies et des minerais, des fossiles) ou environnemental, comme par exemple la navigation, le régime juridique applicable en ZEE est celui de la haute mer (les eaux internationales), c’est-à-dire la liberté de navigation. »
Comme le précise la convention de Montego Bay, seul l’État du pavillon du bateau (qui est l’endroit où est enregistré le navire) a juridiction sur celui-ci en haute mer. Or, les navires de la flottille ont des pavillons différents comme, par exemple, la Grèce ou bien la France.
Ici, l’immense majorité des bateaux semblent avoir été arrêtés bien plus loin que la ligne de la zone contiguë ou de la mer territoriale de Gaza – sur lesquelles Israël n’a, de toute façon, pas de pouvoir souverain – et ne sont pas sous pavillon israélien. Israël n’avait donc pas de pouvoirs de police dans cette zone.
Le blocus permet-il de faire une exception ?
La règle générale est donc qu’aucun État ne peut intercepter de navires en haute mer, mais il existe certaines exceptions. Dans certains cas bien précis que sont, principalement, les actes de piraterie (criminalité en guerre) ou la lutte contre l’esclavage (trafic d’être humains) (Montego Bay 1982, article 110).
« Le blocus peut être une exception pour arraisonner un bateau en haute mer, mais il faut qu’il soit conforme au droit des conflits armés »
Israël, pour sa part, justifie ses interventions par le blocus auquel il soumet la bande de Gaza depuis 2007 qu’il estime légal. « Le blocus peut être une exception pour arraisonner un navire en haute mer, mais il faut qu’il soit conforme au droit des conflits armés », développe Kiara Neri, professeur de droit international et directrice du centre de droit international de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Après l’interception des bateaux de la flottille, des manifestants ont apporté leur soutien aux membres des équipages arrêtés et à la Palestine. Ici, place de la République à Paris en France, le 2 octobre 2025. Crédit : Stéphane de Sakutin / AFP
Tout d’abord, dans le cas où le blocus est légal, l’État qui l’impose peut arraisonner les navires commerciaux « dont on suppose raisonnablement qu’ils violent le blocus, comme l’édicte le Manuel de San Remo adopté en 1994 qui codifie le droit coutumier sur les conflits en mer.
Le caractère humanitaire des bateaux
Ici, les bateaux de la flottille n’étaient pas commerciaux, mais à visée humanitaire. Selon l’organisation, ils transportaient des vivres et du matériel médical. Israël conteste ce dernier point, malgré les images montrant des cargaisons humanitaires à bord des bateaux.
Selon le gouvernement, la Global Sumud Flotilla a refusé de débarquer sa cargaison au port d’Ashkelon pour qu’Israël se charge lui-même de la distribution, comme l’Etat hébreu l’avait proposé. Un refus justifié par les organisateurs de la flottille par les critiques récurrentes contre l’inefficacité des mécanismes d’aide humanitaire chapeautés par Israël pour contrôler les points d’entrée après un blocus total pendant deux mois entre mars et mai 2025.
D’autant qu’un blocus maritime doit respecter certaines règles. Il est donc interdit « s’il a pour unique objectif d’affamer la population civile ou de lui interdire l’accès aux autres biens essentiels à sa survie » ou « si les dommages causés à la population civile sont, ou si on peut prévoir qu’ils seront, excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » (article 102 du Manuel de San Remo).
« Le blocus maritime est une limitation de la liberté de navigation, il faut donc que le pays qui l’exerce en tire des bénéfices militaires concrets. De plus, il faut qu’il ait lieu dans le cadre d’une action militaire licite. »
« Le blocus maritime est une limitation de la liberté de navigation, il faut donc que le pays qui l’exerce en tire des bénéfices militaires concrets, précise Hélène Raspail, professeur en droit public international à l’université du Mans. De plus, il faut qu’il ait lieu dans le cadre d’une action militaire licite. »
Or l’action d’Israël qui a imposé un siège autour de la bande de Gaza dès juin 2007 est contestée, comme nous l’avions expliqué. Les débats juridiques autour du blocus israélien avaient atteint leur paroxysme en 2010 alors qu’une flottille avait déjà tenté de briser le blocus. Neuf ressortissants turques avaient été tués.
La Cour internationale de justice, dans sa décision provisoire du 26 janvier 2024, avait déjà estimé, au vu de la situation, qu’aucun pays ne pouvait entraver l’aide humanitaire destinée à Gaza.
Ainsi, de la même façon que le blocus terrestre est largement contesté, le blocus maritime est illicite.
















 réservé aux adhérents
réservé aux adhérents