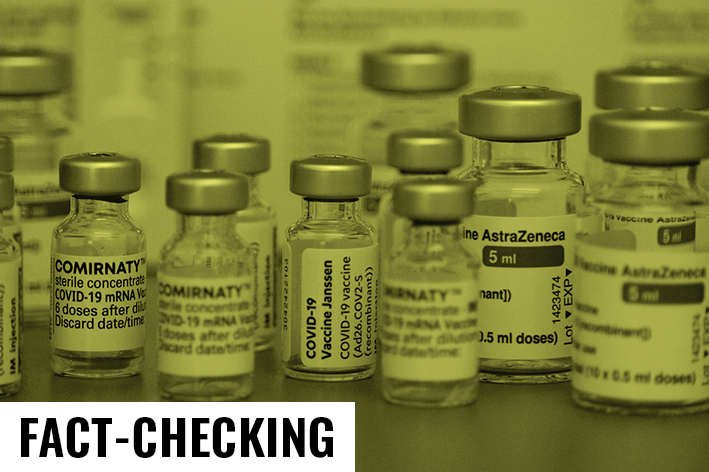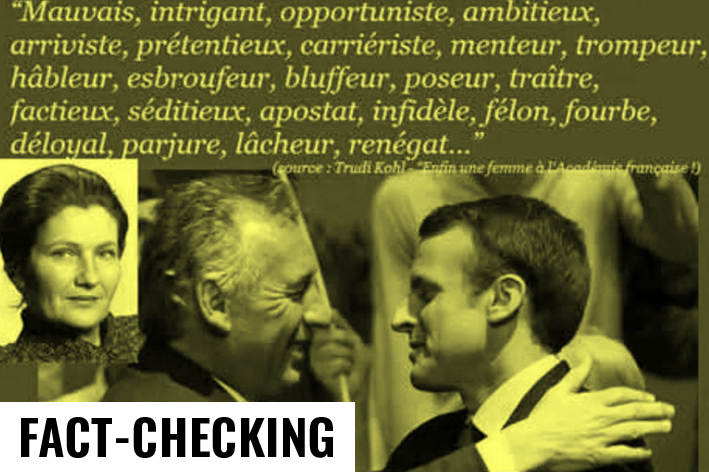La France a-t-elle oublié d’abroger le Code Noir en 1848, comme l’affirme le député LIOT Laurent Panifous ?
Autrice : Maylis Ygrand, journaliste
Relectrice et relecteur : Clara Robert-Motta, journaliste
Jean-Paul Markus, professeur de public, université Paris-Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Léocadie Petillot, juriste et journaliste en formation au CFJ
Source : Laurent Panifous à l’Assemblée nationale, le 13 mai 2025
À en croire le député Laurent Panifous (LIOT), le Code Noir n’aurait pas été abrogé en 1848 en même temps qu’était aboli l’esclavage. Bien que ce code soit devenu inapplicable lorsque la pratique de l’esclavage fut interdite, le parlementaire demande son abrogation en raison de considérations symboliques. Mais certains historiens du droit ne sont pas arrivés aux mêmes conclusions que le député.
Une abolition en bonne et due forme. Voilà la requête qu’a formulée le député Laurent Panifous, le 13 mai 2025, concernant le Code Noir. Marqueur symbolique de l’esclavagisme, cet édit royal de mars 1685 — qui sera par la suite dénommé « Code Noir » — avait été abrogé une première fois en 1794 avant d’être rétabli en 1802.
Reste que le 27 avril 1848, lorsque l’esclavage est aboli, le décret d’abolition en question ne mentionne pas textuellement le Code Noir. Sauf que celui-ci ne réglemente que des questions relatives à l’esclavage. Ce dernier perd donc tous ses effets et devient une coquille vide juridique.
Cent soixante-dix sept ans plus tard, le président du groupe LIOT à l’Assemblée nationale, Laurent Panifous, argue que « La France n’a jamais abrogé le Code Noir […] Applicable ou pas, ce n’est pas le débat, nous parlons ici de dignité humaine, de symbole que l’on doit à ces femmes et hommes mis en captivité ». Avant d’interpeller François Bayrou : « Monsieur le Premier ministre, l’heure est venue pour la République de se laver de cette ignominie qu’est le Code Noir ».

Le député de Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires Laurent Panifous intervient lors d’une séance des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le 13 mai 2025. Photo : Ludovic MARIN / AFP
À cette interpellation, François Bayrou répond que « si le Code Noir n’a pas été aboli en 1848, il faut qu’il le soit » et « prend l’engagement, au nom du gouvernement, qu’un texte actant l’abolition du Code Noir sera présenté au Parlement ».
Tout d’abord, notons que lorsque le Code Noir a été rétabli en 1802, il ne l’a été que dans les colonies françaises, pas dans la métropole. Cela signifie qu’en tout état de cause le Code Noir ne s’applique pas dans l’Hexagone depuis cette date. De plus, aujourd’hui en 2025, la France n’a plus de colonies, ce code n’a donc théoriquement plus d’espaces physiques où s’appliquer. Le Code Noir n’a donc aucune portée juridique concrète de nos jours.
Mais comment cette scène a-t-elle bien pu survenir ? Pourquoi le décret du 27 avril 1848 n’a-t-il pas tout bonnement aboli le Code Noir ? Deux historiens du droit, interrogés par Les Surligneurs, nous livrent quelques clés de réponse sur le sujet.
Une abrogation implicite
C’est une question que ces deux spécialistes ne se sont jamais posés. Frédéric Charlin et Jean-François Niort, historiens du droit, ont tous deux travaillé sur le Code Noir. Mais ni l’un ni l’autre n’étaient arrivés aux conclusions du député LIOT.
Pour Frédéric Charlin, maître de conférences en histoire du droit et des institutions à l’université Grenoble Alpes, auteur d’une thèse sur le droit colonial de l’esclavage, il est question ici soit d’« une abolition ou d’une abrogation implicite », soit d’« un texte qui devient sans objet puisque la pratique qu’il autorisait est abolie ».
Quant à Jean-François Niort, ça ne fait aucun doute : « Ce code est abrogé ». Et ce, en raison d’un concept juridique du droit français : l’abrogation tacite ou implicite. En plus du décret d’abolition, « quelques mois plus tard, dans la Constitution de novembre 1848, il y a un article qui confirme l’abolition de l’esclavage [article 6, ndlr] ». Doublant les propos du décret, ce texte entrainerait une abrogation tacite du Code Noir. En effet, « deux lois ou deux textes juridiques contraires ne peuvent pas coexister dans un même système juridique ». Et « deux lois ou deux textes juridiques contraires ne peuvent pas coexister dans un même système juridique ». Et « si l’esclavage est constitutionnellement interdit, par définition tous les textes juridiques afférents sont abrogés de droit », conclut Jean-François Niort.
En principe, il revient au juge administratif de constater l’abrogation implicite d’une loi, en étant saisi d’un recours contre un acte pris en application de cette loi. Mais dans le cas du Code noir, désormais inapplicable, aucun acte de cette nature ne peut être contesté. Il est, par exemple, inimaginable qu’un décret vienne aujourd’hui fixer des quotas d’esclaves par exploitation agricole. En l’absence d’un tel acte d’exécution, aucun contentieux ne peut être porté devant le juge : il en résulte une impasse juridique.
C’est précisément cette situation qui justifie la demande formulée par un député d’adopter une loi d’abrogation expresse.
Le problème se poserait de la même manière si on voulait soulever une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel.
L’historien du droit pointe aussi le concept juridique de parallélisme des formes, qui expliquerait pourquoi le décret d’abolition ne pouvait tout simplement pas abroger explicitement le Code Noir. Ce concept impose qu’une loi ne peut être abrogée que par une loi, un décret par un décret, etc. Ainsi, selon Jean-François Niort, « en 1848, le gouvernement provisoire ne peut pas par simple décret abroger le Code Noir parce que c’est une loi, un décret ne peut pas abroger une loi ».
Des centaines de textes régissant l’esclavage
Devenu un symbole du droit colonial de l’esclavage, le Code Noir est pourtant loin d’être le seul texte juridique à avoir régi ce qui est désormais un crime contre l’humanité, reconnu comme tel par le droit français en 2001. Et si l’édit royal avait été aboli, « quid des centaines et des centaines d’autres textes [sur l’esclavagisme, nldr] qui ont suivi jusqu’en 1846 ? », interroge Jean-François Niort.
Frédéric Charlin suppose ainsi que « la grande variété de normes juridiques (plusieurs centaines de textes nationaux et locaux entre 1635 et 1848) régissant l’esclavage colonial peut rendre difficile la référence à un seul texte (aussi symbolique soit-il) parmi d’autres ». De plus, le Code Noir ne régissait pas l’ensemble des colonies françaises, mais uniquement les colonies antillaises et la Guyane. « Cela pourrait peut-être donner l’idée que l’on néglige d’autres territoires, comme la Louisiane ou l’Ile Bourbon [aujourd’hui l’île de la Réunion, ndlr], où d’autres versions du Code Noir s’appliquaient ».
Ce n’est pas le seul oubli qui interpelle Jean-François Niort. « Laurent Panifous n’a pas parlé de la dimension criminelle du Code Noir ». Selon l’historien, le Code Noir pourrait effectivement être reconnu, en tant que tel, comme un crime contre l’humanité. « Un crime contre l’humanité, il ne suffit pas de l’abroger, il faut le reconnaître, un crime doit être qualifié juridiquement. » Et ce, pour entraîner de potentielles réparations.