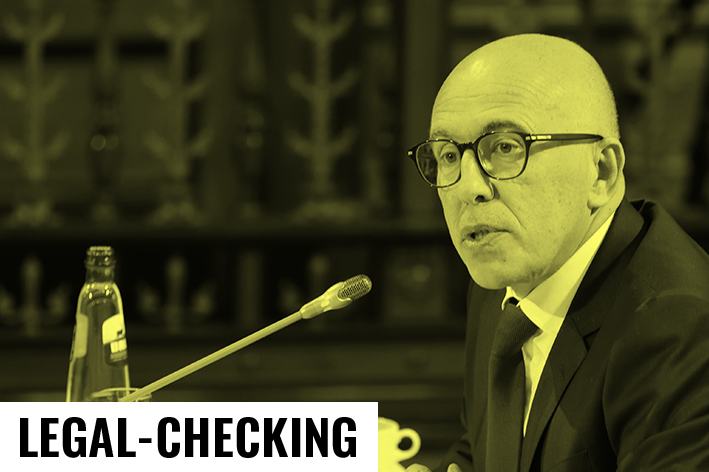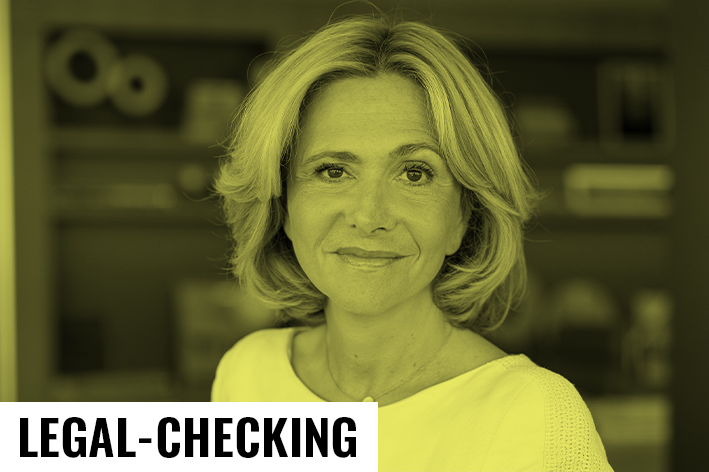« Bloquons tout » : les salariés ont-ils le droit de faire grève ?
Dernière modification : 16 septembre 2025
Auteur : Pascal Caillaud, chargé de recherche CNRS en droit social à l’université de Nantes
Relecteur : Nicolas Turcev, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Nicolas Turcev, journaliste
Apparu sur les réseaux sociaux puis encouragé par certains partis politiques, le mouvement social du 10 septembre appelle à « bloquer le pays ». Mais cette invitation est-elle suffisante pour que les salariés puissent invoquer le droit de grève ?
Grève ou pas grève ? À la veille du mouvement social « bloquons tout », le 10 septembre, certains salariés s’interrogent : peuvent-ils cesser l’activité sans encourir de risques ? Si le droit de grève ne peut s’exercer que dans certaines conditions précises définies par le droit, les circonstances de la mobilisation du 10 septembre autorisent d’y recourir. Explications.
Une définition stricte de la grève
Comme pour les Gilets jaunes, la mobilisation du 10 septembre est un mouvement de protestation appuyant diverses revendications économiques et sociales. Il s’appuie sur des appels aux blocages de voies publiques, à ne plus payer avec sa carte bancaire, à retirer tout l’argent sur son compte…
En cela, il peut être qualifié de « mouvement social », de la même manière que d’autres mouvements de protestation, comme la mobilisation contre le contrat première embauche, en 2006, ou les marches pour le climat en 2018 et 2019. Mais cette notion de « mouvement social », juridiquement indéfinie, n’ouvre pas automatiquement la possibilité de faire grève, qui n’est permise que dans des cas bien définis.
Reconnue par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la grève est une action spécifique initiée le plus souvent, mais pas forcément, par l’appel d’un syndicat ou d’une organisation représentative, qui invite les salariés ou agents publics à cesser le travail.
La grève a donc une définition juridique précise : droit individuel s’exerçant collectivement, la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. Trois conditions cumulatives importantes doivent donc être réunies : cessation effective du travail, caractère collectif et concerté, existence de revendications à caractère professionnel.
Impossible de se mettre en grève pour des motifs purement politiques
En principe, la participation à une grève motivée exclusivement par des revendications politiques, telles qu’une protestation contre des décisions gouvernementales sans rattachement à des conditions de travail ou des intérêts professionnels, est illicite, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Mais les juridictions admettent la licéité d’un mouvement de grève lorsqu’il présente à la fois un aspect politique (par exemple, protester contre une réforme gouvernementale) et un aspect professionnel (défense des salaires, conditions de travail, emploi) à condition que ce dernier soit réel, et non simplement prétexte.
Ainsi, si la revendication professionnelle est réelle, la grève est licite, même si elle comporte des aspects politiques. Si la revendication professionnelle n’est qu’un prétexte, la grève est illicite… mais ce sera difficile à prouver pour un employeur.
La grève est possible le 10 septembre
Ces dernières semaines, des syndicats ont publié des appels à la grève, accompagnés de revendications professionnelles. Dès le mois d’août, certaines fédérations de la CGT, comme la FNIC-CGT (industries chimiques), la CGT commerce et service, ou certaines unions départementales (Nord), ont appelé à la grève pour se joindre au mouvement du 10 septembre.
Du côté de SUD, d’importantes fédérations (Sud-Rail, Sud-Industrie, Sud-PTT et Finances publiques) ont également appelé à cesser le travail. Le 27 août, la confédération CGT a décidé d’inclure le 10 septembre à son agenda de mobilisation : elle incite à « débattre avec les salariés et à construire la grève partout où c’est possible ».
Le même jour, Solidaires a, lui, directement appelé à la grève et au blocage au niveau national.
Ainsi, qu’un salarié soit membre ou pas d’une de ces organisations, qu’il appartienne ou non à un secteur précis, n’a aucune importance. L’existence de ces appels – par secteurs et national – et la présence de revendications professionnelles suffisent pour qu’il lui soit possible d’être gréviste sans commettre de faute professionnelle. Les salariés doivent toutefois respecter certaines règles propres à leur activité.
Des différences entre le privé et le public
La principale distinction concerne les modalités de la grève dans les secteurs privés et publics. Dans le privé, aucun préavis n’est requis sauf dispositions particulières ou si l’entreprise gère un service public soumis aux règles du préavis. Une convention collective ne peut en aucun cas réglementer l’exercice du droit de grève, pour les salariés d’une branche ou d’une entreprise. Ces derniers ne peuvent donc se voir reprocher le non-respect d’un délai de préavis, même inscrit dans un accord collectif.
Dans la fonction publique et dans les services publics, l’exercice du droit de grève est encadré par des règles spécifiques. Il existe une obligation de dépôt d’un préavis par une organisation syndicale représentative, précisant la date, l’heure et la durée de la grève. Les grèves doivent avoir un fondement professionnel, même lorsqu’elles s’inscrivent dans un mouvement national ayant une large portée. Mais le juge considère que toute grève a des objectifs professionnels, et c’est à l’administration d’apporter la preuve contraire.
Pas de droit de grève chez les indépendants
Au sens strict, le droit de grève n’est pas reconnu aux travailleurs indépendants tels les agriculteurs, les professions libérales … Les mouvements collectifs dans ces professions se voient appliquer le droit commun des manifestations ou d’autres formes d’action collective, mais ne sont pas juridiquement qualifiés de grève. Une exception notable : bien que juridiquement indépendants, les travailleurs utilisant des plateformes numériques (travailleurs ubérisés) peuvent organiser des mouvements de refus concerté de « fournir leurs services pour défendre leurs revendications professionnelles ».