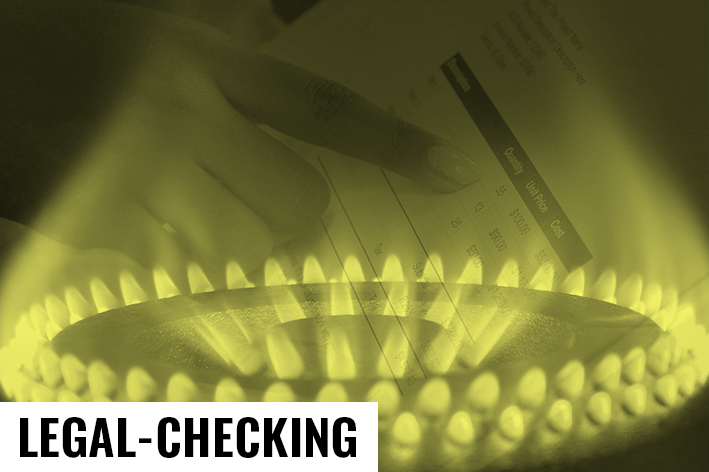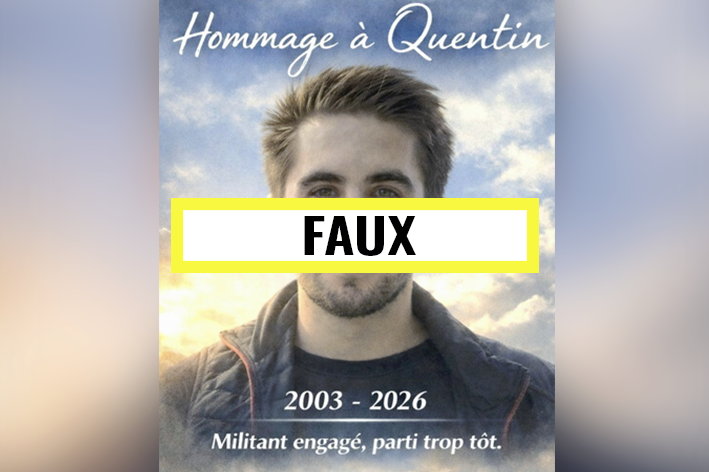Peut-on demander à la Banque centrale européenne de prêter aux États à « taux zéro » ?
Auteur : Etienne Merle, journaliste
Relecteurs : Vincent Couronne, docteur en droit européen, enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Etienne Merle, journaliste
Source : Fabien Roussel, le 13 septembre 2025
Fabien Roussel réclame que la Banque centrale européenne prête aux États sans intérêt. Le droit de l’Union l’interdit : la BCE ne peut ni prêter directement aux États ni souscrire leurs titres à l’émission, et son indépendance la met à l’abri de toute injonction politique. Des modifications substantielles des traités seraient à prévoir.
Une solution miracle ? Le 13 septembre 2025, invité du 13h de TF1, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, s’en est pris aux agences de notation américaines qui viennent de dégrader la note de la France.
« Comment peut-on confier notre économie et le poids de notre dette à des agences privées qui n’ont aucun mandat ? », a-t-il dénoncé, avant de proposer une alternative : que la Banque centrale européenne finance directement les États « à taux zéro », afin de libérer des moyens pour « investir dans l’industrie et nos services publics ».
À première vue, l’idée paraît séduisante. Aujourd’hui, quand la France emprunte sur les marchés financiers pour financer son déficit ou refinancer sa dette, elle doit payer des intérêts de plus en plus lourds, parfois supérieurs à 3 %, soit, en 2025 , un coût estimé à 55 milliards d’euros.
Derrière la proposition de Fabien Roussel se cache donc une promesse simple : supprimer ce coût en demandant à la BCE de prêter gratuitement aux États. Bien que cette idée semble prometteuse sur le papier, elle se heurte à une question juridique centrale : les traités européens autorisent-ils un tel financement monétaire direct ?
Les traités interdisent un financement direct
La réponse se trouve dans l’article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d’« accorder des découverts ou tout autre type de crédit » aux administrations publiques et d’« acquérir directement auprès d’elles des instruments de dette ».
Autrement dit, pas de prêt direct à un Trésor public, pas d’achat d’obligations au moment où elles sont émises. Ce choix juridique n’est pas neutre. La création de l’euro a reposé en partie sur une exigence forte de rigueur monétaire, portée notamment par l’Allemagne, qui souhaitait que la Banque centrale européenne bénéficie d’une indépendance institutionnelle robuste et ne soit pas placée au service direct des États.
Mais cette position a toujours été discutée en économie. Certains économistes estiment qu’elle empêche des investissements publics nécessaires, par exemple pour la transition écologique ou la santé, et défendent l’idée d’un financement monétaire ciblé, parfois appelé « monnaie hélicoptère ».
D’autres, comme la BCE elle-même, rétorquent qu’un tel financement reviendrait à donner un chèque en blanc aux gouvernements, au risque d’une inflation durable et d’une perte de confiance dans l’euro.
Même en mettant de côté l’article 123, un second verrou s’impose : l’article 130 du TFUE consacre l’indépendance de la BCE et des banques centrales nationales.
Elles « ne peuvent solliciter ni accepter d’instructions » des gouvernements ou des institutions de l’Union. En pratique, le Conseil des gouverneurs décide seul de la politique monétaire ; un État ne peut pas « demander » à la BCE de prêter à taux zéro.
Ce que la BCE peut faire sans violer l’interdiction
L’interdiction ne signifie pas pour autant immobilisme. La BCE peut intervenir sur le marché secondaire, c’est-à-dire racheter des obligations d’État déjà émises et détenues par des banques ou des investisseurs.
Imaginez la différence entre acheter une voiture neuve chez le concessionnaire (le marché primaire, où l’argent va directement au constructeur) et acheter la même voiture d’occasion à un particulier (le marché secondaire : l’argent change de mains entre propriétaires).
Pour la dette publique, c’est la même chose : la BCE ne peut pas acheter les obligations directement auprès de l’État au moment où elles sont créées, mais elle peut les racheter plus tard à une banque ou à un investisseur qui les détient déjà.
Objectif : en devenant un acheteur majeur de « seconde main », la BCE rassure les marchés et fait baisser les taux d’intérêt demandés aux États. En rachetant des obligations déjà émises, la BCE augmente leur demande, et fait baisser le taux d’intérêt.
Résultat : les investisseurs acceptent de prêter moins cher, car ils savent que la BCE est là comme acheteur massif. Ainsi, sans donner d’argent directement aux gouvernements, la BCE allège indirectement leur coût de financement.

La Banque centrale européenne (BCE) à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, le 11 septembre 2025. Photo : Daniel ROLAND / AFP
Au fil des ans, divers programmes ont été lancés pour faire face à différentes situations. L’OMT a été créé en 2012 pour calmer la crise de la dette souveraine, le PSPP en 2015, au cœur de « l’assouplissement quantitatif », et le PEPP en 2020, conçu pour atténuer l’impact de la pandémie de Covid-19.
La Cour de justice de l’Union européenne a validé ces pratiques. Dans les arrêts Gauweiler (2015) puis Weiss (2018), elle a jugé que ces programmes respectaient bien le traité, à condition que plusieurs garde-fous soient respectés : la BCE doit attendre un certain délai avant de racheter une dette nouvellement émise, limiter les volumes qu’elle achète, éviter de garantir aux États que leur dette sera reprise automatiquement, et surtout agir uniquement dans le cadre de son mandat : assurer la stabilité des prix.
En clair, la Cour a rappelé que la BCE dispose d’une grande marge de manœuvre technique, mais uniquement pour remplir sa mission de banque centrale, pas pour financer directement les budgets nationaux.
Changer la règle ? Une révision lourde des traités
Pour rendre possible un prêt direct de la BCE aux États, ou pour permettre aux gouvernements d’orienter la BCE en ce sens, comme le propose Fabien Roussel, il faudrait réviser le TFUE : lever l’interdiction de l’article 123 et toucher à l’indépendance consacrée par l’article 130.
La procédure exige l’unanimité des États membres et des ratifications nationales. Au regard des divergences de doctrines budgétaires au sein de la zone euro, l’hypothèse est, à ce stade, hautement improbable, puisqu’il suffit qu’un seul État s’y oppose pour faire capoter la réforme.
En définitive, la proposition de financer « à taux zéro » les États par la BCE percute de plein fouet l’ossature juridique et institutionnelle de l’Union : ce qui est permis, ce sont des achats encadrés après l’émission pour servir des objectifs monétaires ; ce qui demeure prohibé, c’est le financement direct des budgets publics.
Les textes et la jurisprudence sont constants sur ce point — et ils laissent peu de marge à l’interprétation. Il appartient à Fabien Roussel de parvenir à faire évoluer la doctrine politique européenne à l’unanimité. On ne peut que lui souhaiter bon courage.