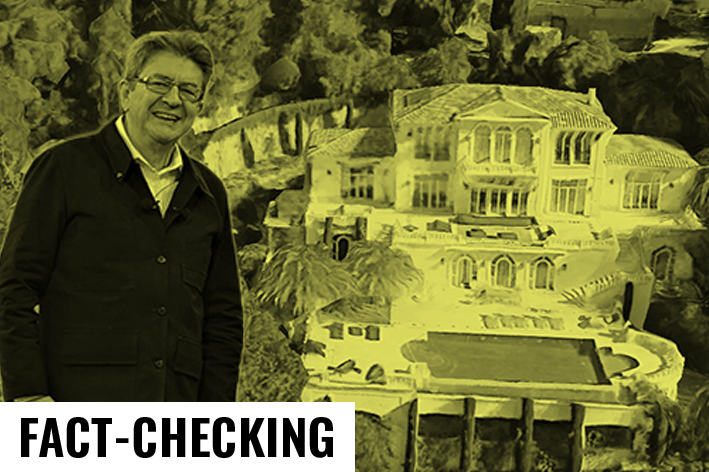Prestations sociales, AME, énergies renouvelables : pourquoi les mesures d’économies de Sarah Knafo sont juridiquement incertaines ?
Dernière modification : 16 septembre 2025
Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Relecteurs : Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay
Etienne Merle, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Guillaume Baticle, doctorant en droit public à l’Université de Poitiers
Source : Compte X de Sarah Knafo, 27 août 2025
L’eurodéputée Sarah Knafo propose 60 milliards d’économies à réaliser « tout de suite » pour réduire la dette publique. Mais plusieurs de ses mesures phares soulèvent de sérieux doutes sur leur faisabilité. Entre Constitution et droit européen, leur application serait longue et incertaine.
Une rentrée politique bien mouvementée. Tandis que le gouvernement Bayrou vacille, la dette publique et la recherche d’économies deviennent le terrain de toutes les surenchères. Les partis politiques avancent leurs remèdes pour tenter d’enrayer la machine à déficits.
Du côté de Reconquête, le parti d’extrême droite fondé par Eric Zemmour, c’est Sarah Knafo, seule eurodéputée du parti, qui a présenté, le 27 août 2025, sur son compte X, un programme de huit mesures qui dégageraient, selon elle, plus de 60 milliards d’économies tout de suite. Sa publication a été vue près d’1,5 million de fois à en croire les données du réseau social.
Mais au-delà des chiffres, contestables pour certains, c’est le droit qui dresse des barrières : plusieurs propositions s’entrechoquent avec les contraintes constitutionnelles et européennes. Or, sortir de ce cadre, si tant est que ce soit possible, serait un processus long et incertain. Les Surligneurs ont retenu trois exemples emblématiques.
Réserver les prestations sociales non contributives aux Français
Sarah Knafo estime pouvoir « récupérer » entre 15 et 20 milliards d’euros en supprimant les allocations non contributives versées aux étrangers, pour les réserver uniquement aux Français. Problème : les montants avancés sont largement surestimés. Cette évaluation, déjà proposée en 2021 par Éric Zemmour, repose sur un rapport de l’OCDE, rapporte TF1 la même année.
Or, les données de l’OCDE ne concernaient pas seulement les étrangers, mais l’ensemble des personnes nées à l’étranger, incluant donc les naturalisés et les ressortissants européens. L’organisation a d’ailleurs dénoncé, en 2022, une interprétation « farfelue et biaisée » de ses travaux, selon nos confrères de RTL.
Les chiffres solides disponibles, notamment ceux de la Caisse nationale des allocations familiales, estiment plutôt ce coût à environ 9 milliards d’euros par an — soit deux fois moins que les montants avancés. Et encore, ce montant n’est pas « récupérable » dans son intégralité, car les étrangers participent aussi au financement du système social, qui en retour bénéficient de prestations dites « contributives » (parce qu’ils cotisent pour cela).
Au-delà des montants, une autre difficulté surgit : le droit. Mettre en œuvre une telle mesure se heurterait à des obstacles constitutionnels. Nous l’avions déjà dit au début de la dernière campagne présidentielle, réserver des allocations et autres prestations sociales aux seuls ressortissants français est contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a jugé le critère de la nationalité contraire au principe d’égalité lorsqu’il n’avait aucun lien avec le but de l’allocation ou de la prestation en question.
Par exemple, une allocation destinée aux personnes handicapées ne pourrait être réservée aux seules personnes françaises dès lors que le but de cette allocation est simplement de compenser les effets d’un handicap.
Or, ces effets sont les mêmes pour toutes les personnes, qu’elles soient étrangères ou françaises. Inversement, il faudrait donc démontrer, pour chacune des très nombreuses allocations et prestations sociales, qu’elle est en lien avec la nationalité du bénéficiaire et qu’elle peut donc être supprimée pour les non-Français.
Si le Conseil a considéré que ce principe n’était pas applicable aux personnes étrangères en situation irrégulière, il faudrait tout de même modifier la Constitution et aménager le principe d’égalité qui y figure, avant de pouvoir appliquer cette mesure prônée par Reconquête.
Et le chemin est long : entre la rédaction des nouveaux textes, les débats parlementaires, l’organisation d’un Congrès ou d’un référendum, et la promulgation, on parle d’un calendrier de plusieurs mois, voire d’années. Surtout pour une réforme aussi sensible touchant à l’un des principes fondateurs de la République ancré jusqu’à la devise de la France.
Si donc économies il y a, elles risquent d’être bien plus maigres que prévu et ne pourraient arriver que d’ici à plusieurs années.
Supprimer l’aide médicale d’État (AME)
Autre proposition avancée par l’eurodéputée xénophobe : la suppression de l’aide médicale d’État (AME). Sur le coût du dispositif, rien à contester : il s’élève à environ un milliard d’euros par an.
En revanche, une étude de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), de 2019, a pointé qu’une suppression pourrait en réalité coûter plus cher, en raison du report de soins. Des pathologies aujourd’hui prises en charge précocement — et donc pour un coût raisonnable — risqueraient de se dégrader et d’aboutir à des hospitalisations plus lourdes et coûteuses.
L’AME n’a cessé d’être restreinte depuis sa création, et chacune de ces évolutions a été soigneusement examinée par le Conseil constitutionnel. Or, à la lumière de sa jurisprudence, il est hautement probable qu’une suppression pure et simple de l’AME serait jugée contraire à la Constitution.
Pour certains soins non urgents, des restrictions sont admises (délais de résidence, panier de soins limité, forfait modeste), ont été jugées proportionnées au regard de la lutte contre la fraude et de la maîtrise des dépenses.
Mais reste à définir la limite : un délai de résidence de neuf mois a été validé pour les soins, mais un même délai de cinq ans a été censuré pour certaines allocations (décision du 25 janvier 2024). La fourchette et le contenu du panier de soins relèvent donc de l’appréciation du Conseil constitutionnel.
Encore une fois, pour être sûr d’appliquer cette mesure, il faudrait modifier la Constitution (en particulier le préambule de 1946) pour réserver la protection sociale de la santé aux seuls Français et résidents réguliers, sous réserve du contrôle de la Cour européenne des droits de l’Homme. Autrement dit, on est loin des économies à réaliser tout de suite.
Supprimer tous les soutiens publics aux énergies renouvelables
Enfin, Sarah Knafo propose de supprimer tous les soutiens publics aux énergies renouvelables pour un gain estimé à 8 milliards d’euros d’économie. Mais là encore, ce chiffre ne dit pas tout.
Ces dispositifs, qui reposent principalement sur des contrats d’achat garantis et des compléments de rémunération, ne représentent pas une charge constante pour les finances publiques : leur coût varie en fonction des prix de l’électricité sur le marché de gros.
Ainsi, en 2022 et 2023, la flambée des prix a inversé la mécanique habituelle, générant non pas une dépense, mais des recettes pour l’État, à hauteur de 1,9 puis 4 milliards d’euros, rappelle la Commission de régulation de l’Énergie.
Surtout, l’intégration des énergies renouvelables dans le parc énergétique des États est un objectif fixé par l’Union européenne, par le biais d’une directive qui fixe comme but d’obtenir un taux d’énergies renouvelables de 42,5 % dans la consommation énergétique globale de l’UE, d’ici à 2030.
Or, si les éoliennes sont des installations privées, installées par des entreprises privées, elles ne sont, pour l’heure, viables économiquement que grâce aux différents soutiens publics (subventions, tarif d’achat de l’électricité éolienne par EDF avantageux, etc.), comme c’est le cas dans les autres pays européens. Supprimer purement et simplement les soutiens publics à ces énergies empêchera la France de réaliser l’objectif de 42,5 %, auquel elle est tenue.
En cas de manquement, la Commission européenne peut lancer une procédure contre la France, et la Cour de Justice de l’Union européenne peut la condamner à payer des amendes et astreintes, jusqu’à ce qu’elle se conforme à ses obligations.
Un exemple marquant concerne la Pologne : sa réforme judiciaire, qui portait atteinte à l’indépendance des juges, lui a valu une astreinte d’un million d’euros par jour. Au total, Varsovie a dû s’acquitter d’environ 320 millions d’euros.
Autre possibilité : quitter l’Union européenne. Mais là encore, ce ne sera pas pour tout de suite : selon l’article 50 du traité sur l’UE, un État qui souhaite quitter l’UE dispose d’un délai de deux ans à compter de la notification officielle pour négocier son retrait, délai qui peut être prolongé avec l’accord des autres membres.
En pratique, l’expérience du Brexit a montré que la sortie effective prend plus de temps : près de trois ans entre la notification et le départ du Royaume-Uni en 2020, et encore plusieurs années pour stabiliser les accords commerciaux et diplomatiques. Une traversée longue et semée d’embûches : la facture en vaut-elle la chandelle ?