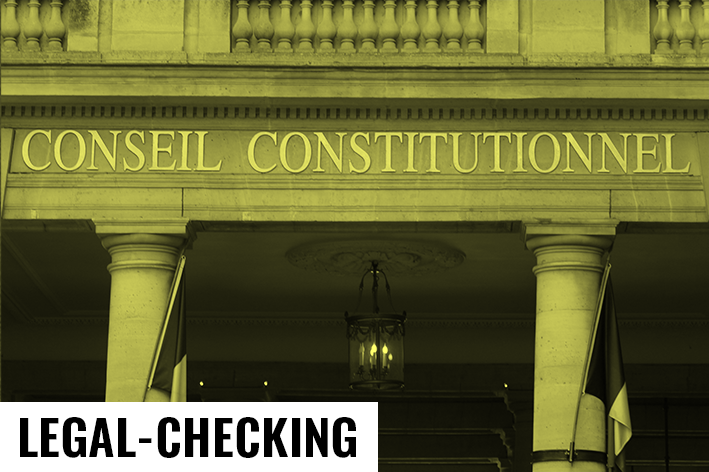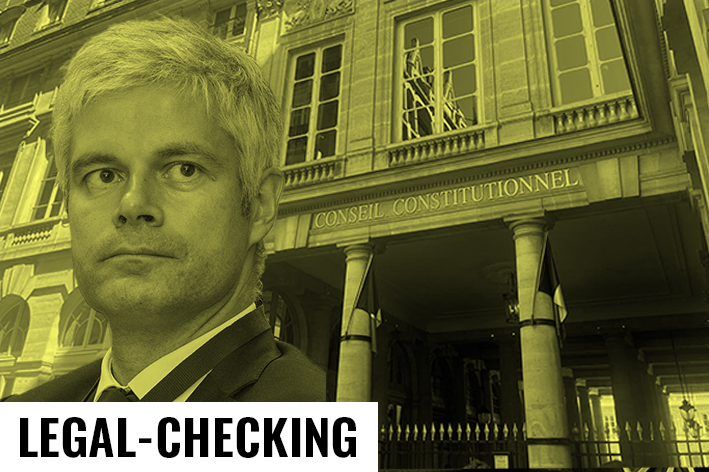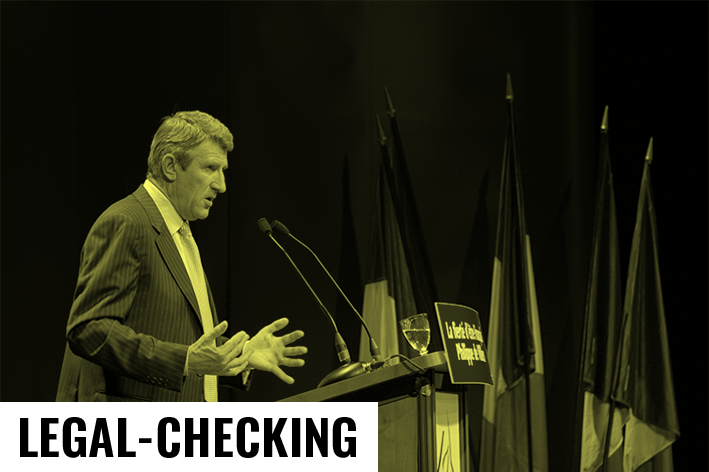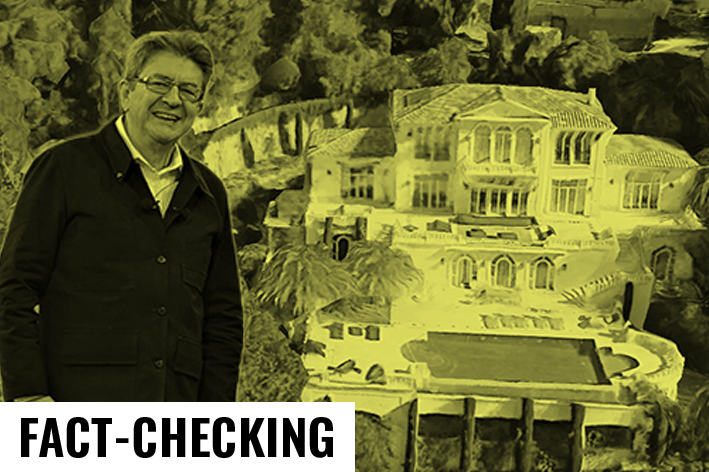L’Union européenne a-t-elle autorisé les pays membres à arrêter des journalistes comme l’affirment certains internautes ?
Dernière modification : 4 septembre 2025
Auteur : Nicolas Turcev, journaliste
Relecteurs : Didier Blanc, professeur de droit public, université Capitole I Toulouse, spécialiste du droit de l’Union européenne
Clément Benelbaz, maître de conférences en droit public, université Savoie Mont Blanc
Clara Robert-Motta, journaliste
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clarisse Le Naour, double cursus L3 science politique et L3 droit public à l’université Lumière Lyon II
Source : Compte X, le 9 août 2025
Entré en application le 8 août 2025, le règlement européen sur la liberté des médias fixe le régime juridique appliqué aux diffuseurs et aux journalistes au sein de l’UE. Si le texte encadre l’arrestation de journalistes dans certaines procédures, il ne crée pas cette possibilité, qui existe déjà dans le droit français.
Les journalistes auraient bientôt à choisir entre le stylo sur la couture ou la garde à vue. D’après plusieurs internautes, le règlement européen sur la liberté des médias (EMFA), entré en grande partie en application le 8 août 2025, autoriserait les pays membres à arrêter de façon « arbitraire » les journalistes « si l’intérêt général le justifie ».
Cette mesure viserait, selon plusieurs publications, à menacer de sanctions les médias dont la ligne éditoriale ne serait pas alignée avec la politique menée par la Commission européenne. « Les journalistes devront marcher au pas sinon case prison », prévient un internaute. L’alerte a notamment été relayée par un ancien député du groupe d’extrême droite ECR au Parlement européen.
L’EMFA encadre effectivement le recours à la détention de journalistes, mais il ne le crée pas. Pour une raison simple : cette possibilité existe déjà. S’ils bénéficient de certaines protections liées à leur mission d’information du public, les journalistes peuvent faire l’objet de mesures d’enquête ou de privation de liberté, au même titre que les autres justiciables.
Protéger les sources des pouvoirs publics
Adopté en 2024, le règlement européen sur la liberté des médias vise à « renforcer la liberté éditoriale et l’indépendance des fournisseurs de services de médias » et à « mettre en place des garanties » qui les préservent des ingérences, rappelle l’Union européenne sur son site.
En clair, Bruxelles entend protéger les journalistes contre un certain nombre d’atteintes à l’exercice de leur métier. Parmi celles-ci figurent les tentatives de pression par les pouvoirs publics pour obtenir l’identité des sources avec lesquelles travaillent les reporters.
Pour prévenir ce risque, l’article 4 interdit aux États membres de placer les journalistes sous surveillance, de les perquisitionner et de les mettre en détention « aux fins de l’obtention d’informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier ». Mais il prévoit en même temps un certain nombre d’exceptions à ce principe.
Le règlement EMFA prévoit la possibilité que des journalistes puissent être arrêtés par les États membres pour se renseigner sur leurs sources seulement si trois conditions cumulatives sont remplies : l’arrestation doit être justifiée par une « raison impérieuse d’intérêt général », « proportionnée » et autorisée par une « autorité judiciaire ou une autorité décisionnelle indépendante et impartiale ».
Des citoyens parmi d’autres
Mais en dehors du cas particulier dans lequel une mise en détention pourrait porter atteinte au secret des sources, le fait qu’un journaliste puisse être arrêté n’a rien d’inédit : « Ce sont des citoyens parmi d’autres, qui peuvent donc être arrêtés s’ils commettent des infractions pénales, ou sont suspectés de l’avoir fait », rappelle Alice Dejean de la Bâtie, maîtresse de conférences à l’université de Tilburg, aux Pays-Bas.
Autrement dit, un journaliste pris en flagrant délit de vol à l’étalage ou de faits de violence, par exemple, ne bénéficierait d’aucune immunité particulière. « Simplement, leur qualité de journaliste les protège contre certaines arrestations et contre d’autres mesures d’investigation comme les perquisitions, le placement sous écoute, etc., lorsque celles-ci risqueraient de porter atteinte à la liberté d’expression, dont fait partie la liberté d’information », explique la spécialiste du droit pénal.
Ces garanties, consacrées par l’EMFA, sont pour l’essentiel déjà présentes dans le droit français. L’article 2 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui protège le secret des sources prévoit qu’il ne peut y être porté atteinte « que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi ».
« On a ainsi, exactement comme dans le texte européen, un principe de protection du secret des sources, d’où découle un principe de protection des journalistes et de leurs contacts réguliers contre les actes d’investigations qui risqueraient de menacer ce secret », explicite Alice Dejean de la Bâtie.
Le règlement EMFA serait même « un peu plus protecteur » que la loi française sur le placement en détention, selon la pénaliste, qui souligne que « l’autorisation préalable [aux arrestations] n’est pas prévue telle quelle par la loi de 1881 ». Ainsi, contrairement à ce qu’affirment certains internautes, la loi européenne sur la liberté des médias ne prévoit pas de faciliter le placement en détention de journalistes, mais au contraire de mieux l’encadrer.
Un texte qui ne fait pas l’unanimité
Pour autant, le texte ne fait pas l’unanimité au sein des défenseurs des libertés publiques. La coalition d’ONG de protection des droits numériques EDRi, qui milite pour une interdiction totale de l’utilisation des logiciels espions, reproche à Bruxelles d’autoriser leur déploiement contre les journalistes, alors même que « certains États membres les ont bannis », « introduisant [ainsi] une incertitude » juridique.
L’article 4 du règlement autorise effectivement la mise en place d’un « logiciel de surveillance intrusif » sur les appareils des journalistes dans le cadre d’enquêtes pour certains délits et crimes punissables d’au moins trois à cinq ans d’emprisonnement. En France, un collectif réunissant plusieurs dizaines d’organisations représentatives des médias et des journalistes avait alerté sur le risque d’atteinte au secret des sources posé par cette mesure.
L’alliance EDRi regrette également que le règlement EMFA autorise, selon elle, la surveillance numérique des journalistes au nom de la sécurité nationale, ou encore que la « raison impérieuse d’intérêt général » pouvant motiver l’atteinte au secret des sources soit une notion sujette à une « interprétation extensive ».
L’Arcom saisie pour avis
Au cours des négociations sur l’EMFA, la France faisait partie des pays souhaitant limiter les protections accordées aux journalistes, selon plusieurs médias spécialisés. En décembre 2023, le média d’investigation Disclose avait révélé les positions conservatrices de Paris, épousant parfois celles du régime illibéral hongrois. La France s’était notamment opposée à ce que les arrestations de journalistes nécessitent une autorisation préalable délivrée par une autorité judiciaire ou impartiale et indépendante. En vain.
Ce critère, qui n’existe donc pas encore dans le droit français, pourrait demander une révision de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, même si les règlements européens s’appliquent directement dans tous les États membres de l’Union.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a justement été saisie par le gouvernement, le 8 août 2025, d’un avant-projet de loi visant à adapter le droit français au règlement EMFA. Le régulateur rendra son avis dans « quelques semaines » et « appelle de ses vœux une adoption rapide du projet de loi ». D’après Reporters sans frontières, le texte ne sera pas examiné avant l’automne.
L’entrée en application du règlement sur la liberté des médias intervient à la suite de multiples révélations sur l’espionnage visant des journalistes européens, notamment en Grèce et en Hongrie. Mais aussi après l’assassinat de deux journalistes enquêtant sur la corruption, la Maltaise Daphne Caruana Galizia en 2017, et le Slovaque Ján Kuciak en 2018.
Plus récemment, en France, en 2023, le placement en garde à vue de la journaliste de Disclose Ariane Lavrilleux pour avoir publié des informations sur une opération de l’armée française en Égypte avait provoqué un tollé au sein de la profession. La reporter a finalement été placée sous le statut de témoin assisté dans le cadre d’une enquête pour atteinte au secret-défense.
Contacté, le ministère de la Culture, le ministère de tutelle des journalistes, n’avait pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication.