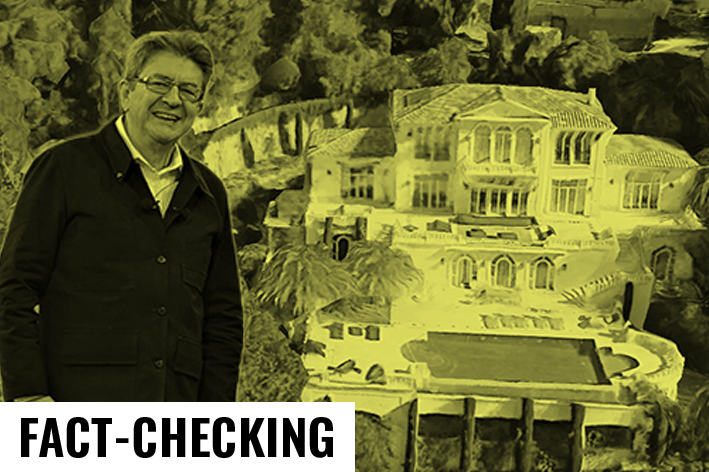A-t-on le droit de léguer son pacemaker à un chien malade ?
Auteur : Nicolas Turcev, journaliste
Relectrice et relecteur : Maylis Ygrand, journaliste
Jean-Paul Markus, professeur de droit public à l’Université Paris-Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Léocadie Petillot, juriste et journaliste en formation au CFJ
Source : Compte Facebook, le 20 avril 2025
Plusieurs publications affirmant qu’il est possible de faire don de son pacemaker usagé à un animal de compagnie rencontrent un grand succès en ligne. Si la pratique semble attestée en France, elle reste marginale en raison des progrès technologiques et du cadre légal qui interdit la réutilisation des déchets médicaux.
Un cœur s’arrête, l’autre repart. D’après plusieurs internautes, les propriétaires de pacemakers pourraient, après leur mort, léguer leur implant à un chien qui en aurait besoin, s’ils le précisent dans leur testament. Cette affirmation, très populaire sur les réseaux sociaux, circule depuis plusieurs années en ligne. À tel point que des vétérinaires reçoivent régulièrement des propositions de dons de stimulateurs cardiaques.
« Des gens m’appellent pour me dire “Mon père est décédé, est-ce que je peux vous donner le pacemaker ?” », raconte Thibault Ribas, cardiologue vétérinaire installé dans les Bouches-du-Rhône.
Le contenu de ces posts est probablement traduit à partir d’une publication en langue anglaise, elle aussi très appréciée des internautes. Et comme l’a démontré USAToday, elle est factuellement correcte — du moins, aux États-Unis. Car si la pratique existe en France, elle y est prohibée par le droit.
Des universités états-uniennes récupèrent les pacemakers usagés
Outre-Atlantique, plusieurs universités (comme ici ou ici) ont, à une époque, mis en place des programmes de récupération de pacemakers usagés pour les réutiliser sur des animaux de compagnie. Ces opérations ont débouché sur des implantations réussies, relayées dans la presse locale.
« Les fréquences cardiaques minimum chez le chien et l’homme sont dans les mêmes grandeurs », explique Jean Derégnaucourt, président de l’Académie vétérinaire de France, ce qui rend le matériel destiné à l’homme potentiellement compatible avec son meilleur ami. Et la pratique est ancienne. Le premier stimulateur cardiaque implanté chez un chien, en 1967 aux États-Unis, avait été extrait d’un corps quelque temps auparavant.
La réutilisation des implants des défunts permet de réduire les coûts prohibitifs liés à l’achat et à la pose du pacemaker sur le chien, qui peuvent se chiffrer en milliers de dollars. Certains fabricants, comme l’étatsunien Medtronic, font même don aux vétérinaires des pièces neuves dont la date limite d’utilisation pour l’être humain est dépassée, s’offrant au passage une belle visibilité dans les médias.
Une pratique marginale en France
Et en France ? La pratique existe bel et bien, même si elle reste marginale. « La pose de pacemakers de “récupération” [sur les chiens] est encore employée, bien que plus rarement [qu’auparavant] », affirme François Serres, cardiologue vétérinaire établi dans le Nord. Le spécialiste déclare tout de même avoir réalisé sa dernière opération avec un implant de récupération en 2023.
Mais il précise que « les maladies demandant [la pose d’un pacemaker] sont peu fréquentes, et comme elles touchent des animaux souvent déjà âgés, une part importante des propriétaires ne souhaiteront pas investir dans cette prise en charge coûteuse ».
Malgré l’attrayante réduction des frais pour leurs clients, les vétérinaires joints par Les Surligneurs ont tendance à se détourner des implants destinés aux humains pour guérir les chiens. Depuis quelques années, des modèles neufs adaptés aux spécificités des animaux sont commercialisés, dont l’approvisionnement et la fiabilité sont garantis. À l’inverse des pacemakers usagés retirés des défunts, pas toujours adaptés.
« Chaque marque de pacemaker nécessite une unité de programmation particulière qui sert à le régler, et il n’est pas possible de l’utiliser pour une autre marque, explique Thibault Ribas, qui déclare ne pas utiliser les implants de seconde main. Donc si je recevais un pacemaker, il faudrait qu’il soit de la même marque que ceux que j’achète. »
À cet obstacle s’ajoute celui de la durée de vie du matériel récupéré sur le corps d’un défunt. « Les électrodes sont usées et la pile [qui dure dix ans en moyenne pour un implant humain, ndlr] à moitié déchargée. Ce sera moins cher, mais est-ce qu’il va fonctionner ? Pas longtemps en tout cas, donc on risque la vie de l’animal », souligne Laetitia Barlerin, vétérinaire et consultante pour la Fondation 30 Millions d’Amis.
« C’est une opération excessivement lourde et risquée », insiste Thibault Ribas, qui redoute le risque d’infection en cas de mauvaise stérilisation de l’implant de récupération, et donc « d’échec » de la procédure sur le chien.
Pour toutes ces raisons, la structure états-unienne CanPacers, spécialisée dans la récupération de pacemakers humains neufs pour les animaux, a pris la parole pour dissuader les particuliers de faire don de leurs implants usagés.
« Ils ne sont pas destinés à être réutilisés, donc même s’ils sont stérilisés, ils ne sont pas faits pour ça, avertit Hollie Krivan, l’administratrice de CanPacers, qui croule sous les messages d’internautes désireux de donner leur implant. Tous les pacemakers ne sont pas utilisables sur les animaux, seulement une poignée […]. C’est une pratique qui a existé dans la médecine vétérinaire il y a un moment et qui théoriquement peut toujours être réalisée […], mais les principales universités [états-uniennes] utilisent des [implants] neufs. Il n’est pas nécessaire [d’avoir recours aux dons de stimulateurs de seconde main]. »
Cette mise au point résonne d’autant plus en France où, malgré les pratiques, la réutilisation des implants cardiaques des défunts est tout bonnement interdite par la loi, selon les spécialistes interrogés par Les Surligneurs.
La loi prévoit l’élimination du pacemaker
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) impose que les pacemakers soient retirés du corps du défunt avant l’inhumation ou la crémation, à cause de la pile au lithium qui alimente l’équipement. Dans le premier cas, afin d’éviter de polluer l’environnement ; dans le second, pour prévenir le risque d’explosion qui endommagerait le four crématoire. Le retrait est pratiqué par le médecin ou le thanatopracteur, qui récupère le pacemaker.
Il existe des exceptions pour les modèles miniatures logés directement dans le cœur, définis par arrêté (ici ou ici), qui nécessitent des opérations invasives hors de portée des personnels funéraires et des médecins non spécialistes. Ces dispositifs peuvent être inhumés, ou bien incinérés avec la dépouille. Les métaux qui résultent de la crémation sont ensuite séparés des cendres du défunt par le crématorium, qui doit en faire cession « à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux », dispose le CGCT.
Qu’il soit explanté ou brûlé, le stimulateur cardiaque est alors considéré comme un déchet d’activités de soin à risque infectieux, abrégé en Dasri, tel que défini par le Code de la santé publique.
« Les pacemakers doivent donc suivre la filière [de valorisation] de ces déchets, indique Fabien Squinazi, président de la commission sur les risques liés à l’environnement du Haut Conseil de la santé publique. Ils sont stérilisés par le médecin ou thanatopracteur, puis doivent être envoyés au fabricant qui les récupère pour les éliminer, ou bien être traités par un collecteur de déchets à risque infectieux. La réglementation ne précise en aucun cas qu’ils puissent être réutilisés. […] Un Dasri doit être éliminé. »
L’article R1335-2 du Code de la santé publique prévoit que les producteurs de Dasri, dont font partie les thanatopracteurs, ont la responsabilité de les éliminer. Cette destruction peut cependant être déléguée à un organisme tiers. Un guide édité en 2009 par la Direction générale de la santé précise le protocole à suivre pour l’élimination des pacemakers, qui font partie des Dasri électroniques. Comme ils contiennent une pile, la valorisation de ce composant suit le parcours de recyclage des piles et accumulateurs (P&A), prévu par le Code de l’environnement.
Pour le reste du dispositif, composé de différents matériaux comme le titane et le caoutchouc, l’éco-organisme agréé par l’État pour la valorisation de la filière P&A et auquel adhèrent des fabricants de pacemakers, la Corepile, recommande de le renvoyer au fabricant pour son traitement ultérieur. D’autres acteurs privés, comme La Collecte médicale, peuvent se charger de traiter l’ensemble du dispositif, piles et métaux, tout en respectant les filières de valorisation prescrites par la loi.
« Il faut, en plus, savoir que les piles au lithium contenues dans les pacemakers sont des déchets dangereux qui peuvent prendre feu, donc leur traitement suit un protocole bien spécifique », rajoute Céline Commeureuc, responsable de la logistique pour l’entreprise de collecte, qui récupère les pacemakers des hôpitaux et des établissements funéraires. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises (ADR) impose en effet de suivre certaines précautions pour le transport de ces objets.
Les ayants droit ne peuvent pas récupérer l’implant
Malgré ce cadre réglementaire, peu connu, la réutilisation de pacemakers explantés reste une option pour certains professionnels de santé. Outre l’implantation sur des chiens, attestée par plusieurs cardiologues vétérinaires joints par Les Surligneurs, l’opération est aussi réalisée sur des humains dans le besoin.
Depuis plus de vingt-cinq ans, l’association STIMDéveloppement, présidée par le professeur Xavier Jouven, collecte des stimulateurs cardiaques de seconde main, y compris auprès des thanatopracteurs, pour en faire bénéficier les malades de pays à faibles revenus, essentiellement en Afrique.
À travers des missions de formation et la mise à disposition de matériel, la structure, qui revendiquait 600 implantations en 2021, vise à autonomiser les hôpitaux locaux sur les procédures — très complexes — de chirurgie cardiaque. « Au-delà de sauver des vies, explique l’association, [le but est] d’apporter un savoir qui n’était pas dans le pays pour en sauver encore plus. »
Dans un document détaillant le circuit de collecte des pacemakers explantés, l’association affirme qu’après le décès, la famille a la possibilité de faire don du dispositif « dans un but humanitaire ». Autrement dit, puisque les implants usagés appartiendraient aux ayants droit du défunt, leur collecte serait possible. Et si cette récupération est envisageable pour une réimplantation sur l’homme, a priori, rien ne devrait s’opposer à ce qu’elle puisse aussi profiter aux chiens dans le besoin.
Mais cette interprétation ne convainc pas Bruno Py, professeur en droit privé et sciences criminelles à l’université de Lorraine. « C’est illégal, c’est clair », tranche le spécialiste du droit médical, auteur d’un article scientifique sur les pacemakers explantés.
« La question plus large est celle de la récupération par les ayants droit de restes humains : est-ce que je peux récupérer le bras qu’on m’a amputé, ou le placenta ? En droit, la réponse est claire, c’est non, il n’y a pas droit à restitution et au contraire, il y a une obligation de destruction », juge le chercheur, qui rejoint l’avis du Haut Conseil de santé publique : le pacemaker usagé est un déchet infectieux à éliminer.
C’est aussi la conclusion d’un mémoire d’études du juriste Damien Lemoine, consacré au statut juridique des dispositifs médicaux implantables, que Les Surligneurs ont pu consulter. Le document conclut à une « obligation légale de destruction » des stimulateurs cardiaques explantés, au titre de leur catégorisation en Dasri. « Cette [obligation] se comprend aisément dans la mesure où, contenant des agents pathogènes, il est pour des raisons de sécurité sanitaire nécessaire de ne pas les laisser en circulation », écrit l’auteur.
Des études récentes prouvent toutefois que le taux d’infection, en cas de réemploi de pacemakers, n’est pas significativement plus élevé que lors de l’implantation d’un dispositif neuf. Toujours est-il que pour Bruno Py, « cette réutilisation pose un gros problème de responsabilité par rapport au [potentiel] caractère infectieux ou défaillant ». D’où l’interdiction de cette pratique, en creux, par la classification des stimulateurs usagés en déchets infectieux. Pour les humains, comme pour les chiens.
Contactés, l’association STIMDéveloppement et le ministère de la Santé n’avaient pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication.