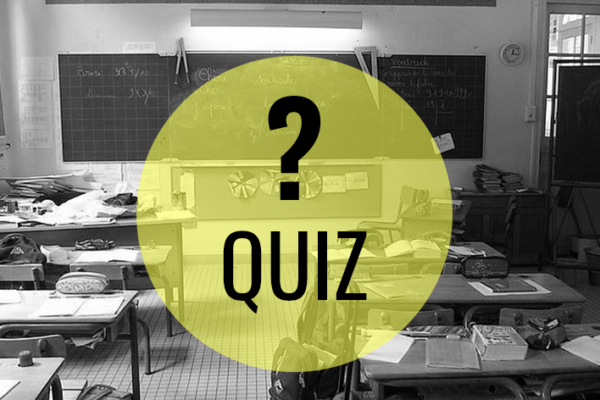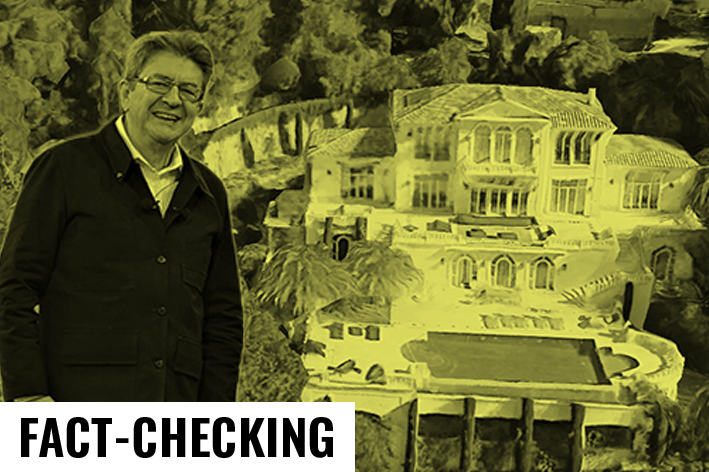Laïcité en France : notre dossier pour comprendre le débat qui fracture la République
La rédaction des Surligneurs
Hommages aux papes, signes religieux, manifestation en soutien à la Palestine ou à Israël au sein d’institutions publiques : la question de la laïcité et de la place des religions dans l’espace public suscite, depuis plusieurs années, polémiques, malentendus et crispations. Les Surligneurs s’attachent, dossier après dossier, à en éclairer les contours juridiques, loin des approximations et des instrumentalisations. Un dossier essentiel pour démêler le droit des idées reçues — et mieux comprendre ce qui est vraiment en jeu.
« La religion, c’est à la maison », ou encore « Pas de prière dans les rues ». Au nom de la laïcité, on appelle à interdire, à cacher, à effacer. Et parfois, ce qui doit être caché au nom de la laïcité ne l’est pas, car « la France est un pays chrétien ». Ce débat n’est pas nouveau, mais il met en lumière une question essentielle : la définition et la compréhension de la laïcité semblent de plus en plus floues.
Ce qui fait la singularité de la République française, et de son droit, c’est son rapport à la religion. Dieu ne bénit pas la France comme il bénit les États-Unis d’Amérique, car la République ne reconnait aucun culte. Et cela veut dire qu’elle ne doit pas en faire prévaloir un sur les autres.
Un hommage d’État à un pape ? Pas de problème, seulement si le même hommage est rendu aux chefs des autres religions. Un chandelier juif dans le bureau d’un maire ? Interdit. Idem pour les crèches de la nativité dans les mairies.
À part pour les services et les édifices publics, la laïcité, ce n’est pas l’interdiction de la religion ou “la discrétion dans l’espace public”, comme l’affirme Eric Zemmour. La laïcité est avant tout un principe de liberté pour les individus : celui d’exercer la religion de son choix, ou de n’en suivre aucune, sans jamais craindre d’être inquiété ou menacé pour cela. Mais la polarisation du débat public ne fait qu’alimenter cette confusion. Pas de panique, les Surligneurs vous aident à y voir plus clair.
Drapeaux en berne pour le pape François : hommage d’État ou entorse à la laïcité ?
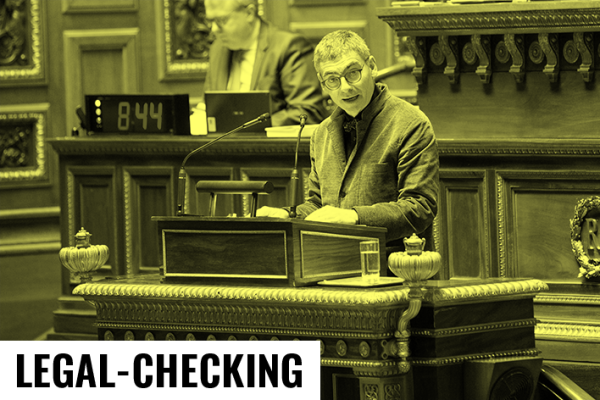
La décision du gouvernement de mettre les drapeaux en berne pour les obsèques du pape François a suscité l’indignation de certains élus au nom de la laïcité. Mais l’État a-t-il vraiment enfreint les principes de neutralité religieuse ?
La laïcité est-elle vraiment synonyme de « discrétion dans l’espace public », comme le dit Eric Zemmour ?
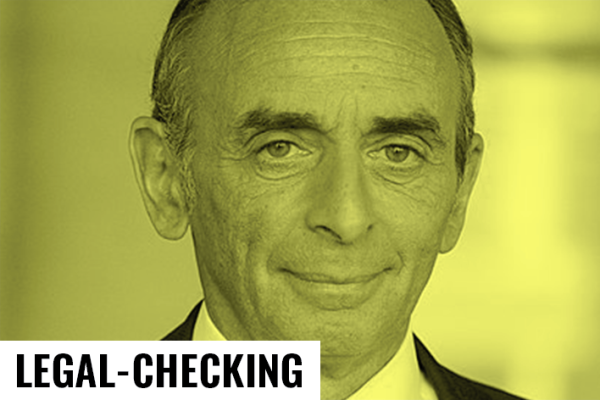
Alors que le débat sur l’interdiction du voile dans le sport s’étend à l’espace public, la laïcité est invoquée à tort pour justifier cette interdiction. Pourtant, elle garantit avant tout la neutralité de l’État et la liberté des individus, dans le respect de l’ordre public.
Christian Estrosi a-t-il le droit d’exposer un chandelier et un drapeau israélien dans son bureau de maire ?
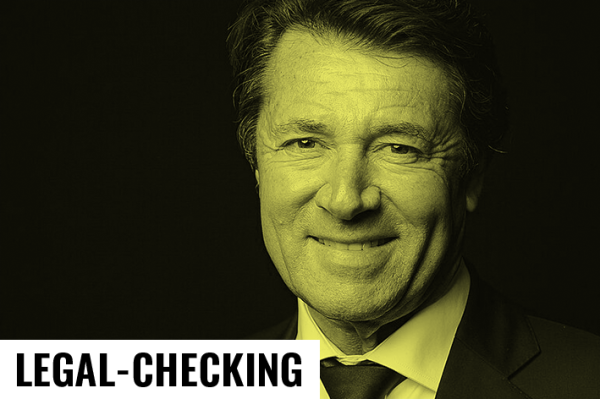
Un symbole religieux n’a rien à faire dans le bureau d’un maire, sauf dans une vitrine d’exposition avec d’autres objets décoratifs ou cadeaux faits à l’édile. Quant au drapeau israélien, que ce soit dans le bureau du maire ou en façade de mairie, il constitue un message politique contraire au principe de neutralité des services et édifices publics.
Loi de 1905 : pourquoi la ville de Metz peut subventionner la construction d’une mosquée

Des internautes s’indignent du fait que la ville de Metz ait décidé de subventionner la construction d’une mosquée à hauteur de 490 000 euros alors que la loi de 1905 instaure le principe de séparation entre les Églises et l’État. Mais en Alsace-Moselle, c’est le Concordat de 1801 qui s’applique toujours.
Un enseignant doit-il s’abstenir de donner son avis sur la religion ou la politique dans les médias ?
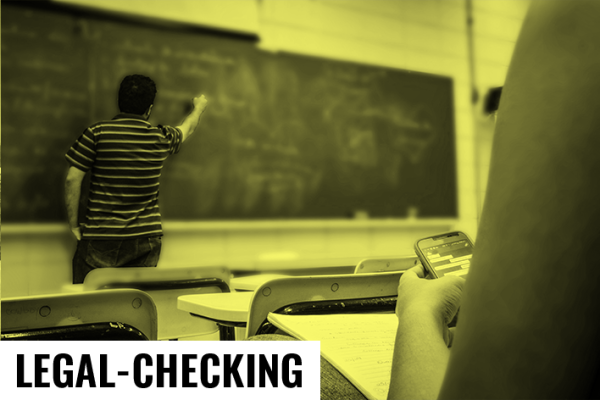
Critiqué pour avoir défendu publiquement « les racines catholiques » de la France, l’enseignant et chroniqueur Kévin Bossuet n’a pourtant enfreint ni le principe de laïcité ni son devoir de réserve. En dehors de la salle de classe ou de l’amphi, la liberté d’expression des fonctionnaires reste protégée.
Attaque du 7 octobre : les manifestations étudiantes sont-elles contraires aux principes de neutralité et de laïcité ?
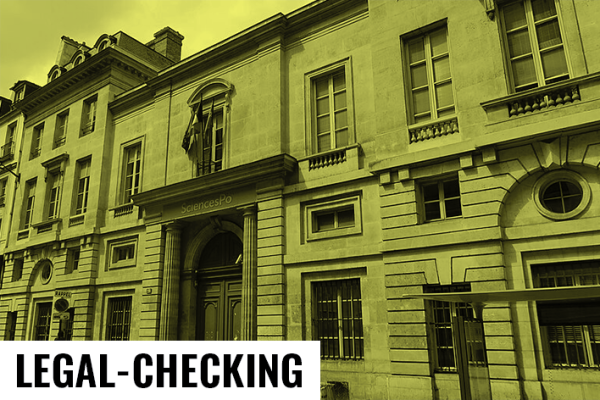
Les principes de neutralité et de laïcité ne s’appliquent pas aux usagers du service public d’enseignement supérieur que sont les étudiants. Ces derniers peuvent exprimer des idées politiques ou religieuses dans la mesure où cette expression ne trouble pas le bon fonctionnement des enseignements.
Et enfin… École et religion : testez vos connaissances avec notre quiz