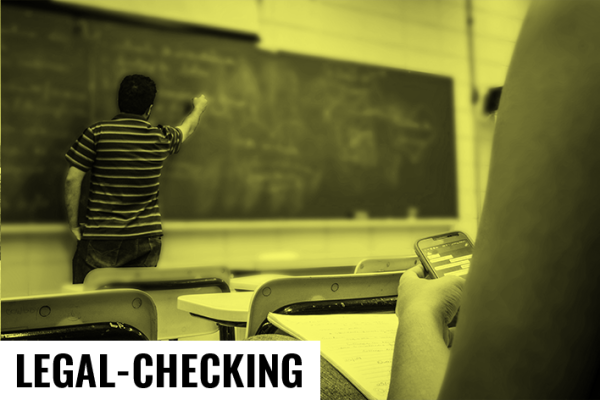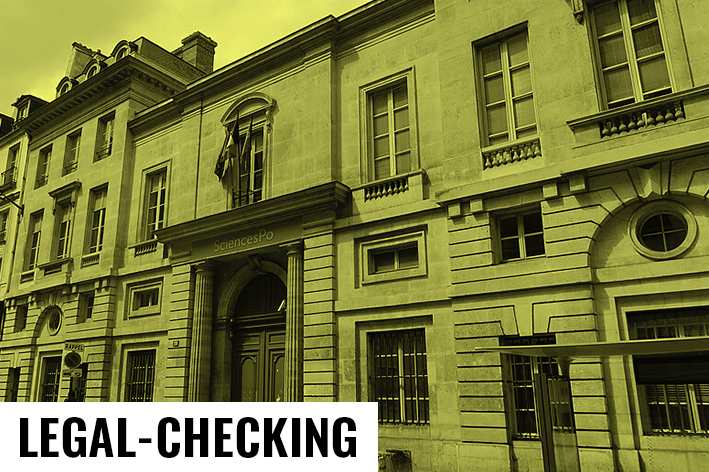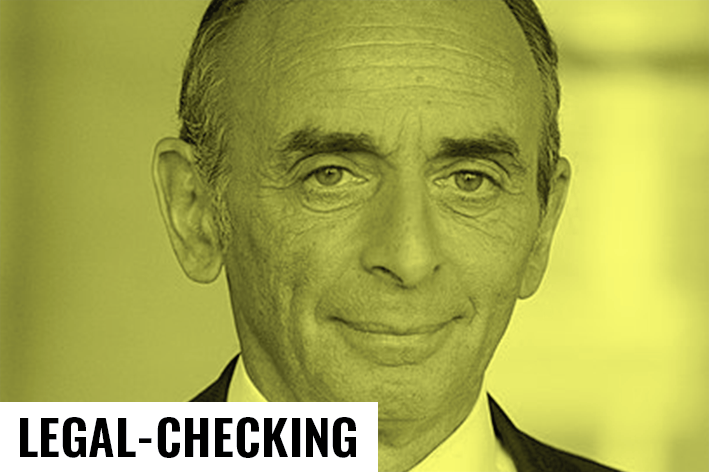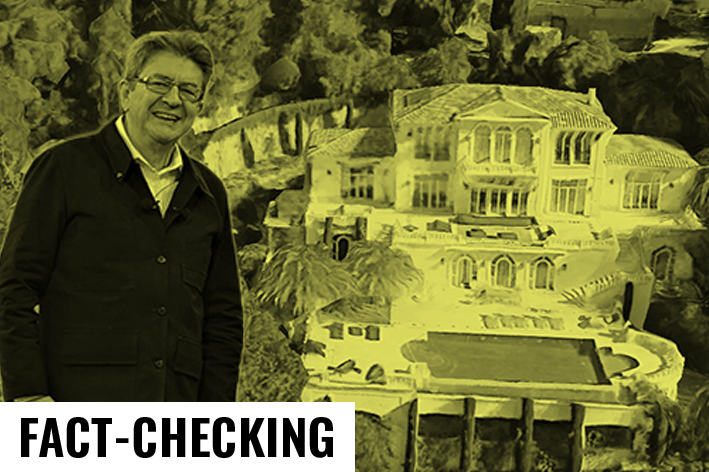Un enseignant doit-il s’abstenir de donner son avis sur la religion ou la politique dans les médias ?
Auteur : Guillaume Baticle, doctorant en droit public, université de Poitiers
Relecteur : Jean-Paul Markus, professeur de droit public, université Paris-Saclay
Liens d’intérêts ou fonctions politiques déclarés des intervenants à l’article : aucun
Secrétariat de rédaction : Clara Robert-Motta, journaliste
Source : Publication Facebook, le 13 avril 2025
Critiqué pour avoir défendu publiquement « les racines catholiques » de la France, l’enseignant et chroniqueur Kévin Bossuet n’a pourtant enfreint ni le principe de laïcité ni son devoir de réserve. En dehors de la salle de classe ou de l’amphi, la liberté d’expression des fonctionnaires reste protégée.
Kevin Bossuet, enseignant et chroniqueur sur Cnews, a exprimé, à l’occasion de la fête des Rameaux, son soutien envers les catholiques. Sur un plateau de télévision, repris sur son compte Facebook, il dit aux catholiques « qu’ils ne doivent pas se cacher et qu’ils doivent être fiers d’être catholiques et le dire. C’est le catholicisme qui a fait la France ! C’est la base de notre identité, de notre culture et de notre civilisation ».
Depuis, des internautes lui opposent le principe de laïcité et le devoir de réserve des enseignants. Mais dans le cas présent, Kévin Bossuet ne commet aucune faute.
Selon nos confrères de Checknews, Kevin Bossuet est bien enseignant d’histoire-géographie, mais nous ne savons pas s’il exerce dans un établissement public ou privé. S’il est enseignant dans un établissement privé, il n’est pas fonctionnaire et la question de sa neutralité ne se pose pas. En revanche, c’est un peu plus complexe s’il enseigne dans un établissement public.
Des enseignants neutres et laïcs dans l’exercice de leurs fonctions
L’article L121-2 du code général de la fonction publique dit en effet que « l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité » et qu’il « exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité ». Mais cette obligation ne s’impose que « dans l’exercice de ses fonctions ». En dehors de leurs fonctions, les agents publics peuvent exercer leur liberté fondamentale d’expression.
Son soutien aux catholiques ne s’étant pas fait dans un cadre scolaire, il n’y a pas de faute à lui reprocher. Si en revanche ce professeur d’histoire donnait son opinion bien tranchée, comme il en a l’habitude sur les plateaux de télévision, en classe devant ses élèves, il enfreindrait son devoir de neutralité.
Rien à voir avec le devoir de réserve
Le devoir de neutralité de l’enseignant est à différencier du devoir de réserve, également avancé par l’internaute. Si l’enseignant doit être neutre pendant son temps de travail, il peut exprimer ses opinions personnelles en dehors, mais en faisant preuve d’une certaine réserve, c’est-à-dire d’une certaine retenue dans la façon d’exprimer ses opinions.
L’idée de cette réserve est de ne pas porter atteinte à l’image de l’administration de laquelle il dépend. Cette obligation n’est pas prévue par la loi, mais est analysée au cas par cas par le juge administratif lorsqu’une sanction disciplinaire pour manquement à ce devoir est contestée devant lui.
L’exemple classique en la matière est une décision du Conseil d’État de 1953. Le directeur du CNRS de l’époque s’était montré solidaire d’une lettre ouverte très virulente envers la politique du gouvernement. Démis de ses fonctions, le juge a estimé qu’une telle sanction était proportionnée, car la lettre en question comportait « des attaques violentes et injurieuses contre le gouvernement français ».
Kévin Bossuet est donc libre de dire ce qu’il veut hors de sa salle de classe. Mais s’il critique le gouvernement et l’administration, il doit le faire de manière mesurée, sans violence verbale ni provocation.