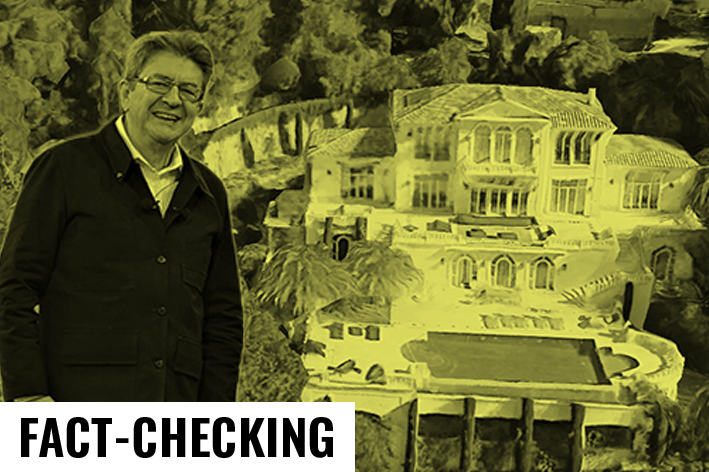Transmission du sida : que dit la loi ?
Autrice : Clotilde Jégousse, journaliste
Relecteur : Vincent Couronne, chercheur associé en droit européen au centre de recherches Versailles Institutions Publiques, enseignant en droit européen à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Il n’existe en France aucune obligation pour une personne séropositive d’en informer son partenaire. En revanche, l’infecter sciemment lors d’un rapport sexuel non protégé est passible d’une peine d’emprisonnement.
“Il vaut mieux convaincre que contraindre”. En mai 1995, la France enregistre près de 40 000 cas de sida depuis le début de l’épidémie, et 60% des malades en sont déjà décédés. Il y a urgence. Mais dans une interview accordée au Journal du Sida, Jacques Chirac, alors Président de la République, tient une position claire : la lutte contre l’épidémie ne doit pas être menée au mépris du respect du secret médical et des droits des personnes infectées. Ceux qui transmettent le virus ne doivent pas être incriminés, sauf s’ils l’ont fait intentionnellement.
Trente ans plus tard, la France est parvenue à juguler l’épidémie, et les avancées médicales ont permis de considérablement prolonger l’espérance de vie en bonne santé des quelque 180 000 malades infectés à travers le pays. La politique nationale en matière de responsabilité des malades, elle, n’a pas changé.
Respect absolu du secret médical
Environ 5 000 personnes découvrent encore leur séropositivité chaque année en France. Comme pour toutes les infections sexuellement transmissibles, la Haute autorité de santé recommande aux médecins d’évoquer systématiquement la question du partenaire avec le patient, et de l’inciter à l’informer de sa contamination. Il n’existe toutefois aucune obligation légale en ce sens : un malade est libre de garder le secret.
En 1994, l’Académie Nationale de Médecine avait plaidé pour un assouplissement du secret médical, dans le but de permettre aux médecins de pouvoir, “en leur âme et conscience”, informer le conjoint d’un malade contaminé par le VIH “sans tomber sous le coup d’une condamnation pénale”. L’Ordre des médecins s’y est toujours opposé. Contrairement à d’autres pays européens, comme la Suède, qui a consacré l’obligation pour les soignants d’informer le partenaire d’un malade testé positif au sida, le secret médical ne souffre pas d’exception concernant le VIH en France.
Comme pour les autres informations médicales, la divulgation de la séropositivité d’un patient est un délit prévu à l’article 226-13 du code pénal. La jurisprudence considère par ailleurs que le risque de contamination ne constitue pas un “péril imminent” pour le partenaire. Le médecin ne peut donc pas se voir reprocher une éventuelle non assistance à personne en péril, prévue par l’article 223-6 du code pénal et le code de déontologie médicale.
Cette application particulièrement stricte fait toujours l’objet de débats. Dans un avis publié en 2018, le Conseil national du sida et des hépatites virales appelle notamment, lorsque c’est la volonté du malade, à permettre au médecin d’en informer son partenaire à sa place, ce qui n’est aujourd’hui pas possible.
“Si j’administre une substance nuisible, je dois en répondre”
À partir du moment où le malade refuse de faire le choix de la transparence, sa responsabilité se situe sur une ligne de crête. Il n’existe pas d’infraction spécifique à la transmission du virus du sida, comme c’est le cas au Danemark ou dans certains États américains par exemple. Un amendement avait été déposé au Sénat en ce sens au moment de la réforme du code pénal en 1991, avant d’être supprimé par l’Assemblée nationale, notamment suite aux pressions d’associations comme Act Up Paris.
Depuis les années 2000, la jurisprudence a néanmoins permis de dégager des lignes claires. Si la personne suit un traitement lui permettant d’avoir une charge virale neutre et indétectable, ou qu’elle a des rapports sexuels protégés, sa responsabilité pénale ne peut pas être engagée.
En revanche, un malade qui a des comportements à risque et contamine sciemment quelqu’un est pénalement responsable. Dans un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 janvier 2005, Christophe Y. avait été condamné à six ans d’emprisonnement pour avoir “volontairement administré des substances nuisibles entraînant une infirmité permanente, en l’espèce le virus VIH”, en vertu de l’article 222-15 du code pénal. La cour avait considéré qu’en entretenant une relation sexuelle non protégée sans révélation de son statut sérologique, “le prévenu ne pouvait ignorer les risques manifestes de contamination”.
Il s’agit toutefois d’une infraction dite de résultat, c’est à dire qu’elle ne peut être caractérisée que si la victime est effectivement infectée. “La loi dit seulement : ‘si j’administre une substance nuisible, je dois en répondre’, mais elle ne consacre aucune obligation pour le malade, et ne lui interdit pas d’avoir des conduites à risque”, précise Bruno Py, professeur de droit privé à l’Université de Lorraine et spécialisé en droit médical.
“La prise de risque n’est jamais assimilée à un acte intentionnel”
Le crime d’empoisonnement, puni de 30 ans de réclusion criminelle par l’article 221-5 du code pénal, a, lui, toujours été écarté en la matière. En 2003, dans l’emblématique affaire du “sang contaminé” – après que le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a sciemment distribué du sang contaminé par le virus entre 1984 et 1985 – la cour de cassation a précisé qu’il ne pouvait être caractérisé « que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteinte volontaire à la vie« .
Or, transfuser en prenant le risque que le sang soit contaminé, ou avoir des relations sexuelles en risquant de transmettre sa maladie, ne démontre pas une intention de tuer. “C’est la même chose en matière routière : un automobiliste qui roule à 200km/h et à contresens n’est pas accusé de meurtre s’il tue quelqu’un. La prise de risque en France n’est jamais assimilée à un acte intentionnel”, explique Bruno Py.
Cela ne l’empêche pas de briser des vies et de compliquer le quotidien des millions de personnes atteintes par le virus du sida en France et dans le monde. Ce vendredi 22 mars, la trentième édition du Sidaction commence. Diffusé sur six chaînes de télévision, l’évènement caritatif tentera de récolter un maximum de dons pour soutenir la recherche, améliorer l’accès aux soins et continuer la prévention.