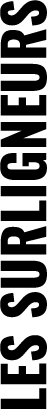Interdiction des réseaux sociaux et des téléphones : “les mineurs ont aussi un droit au respect de leur vie privée”
Propos recueillis par Clotilde Jégousse, journaliste
À l’occasion des élections législatives, plusieurs candidats et chefs de file de partis se sont exprimés en faveur d’une régulation de l’accès des mineurs aux écrans. Entretien avec Philippe Mouron, maître de conférences en droit privé spécialisé en droit des médias électroniques.
Au milieu de l’économie, de la sécurité et de l’immigration, l’exposition des mineurs aux écrans s’est invitée dans la campagne des élections législatives. Le programme du Rassemblement National, présenté lundi 24 juin, prévoit d’interdire le téléphone portable jusqu’au lycée. Dans une allocution prononcée peu après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée, le Président de la République Emmanuel Macron a lui plaidé pour une interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, et des téléphones portables avant 11 ans. Une loi de plus en la matière, qui n’endiguerait pas le phénomène, et se heurterait au respect du droit à la vie privée et de la liberté d’expression des mineurs, selon Philippe Mouron, maître de conférences en droit privé spécialisé en droit des médias électroniques.
LS : La proposition du chef de l’État entend lutter contre “l’addiction aux écrans”, “terreau de toutes les difficultés” que rencontrent les mineurs. Que changerait concrètement cette nouvelle loi selon vous ?
Philippe Mouron : La première réaction que j’ai eue, c’est : “une de plus”. Il existe déjà en droit français une profusion de dispositifs pour restreindre l’accès des mineurs aux écrans et aux réseaux sociaux. La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978 prévoit une autorisation des parents pour que les mineurs de moins de quinze ans puissent se connecter à des services de communication en ligne. D’autres lois s’y sont ajoutées, comme celle du 2 mars 2022, qui a obligé les vendeurs de smartphones et d’ordinateurs à pré-installer des dispositifs de contrôle parental pour accéder à Internet. On peut aussi évoquer la loi du 7 juillet 2023 qui a instauré une majorité numérique : l’article 4 prévoit l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de 15 ans, sauf autorisation parentale. Même si cette dernière n’est pas encore entrée en vigueur, les dispositions présentées par le Président de la République ne font pas figure d’innovation.
LS : Tous ces textes en appellent à la responsabilité des parents. Peuvent-ils actuellement être tenus responsables en cas de mise en danger de leurs enfants sur Internet ?
Philippe Mouron : Le code civil permet d’engager la responsabilité de parents négligents au sujet de l’utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants. En 2014, une mère divorcée avait comparu devant la Cour d’appel d’Aix en Provence pour avoir créé un compte Facebook à sa fille de trois ans, afin qu’elle puisse jouer à des jeux sur sa tablette pendant des heures. Résultat : elle accusait un retard important en termes d’élocution, de développement sensoriel etc. Les juges lui avaient retiré la garde de l’enfant et l’autorité parentale, pour la confier exclusivement au père. Même sans loi spécifique, les parents sont responsables de ce qui arrive à leur enfant, y compris dans ses intérêts personnels.
LS : La législation ne pourrait donc pas être plus protectrice qu’elle ne l’est déjà ?
Philippe Mouron : Les mineurs ont aussi un droit au respect de leur vie privée, et le bénéfice de la liberté d’expression, qui ont une valeur constitutionnelle. À ce jour, aucun texte fondamental ne considère qu’ils peuvent en être privés. On peut les encadrer, par exemple en interdisant l’usage du téléphone portable à l’école – depuis une loi de 2018, son utilisation est proscrite pour les élèves de la maternelle au collège, NDLR. Mais l’utilisation d’Internet est aussi un moyen d’échanger avec des amis, de la famille… Il peut y avoir des tas d’usages leur permettant de s’épanouir. Et il y a un principe de proportionnalité en droit : toute mesure qui restreint un droit fondamental doit être proportionnée au but poursuivi. Cela exclut une interdiction pure et simple, d’autant qu’il existe d’autres moyens de limiter certains usages, avant d’envisager l’interdiction. Celle-ci ne pourrait être prononcée qu’en cas de risque grave ou de santé publique.
LS : Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, estime que l’instauration d’une majorité numérique serait de toute façon du ressort de l’Union européenne. Qu’en pensez-vous ?
Il y a un risque. La Commission européenne a envoyé un avertissement à la France, disant que la loi sur la majorité numérique et celle sur les influenceurs (du 9 juin 2023 visant à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux, NDLR) pouvaient ne pas être conformes au droit de l’Union européenne. Concernant les très grandes plateformes, elle a en effet la compétence exclusive pour réguler les usages. L’article 28 du règlement sur les services numériques (DSA) prévoit déjà des dispositions relatives à la protection des mineurs en ligne, même si elles sont pour le moment beaucoup moins détaillées. Pour les autres services en ligne, les États-membres pourraient retrouver plus de latitude, mais il faut s’attendre à ce que la Commission décide, là aussi, d’adopter des textes qui viendront préciser la portée de ces dispositions. Le but, c’est qu’il y ait le même niveau de protection dans toute l’Union européenne, puisque le problème dépasse les frontières. Théoriquement, on ne peut pas aller plus loin que ce que prévoit le règlement.
Une erreur dans ce contenu ? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier ? Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode.