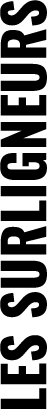Élections législatives : dans le sport, “la neutralité est davantage un souhait politique qu’une réalité”
Autrice : Clotilde Jégousse, journaliste
Relecteur : Vincent Couronne, chercheur associé en droit public au centre de recherches Versailles Institutions Publiques, enseignant en droit européen à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Les prises de positions des joueurs de l’équipe de France de football contre les extrêmes ces derniers jours, à l’image de Kylian Mbappé, hérissent le Rassemblement National, qui invoque le principe de neutralité. En pratique, il semble pourtant difficile d’envisager des sanctions.
Garantir la “liberté d’expression”, mais “éviter les débats de nature politique et religieuse et veiller à un principe de neutralité”. Le fil est fin, et l’exercice d’équilibriste auquel s’adonne le président de la Fédération française de football, périlleux. Lors d’une conférence de presse donnée mardi 18 juin, Philippe Diallo répond une nouvelle fois aux questions sur les positions qu’ont prises les joueurs Marcus Thuram et Kylian Mbappé en vue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains.
Interrogé par les journalistes avant le début de l’Euro, samedi 15 juin, le fils de Lilian Thuram – connu comme son père pour son engagement contre le racisme – a appelé à “se battre pour que le RN ne passe pas”. Une position derrière laquelle le capitaine des Bleus a dit se “ranger” dès le lendemain. “Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent”, a justifié le taulier de la sélection. Un t-shirt floqué du logo “FFF” – fédération française de football – sur le dos, il a exhorté “tous les jeunes à aller voter”.
Interdiction de “tout discours politique”
Si la ministre des sports Amélie Oudéa Castéra a qualifié la sortie de Kylian Mbappé d’“absolument exemplaire”, elle a rapidement suscité l’ire du Rassemblement National. “Est-ce que c’est normal que les sportifs utilisent leur liberté d’expression pour s’engager dans le débat politique actuel?”, a fustigé Jordan Bardella dans l’émission La grande interview diffusée sur Europe 1 et Cnews mardi 18 juin.
De fait, l’article 1er des statuts de la FFF prévoit qu’“à l’occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci”, sont notamment interdits “tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical” et “tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande”. Une règle de neutralité des athlètes qui n’est pas sortie du chapeau de la Fédération, puisqu’elle figure aussi à l’article 50 de la charte olympique, à laquelle se réfèrent les statuts.
Dans un arrêt rendu le 29 juin 2023, le Conseil d’État a eu l’occasion de vérifier leur légalité. Saisit par trois associations et un collectif informel, les “hijabeuses”, qui estimaient que l’interdiction du port du voile lors des matchs, au nom de la neutralité, entravait la liberté d’expression des joueuses, le juge administratif a validé les statuts, en se fondant sur l’article 1er de la loi du 24 août 2021 dite “contre le séparatisme”. Celle-ci prévoit qu’un service public doit veiller à ce que les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction soient soumises à une obligation de neutralité. “La FFF est chargée d’une mission de service public. Les joueuses qu’elle sélectionne en vertu de l’article L131-15 du code du sport contribuent à la cohésion nationale et à la représentation de la France. Par conséquent, le Conseil d’État a estimé que l’obligation leur incombait”, explique Clément Benelbaz, maître de conférences en droit public à l’Université Savoie Mont Blanc et auteur du livre “Le principe de laïcité en droit public français”.
Suspensions inenvisageables
C’est donc logiquement que la Fédération a publié un communiqué, samedi 15 juin, dans lequel elle demande que soit “comprise et respectée” la neutralité de l’institution, “ainsi que celle de la sélection nationale dont elle a la responsabilité”.
De là à imaginer une sanction pour les joueurs qui franchiraient la ligne, il y a toutefois un pas que la Fédération ne fera pas, selon David Pavot, Professeur de droit international à l’université de Sherbrooke et spécialisé sur la question du sport. “Il est inenvisageable de suspendre l’un des vingt cinq joueurs qui composent l’équipe de France de football. La neutralité est davantage un souhait politique qu’une réalité. C’est un équilibre très difficile à trouver pour la FFF, qui est entre le marteau et l’enclume”, analyse-t-il. Pour le juriste, le communiqué de la FFF permet surtout de conserver de bonnes relations avec un éventuel nouveau gouvernement, qui resterait “le principal bailleur de fond de la Fédération”. Et d’ajouter, dubitatif : “S’il n’y avait pas de plausibilité d’avoir un gouvernement RN, je ne sais pas si elle serait intervenue”.
Rien de surprenant à cela : les compétitions sportives, y compris les Jeux Olympiques, sont utilisées par les nations et les athlètes comme caisses de résonance pour des revendications politiques et sociétales depuis des décennies. Le poing ganté des athlètes afro-américains Tommie Smith et John Carlos, levé contre la ségrégation raciale sur le podium des Jeux Olympiques de Mexico en 1968 est encore dans toutes les têtes. Et si le geste leur avait valu l’exclusion à vie, le Comité International Olympique (CIO) a assoupli les règles au fil des années.
À l’arrivée du marathon des Jeux Olympiques de Rio en 2016, l’Ethiopien médaillé d’argent Feyisa Lilesa croise les bras au-dessus de sa tête en solidarité avec les manifestants Oromo en Éthiopie, alors opposés à une réquisition de terres par le gouvernement. Loin d’être sanctionné par le CIO, son geste lui permet d’obtenir l’asile politique aux États-Unis. Quatre ans plus tard, lors des Jeux Olympiques de Tokyo, plusieurs joueuses de l’équipe américaine de football, dont la capitaine Megan Rapinoe, mettent un genou à terre pour protester contre le racisme et montrer leur soutien au mouvement “black lives matter” aux États-Unis, sans qu’aucune sanction ne tombe. Même chose concernant le plongeur britannique Tom Daley, qui prononce un discours contre l’homophobie après son sacre lors de la même olympiade.

Le marathonien Feyisa Lilesa passe la ligne des Jeux Olympiques de Rio avec un signe de protestation contre la répression des manifestants en Ethiopie en 2016. Olivier Morin/AFP
Il arrive d’ailleurs au CIO lui-même de prendre position. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022, il bannit les athlètes russes et biélorusses du sport mondial, avant d’en réintégrer quelques uns en décembre 2023, sous réserve qu’ils n’aient pas soutenu la guerre en Ukraine. Le comité a précisé il y a quelques jours que seule une poignée de sportifs de ces nationalités pourrait participer aux Jeux Olympiques de Paris, sous bannière neutre – sans hymne, drapeau ni couleurs. Une décision en forme de statu quo tout de même, puisque l’Ukraine – accompagnée de la Pologne et des Pays baltes – demandait leur exclusion pure et simple.
Une erreur dans ce contenu ? Vous souhaitez soumettre une information à vérifier ? Faites-le nous savoir en utilisant notre formulaire en ligne. Retrouvez notre politique de correction et de soumission d'informations sur la page Notre méthode.